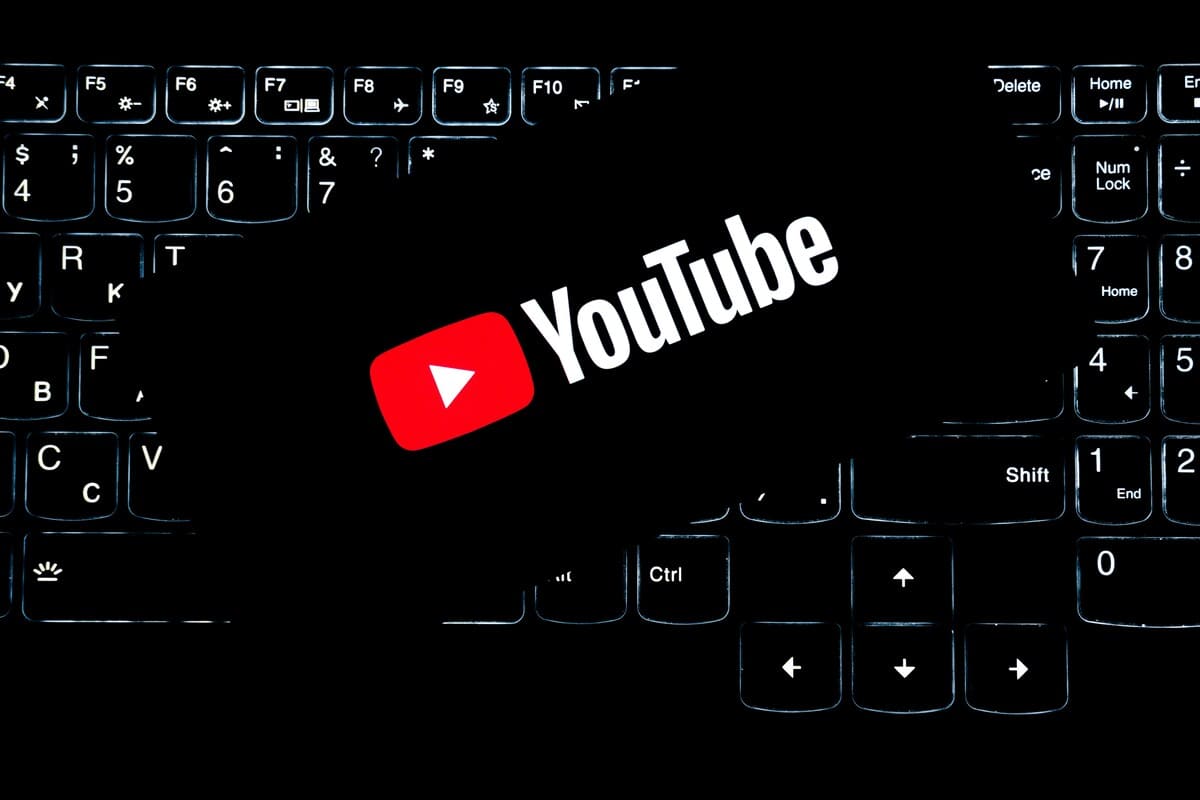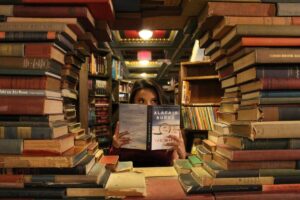Passage obligé : le constat, sans s'y enfermer
Même si chacun connaît la situation de la nation, l'exercice du constat reste incontournable. Le sujet n'est cependant pas ce constat en lui-même, mais la manière dont il est analysé et surtout ce que l'on en fait. Depuis plus de dix ans, rapports, études et ouvrages consacrés à la Tunisie répètent les mêmes diagnostics, souvent sur des centaines de pages, sans analyse systémique réelle et sans déboucher sur des propositions opérationnelles crédibles. En Tunisie, le constat finit par devenir une fin en soi.
Afin de ne pas reproduire cet écueil, nous avons volontairement cadré l'état des lieux sur les sujets majeurs et l'avons décliné en deux lectures complémentaires :
- La première repose sur une analyse académique des crises systémiques qui traversent le pays.
- La seconde s'appuie sur l'analyse des expressions citoyennes sur le web, commentaires, débats et réactions publiques.
Ces deux lectures se recoupent largement. Pour éviter les redondances, les chiffres et exemples sont répartis entre les deux articles, afin de proposer une photographie fidèle de la réalité nationale, sans alourdir inutilement le propos.
L'objectif n'est donc pas de documenter une énième fois les dysfonctionnements du pays, mais de poser les bases nécessaires à leur prise en compte réelle, préalable indispensable à toute stabilisation et à toute transformation crédible.
La crise encore la crise ?
Depuis 2011 et en réalité depuis les années 2000, la Tunisie traverse une succession de crises majeures qui ont provoqué un effondrement progressif sur plusieurs fronts, réduisant à néant les espoirs suscités par la révolution. Le discours dominant porté par les partis politiques et une grande partie des élites consiste à isoler ces crises et à les attribuer à des causes exogènes : pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, tensions énergétiques mondiales, instabilité régionale ou changement climatique.
Cette lecture fragmentée et réductrice poursuit un objectif clair : diluer les responsabilités en invoquant en permanence « la crise ». Elle occulte une réalité bien plus profonde : la Tunisie est confrontée à une seule et unique crise systémique dont le cœur est politique au sens large. Cette crise politique agit à la fois comme déclencheur et comme accélérateur, générant huit crises interdépendantes, institutionnelle, identitaire, économique, sociale, sanitaire, sécuritaire, judiciaire et écologique qui s'alimentent mutuellement dans un cercle vicieux destructeur.
La crise politique : le « noyau dur » des dysfonctionnements
La crise politique tunisienne (au sens large) se caractérise par une absence chronique de compétences capables de remettre en cause le système existant (ou même simplement de redessiner un quartier ou un village), une absence de vision stratégique, de méthode, de leadership fort et surtout de projet commun pour la nation, adopté et porté par la nation.
Indépendamment de la perte de démocratie provoquée par l'action du président Kaïs Saïed, la vie politique tunisienne depuis 2011, s'est réduite à des egos surdimensionnés, une incapacité à l'écoute, une absence de travail de fond, un clanisme digne du Moyen Âge et l'emprise de barons, pour la plupart mafieux, régnant dans l'ombre et protégés par des institutions à la fois dépassées et instrumentalisées.
Entre 2011 et 2024, la Tunisie a connu treize gouvernements successifs et près de 400 ministres. Cette instabilité extrême traduit une fragmentation partisane permanente et des luttes de pouvoir incessantes.
Cette situation a paralysé la prise de décision publique, bloqué les réformes essentielles, miné la confiance des citoyens dans les institutions et nourri une désillusion postrévolutionnaire profonde et durable.
Depuis 2011, la crise politique constitue la racine centrale de l'ensemble des dysfonctionnements du pays et alimente toutes les autres crises systémiques. La perte de démocratie progressive n'en est pas l'origine, mais une conséquence directe, révélatrice de l'échec collectif de la classe politique, médiatique et intellectuelle à assumer ses responsabilités historiques envers la nation et ses citoyens. Dans une lecture issue des sciences de la complexité, cette dérive autoritaire relève d'un réflexe de survie d'un système à bout de souffle, incapable de se réformer et cherchant à se maintenir par la contrainte et l'illusion marketing plutôt que par la légitimité.
Les huit crises interdépendantes découlant de la crise politique centrale
La crise politique a donné naissance à huit crises majeures, chacune amplifiée par son interdépendance avec les autres.
1. Crise institutionnelle
L'instabilité politique chronique depuis 2011 a profondément affaibli les institutions publiques, au point de les rendre largement incapables d'assumer leurs missions fondamentales. Le retard persistant dans la mise en place de la Cour constitutionnelle, pourtant prévue par la Constitution de 2014 mais bloquée pendant des années par des conflits partisans, en constitue une illustration emblématique.
Lors des événements du 25 juillet 2021, au moment de la suspension du Parlement, 83 % des lois adoptées depuis la révolution n'avaient fait l'objet d'aucun décret d'application. Elles n'ont donc produit aucun effet réel.
En 2023, les lois de finances totalisaient environ 2 600 mesures, dont moins de 8 % étaient effectivement appliquées.
Cette incapacité à exécuter la décision publique ne concerne pas uniquement les domaines économiques ou administratifs. Elle affecte directement des fonctions essentielles de l'État, parmi lesquelles l'éducation, la culture, la recherche, la production intellectuelle et la transmission des savoirs.
Faute d'institutions stables, pilotées, évaluées et responsables, les politiques éducatives et culturelles se succèdent sans continuité, sans vision de long terme et sans cohérence nationale. Les réformes annoncées ne sont ni suivies, ni évaluées, ni corrigées. Les programmes changent sans cap clair, les enseignants sont laissés sans cadre stratégique, et la culture est réduite à des initiatives ponctuelles, sans politique publique structurée.
Cette défaillance institutionnelle produit un effet cumulatif. Elle empêche la construction d'un récit national partagé, fragilise la transmission des valeurs communes, affaiblit l'esprit critique et laisse le champ libre à l'improvisation, aux discours simplistes et à la fragmentation sociale. L'école et la culture ne jouent plus leur rôle de stabilisation, de projection et d'élévation collective.
Depuis la révolution, les institutions n'ont ainsi produit aucun impact utile et durable pour le peuple. Leur seule réussite mesurable a été de protéger le système en place, ses monopoles, ses cartels et ses lobbies. Malgré les promesses répétées du régime actuel, cette faiblesse institutionnelle persiste, entretient l'incertitude juridique, fragilise l'État de droit et alimente directement la crise politique initiale dans une boucle de rétroaction destructrice.
2. Crise identitaire
Les divisions autour de l'identité tunisienne, laïcs et islamistes, modernistes et conservateurs, centralisme, régionalisme et tribalisme, mondialistes et souverainistes, riches et pauvres, hommes et femmes, ont été exacerbées par la polarisation politique.
Alors que le combat en Tunisie devrait être essentiellement vertical, c'est-à-dire celui du peuple pour la reconnaissance de ses droits inaliénables face aux injustices imposées par les puissants, le système génère au contraire des combats horizontaux (le peuple contre le peuple), qui détournent l'attention des priorités socio-économiques, creusent un fossé profond au sein de la société et renforcent la perte de cohésion nationale.
En 2021, plus de 70 % des enfants de 10 ans et 85% des moins de 25 ans, déclaraient envisager leur avenir hors de Tunisie, s'identifiant à des référents culturels de plus en plus détachés de notre matrice civilisationnelle et de notre histoire de pensée. Nos enfants ne rêvent plus de Tunisie, ni de héros tunisiens, à l'exception notable d'Ons Jabeur ou de quelques artistes issus de la scène rap. L'essentiel de l'imaginaire de nos enfants se construit sur des référentiels occidentaux ou du Moyen Orient !
3. Crise économique
L'absence de vision politique cohérente a empêché toute refonte du modèle productif devenu obsolète, freinant durablement l'investissement, l'innovation et le développement du tissu entrepreneurial.
Le taux de chômage en Tunisie demeure structurellement élevé. En 2025, il s'établit autour de 15,4 % au troisième trimestre, avec une pression particulièrement forte sur les jeunes de 15 à 24 ans, dont le taux de chômage dépasse 40 % (INS). Cette exclusion massive de la jeunesse du marché du travail constitue l'un des échecs les plus graves des politiques publiques menées depuis plus de deux décennies.
En parallèle, la croissance économique reste faible et insuffisante. Après une croissance annuelle limitée à 1,4 % en 2024, les projections macroéconomiques pour 2025 / 2026 tablent sur une croissance comprise entre 1,8 % et 2,4 %, selon les scénarios de référence des institutions nationales et internationales. Ce niveau demeure très en deçà du seuil nécessaire pour absorber le chômage, stabiliser les finances publiques et enclencher une véritable dynamique de création de valeur.
Sur le plan des finances publiques, l'endettement constitue désormais une contrainte centrale. La dette publique tunisienne atteint environ 85 % du PIB sur la période 2024–2025, avec une évolution particulièrement préoccupante de sa structure : la part de la dette intérieure dépasse désormais 58 % de l'encours total. Cette dynamique assèche l'épargne nationale, renchérit durablement le coût du crédit et comprime directement le financement de l'économie réelle.
Cette situation est aggravée par un constat beaucoup plus critique encore : Depuis 2011, le taux d'investissement global n'a jamais dépassé durablement 16 % du PIB, un niveau historiquement bas et incompatible avec les besoins réels du pays.
À ce niveau, l'investissement ne permet ni le renouvellement des infrastructures vieillissantes, ni leur adaptation aux chocs à venir. À titre de comparaison, les dégâts économiques liés au changement climatique sont aujourd'hui estimés à près de 10 % du PIB, entre stress hydrique, dégradation des infrastructures, pertes agricoles, pressions sanitaires et coûts énergétiques croissants. Autrement dit, une part significative de l'effort économique national est déjà absorbée par des pertes, alors même que l'investissement reste insuffisant pour prévenir, adapter ou reconstruire.
L'État se trouve ainsi enfermé dans une impasse structurelle : une capacité d'endettement désormais contrainte, un effort d'investissement trop faible pour préserver le capital existant, et une incapacité à enclencher une dynamique de croissance durable. Cette situation réduit drastiquement toute marge de manœuvre pour investir dans les secteurs structurants. Cette conjoncture économique dégradée, marquée par un chômage persistant, une croissance insuffisante, un endettement élevé et un sous-investissement chronique, agit comme un facteur aggravant direct des crises sanitaire, sociale, territoriale et écologique. Elle alimente un sentiment de déclassement généralisé et accélère la fuite des forces vives du pays, faute de perspectives économiques et collectives crédibles.
4. Crise sociale
La dégradation continue des conditions de vie a profondément fragilisé le corps social tunisien. Depuis 2011, la Tunisie connaît une succession quasi ininterrompue de mouvements sociaux, révélateurs d'un malaise structurel et durable. Les manifestations de 2018 contre la loi de finances, celles de 2020 et 2021 liées à l'austérité, au chômage et à la dégradation des services publics, ne constituent pas des épisodes isolés mais l'expression répétée d'une rupture entre l'État et une large partie de la population.
Cette crise sociale se traduit par un appauvrissement massif, une précarisation accélérée des classes moyennes et l'effondrement progressif des mécanismes de protection collective. Près de trois millions de Tunisiens vivent aujourd'hui dans la pauvreté et la précarité, tandis que les institutions sociales censées amortir les chocs ne remplissent plus leur rôle.
La Caisse nationale de sécurité sociale affiche un déficit structurel chronique, estimé à plus de 2,5 milliards de dinars, mettant en péril le paiement des pensions et la couverture sociale de millions de travailleurs. La CNRPS, de son côté, connaît une situation comparable, aggravée par le vieillissement démographique, l'informalité de l'emploi et l'érosion de l'assiette de cotisation.
L'un des marqueurs les plus alarmants de cette crise sociale est la désertification humaine des territoires. Depuis 2011, environ un million et demi de personnes ont quitté les régions de l'intérieur pour les zones côtières, la capitale ou l'étranger, laissant derrière elles des villes moyennes et des villages en voie d'abandon. Ce phénomène, pourtant largement documenté, traduit l'effondrement des perspectives économiques locales, l'absence de services publics et un sentiment d'abandon durable.
Si cette dynamique se poursuit, certaines projections estiment que jusqu'à 70 % du territoire national pourrait être quasiment vidé de toute présence humaine significative (et donc productive) à l'horizon 2030.
Cette fracture territoriale alimente l'exclusion sociale, l'économie informelle, la délinquance et la colère collective, renforçant un cercle vicieux dans lequel crise sociale, crise économique et crise politique se nourrissent mutuellement.
La crise sociale tunisienne ne se résume donc ni au chômage ni au pouvoir d'achat. Elle révèle un effondrement plus profond du contrat social, dans lequel l'État n'est plus en mesure de garantir la solidarité nationale, la protection des plus vulnérables ni la cohésion territoriale indispensable à la survie du système.
Ainsi dans notre lecture, la révolution de 2011 constitue le point de non-retour du système tunisien. Depuis ce tipping point, les déséquilibres sociaux ne peuvent plus être corrigés par des réformes ponctuelles ou sectorielles. C'est l'ensemble du système socioéconomique, dans ses fondements, ses mécanismes et ses finalités, qui doit être intégralement reconstruit.
5. Crise sanitaire
La crise sanitaire tunisienne ne se limite ni à la pandémie de Covid-19 ni à des dysfonctionnements ponctuels du système de soins. Elle est l'expression d'un effondrement progressif, profond et structurel du rapport entre l'État, la santé publique et la dignité humaine.
La gestion chaotique de la pandémie de Covid-19 a agi comme un révélateur brutal des fragilités accumulées depuis des décennies. Sous-investissement chronique, infrastructures hospitalières dégradées, pénurie de personnels soignants, gouvernance fragmentée et captation du système par des intérêts privés ont conduit à une incapacité manifeste à protéger la population. Selon l'OMS, la Tunisie a figuré parmi les pays africains les plus touchés en termes de mortalité rapportée à la population lors de la crise sanitaire.
Mais réduire la crise sanitaire tunisienne à la seule pandémie serait une erreur majeure. En réalité, cette crise est permanente et antérieure à 2020. En 2024, près de 58 % de la population ne dispose pas d'un accès effectif et continu à des soins de base, tandis que plus de 10 % des Tunisiens souffrent de troubles psychologiques graves, dans un contexte d'indifférence quasi totale des pouvoirs publics. Plus alarmant encore, 78 % des citoyens déclarent considérer comme « normal » de vivre avec une douleur, symptôme d'une banalisation collective de la souffrance et d'un renoncement progressif au droit fondamental à la santé.
Les indicateurs de santé publique confirment l'ampleur de l'effondrement. Près de trois quarts de la population adulte sont en surpoids ou en situation d'obésité, les taux de tabagisme, d'alcoolisation et de consommation de drogues sont en forte progression, et la Tunisie enregistre plus de 16 000 décès par cancer chaque année, avec des parcours de soins souvent tardifs, incomplets ou financièrement inaccessibles.
Cette crise sanitaire est indissociable de la crise sociale et économique. La pauvreté, le chômage, la précarité alimentaire, l'exode des médecins et des cadres de santé, ainsi que l'effondrement des caisses sociales, ont transformé la maladie en facteur supplémentaire de déclassement. Tomber malade en Tunisie est devenu, pour une part croissante de la population, un risque économique majeur, parfois irréversible.
Au-delà des chiffres, la crise sanitaire traduit une rupture anthropologique. Elle révèle un système qui n'assure plus la protection minimale de la vie, qui tolère la souffrance comme norme et qui a progressivement renoncé à sa responsabilité fondamentale envers le corps social.
Dans cette lecture, la crise sanitaire n'est ni conjoncturelle ni sectorielle. Elle est l'un des symptômes les plus visibles de l'effondrement du système socioéconomique tunisien, amorcé bien avant 2011 et accéléré depuis. Aucune réforme technique du secteur de la santé ne pourra suffire tant que le cadre global, les priorités politiques et le modèle de développement ne seront pas intégralement repensés.
6. Crise sécuritaire
La crise sécuritaire tunisienne est la conséquence directe de l'affaiblissement prolongé de l'État et de ses institutions régaliennes. Lorsque l'autorité politique se fragilise, lorsque la justice devient illisible et lorsque l'économie et la santé exclut massivement une partie de la population, les failles sécuritaires deviennent structurelles.
Les attentats du Bardo et de Sousse en 2015 ont marqué un point de bascule. Ils ont révélé l'ampleur des brèches sécuritaires, la porosité des frontières, en particulier avec la Libye, et l'incapacité de l'État à anticiper des menaces pourtant identifiées depuis plusieurs années. La circulation d'armes, de combattants et de réseaux criminels s'est inscrite durablement dans un espace régional instable, exposant la Tunisie à des risques sécuritaires permanents. (Même si la situation s'est fortement améliorée, les derniers rapports et alertes des instances internationales démontrent que le sujet reste d'actualité)
Mais la menace ne se limite plus au terrorisme. Elle s'est déplacée au cœur même du tissu social. En 2019, près de 200 000 crimes et délits ont été enregistrés, dont 73 % commis par des jeunes âgés de 15 à 19 ans, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Cette donnée traduit une génération en rupture, privée de perspectives économiques, éducatives et sociales, pour laquelle la violence devient un mode d'expression, de survie ou d'ascension sociale.
Depuis, la délinquance s'est diffusée sur l'ensemble du territoire. Vols, agressions, drogues, trafics, économie criminelle et violence urbaine se banalisent, alimentant un sentiment d'insécurité généralisé, aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales. De la Marsa aux quartiers périphériques, des centres urbains aux régions de l'intérieur, la peur s'installe comme donnée permanente du quotidien.
Cette insécurité a un impact économique direct et mesurable. Elle dissuade l'investissement, fragilise le tourisme (notamment saharien ou de montagne), renchérit les coûts de protection pour les entreprises et accélère la fuite des capitaux et des compétences. Elle renforce mécaniquement les crises économique et sociale, qui à leur tour alimentent la délinquance et la radicalisation, dans une boucle de dégradation continue.
La crise sécuritaire tunisienne n'est donc ni un simple problème de maintien de l'ordre ni une question exclusivement policière. Elle est le symptôme d'un système qui n'offre plus ni protection, ni justice, ni avenir. Tant que les causes profondes, politiques, économiques, éducatives, culturelles et sociales, ne seront pas traitées, aucune réponse sécuritaire, aussi répressive soit-elle, ne pourra restaurer durablement la sécurité ni la confiance des citoyens.
7. Crise judiciaire
La crise judiciaire tunisienne constitue l'un des piliers centraux de l'effondrement de l'État de droit. Elle ne relève ni d'une dérive récente ni d'un simple dysfonctionnement institutionnel. Elle est le produit d'un processus long, marqué par une politisation de la justice engagée sous le régime de Ben Ali et jamais réellement remise en cause, par une perte d'indépendance effective dans son fonctionnement, et par une rupture profonde entre l'institution judiciaire et la société qu'elle est censée protéger.
Depuis 2011, la justice tunisienne est prise en étau entre des injonctions politiques contradictoires, des pressions médiatiques, des règlements de comptes partisans et une incapacité chronique à se réformer de manière crédible. Les dossiers structurants de corruption, de contrebande, de financement illégal des partis politiques, de crimes économiques et ou écologiques majeurs ou d'assassinats politiques restent, pour une large part, non traités, enterrés ou instrumentalisés. Cette impunité prolongée a progressivement détruit la confiance des citoyens dans l'équité de la justice.
Parallèlement, les arrestations d'opposants politiques, de journalistes, d'avocats et d'acteurs de la société civile, ainsi que la fermeture ou la mise sous pression d'associations, de médias et de syndicats, ont marqué une dégradation nette de l'État de droit. Ces pratiques ont été dénoncées à plusieurs reprises par des organisations locales ou internationales de défense des droits humains, qui alertent sur l'usage extensif de l'appareil judiciaire à des fins de dissuasion politique. Cette justice perçue comme sélective, rapide pour certains, lente ou inexistante pour d'autres, nourrit le sentiment d'un système à deux vitesses.
Dans le même temps, l'institution judiciaire souffre de dysfonctionnements internes majeurs. Lenteur des procédures, manque de moyens, surcharge des tribunaux, absence de digitalisation réelle, flou juridique permanent et instabilité des cadres législatifs rendent l'accès à la justice long, coûteux et incertain. Pour une majorité de citoyens et d'entreprises, engager une procédure judiciaire relève davantage du pari que d'un droit effectif.
Cette crise judiciaire a des effets systémiques. Elle dégrade fortement notre image à l'international et auprès de nos partenaires stratégiques, décourage l'investissement, alimente l'économie informelle, renforce la corruption et affaiblit l'autorité de l'État. Elle contribue directement à la crise sécuritaire, en laissant prospérer les réseaux criminels, et à la crise sociale, en privant les citoyens de tout recours crédible face aux abus.
Plus grave encore, la crise judiciaire érode l'un des fondements essentiels de toute société viable : la croyance partagée dans la justice. Lorsque les citoyens ne croient plus à l'équité des règles, lorsque le droit n'est plus perçu comme un rempart mais comme une arme, le contrat social se délite et la violence devient, pour certains, une alternative perçue comme légitime. Aujourd'hui, comme l'ont souligné plusieurs députés tirant la sonnette d'alarme, nous faisons face à une situation inédite où l'État craint le peuple, tandis que le peuple craint la justice et l'état.
La crise judiciaire tunisienne est un symptôme central de l'effondrement du système politique et institutionnel. Tant que cette justice ne sera pas refondée sur des bases claires, indépendantes et légitimes, aucune réforme économique, sociale ou sécuritaire ne pourra produire d'effets durables.
8. Crise écologique
La crise écologique tunisienne n'est plus une menace future ni un sujet environnemental parmi d'autres. Elle constitue désormais un facteur direct d'effondrement économique, social et territorial, aggravé par l'absence persistante de politiques publiques cohérentes, anticipatrices et exécutées dans la durée. Alors même que les alertes sont documentées depuis des années, tant par des rapports internationaux, notamment ceux du GIEC, que par des études tunisiennes, les désastres humains et matériels provoqués par la tempête de janvier 2026 en constituent une illustration tragique et incontestable.
La Tunisie fait face à une dégradation accélérée de ses ressources naturelles. Les pénuries d'eau deviennent structurelles, les nappes phréatiques sont surexploitées et salinisées, les sols agricoles se dégradent, et l'avancée du désert menace directement près de 80 % du territoire national, selon les estimations de la FAO.
Il est essentiel de mesurer l'ampleur du phénomène en cours pour comprendre notre niveau de frustration face à l'inaction publique. Le désert progresse de plus d'un kilomètre par an dans plusieurs zones sahariennes. Les travaux prospectifs, notamment ceux du Shift Project et les simulations diffusées par Jean-Marc Jancovici, montrent que si les dynamiques actuelles se poursuivent, les dunes visibles aujourd'hui à Tozeur ou Douz pourraient atteindre les environs de Sfax en moins de deux siècles.
Cette pression environnementale affecte en priorité les régions de l'intérieur, accélérant l'exode rural, la perte de souveraineté alimentaire et la désertification humaine.
Parallèlement, l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière fragilisent les infrastructures littorales, alors même que près de 90 % des activités socioéconomiques du pays sont concentrées sur la bande côtière. Ports, zones industrielles, tourisme, habitat urbain et réseaux de transport sont exposés à travers un nombre restreint de villes, à des risques croissants, insuffisamment pris en compte dans les politiques d'aménagement et d'investissement.
Le coût économique de ces déséquilibres est déjà massif. Les pertes liées à la dégradation environnementale et au changement climatique sont estimées à environ 10 % du PIB, un niveau comparable à une crise économique permanente. La Banque mondiale alerte de son côté sur un scénario encore plus critique : en l'absence d'actions structurelles, les pertes pourraient atteindre 12 % du PIB d'ici 2030, soit l'équivalent du cout de la construction d'une ville nouvelle chaque année.
Cette crise écologique agit comme un multiplicateur de vulnérabilités. Elle renforce la crise sociale par la hausse des prix alimentaires et la précarisation des agriculteurs, alimente la crise économique par la perte de productivité et de compétitivité, accentue la crise sécuritaire par les tensions sur les ressources, et fragilise encore davantage la cohésion territoriale.
La crise écologique tunisienne révèle un modèle de développement à bout de souffle, incapable de préserver les conditions matérielles mêmes de la vie collective. Tant que l'environnement sera traité comme une variable d'ajustement et non comme un pilier stratégique de la souveraineté nationale, toute tentative de stabilisation économique ou sociale restera illusoire.
Une interdépendance systémique
Les crises que traverse la Tunisie ne sont ni indépendantes ni successives. Elles forment un système complexe interconnecté, dans lequel chaque crise alimente et renforce les autres, produisant une dynamique d'effondrement cumulative.
- La crise politique au sens large, engendre directement les crises institutionnelles, justice, instances démocratiques, partis politiques, représentativité, éducation, jeunesse, culture, handicap, diplomatie, ainsi que la crise économique, chômage, pauvreté. Ces dysfonctionnements nourrissent à leur tour la crise sociale, protestations, colère diffuse, perte de repères, laquelle accentue l'instabilité politique dans une boucle de rétroaction auto-entretenue.
- La crise sécuritaire prospère sur les failles institutionnelles et sur les frustrations socioéconomiques. Elle alimente l'extrémisme, la délinquance, la contrebande et la corruption, tout en affaiblissant davantage l'autorité de l'État et la confiance collective.
- La crise sanitaire, entendue au sens large, obésité, addictions, cancers, santé mentale, accès aux soins, délabrement des infrastructures, produit un désastre social massif. Son impact réel reste largement sous-estimé, alors même qu'elle accroît l'immigration clandestine, pèse lourdement sur l'économie et renforce la défiance envers les institutions politiques.
- La crise écologique, par ses répercussions économiques, alimentaires et territoriales croissantes, agit comme un multiplicateur. Elle accentue les fractures sociales et économiques et crée de nouvelles boucles rétroactives, à travers neuf vulnérabilités majeures identifiées et détaillées dans la suite de nos travaux.
Ces crises ne s'additionnent pas, elles se renforcent mutuellement, enfermant le pays dans une trajectoire de dégradation systémique.
Résoudre la crise politique pour briser le cycle
Cette dynamique démontre qu'une approche fragmentée, encore défendue par certaines élites qui attribuent chaque crise à des causes externes ou conjoncturelles, est structurellement inefficace. À la lumière des travaux de Edgar Morin sur la pensée complexe et des recherches du « Stockholm Resilience Centre » ou du « shift project », seule une approche systémique intégrée permet de traiter les causes profondes plutôt que les symptômes visibles.
La Tunisie ne pourra surmonter ses défis en traitant les crises une à une. Elles forment un tout cohérent dont la crise politique constitue le catalyseur central.
Tant que cette crise fondamentale ne sera pas résolue, par une refonte démocratique réelle des institutions, par l'affirmation d'une vision stratégique claire et par la construction d'un projet commun, aucune transformation durable ne sera possible.
Ainsi c'est par le débat public, la confrontation des idées, la tenue de conférences ouvertes et exigeantes et l'appropriation collective des enjeux que ce projet pourra s'ancrer durablement dans la société.
Les sciences systémiques montrent clairement que la sortie de crise ne peut être imposée d'en haut ni décrétée par des ajustements techniques. Elle repose sur une mobilisation collective structurée, capable de reconstruire à la fois la légitimité politique, la cohésion sociale et la capacité d'action de l'État.
C'est précisément l'ambition d'INTILAQ 2050 : proposer une approche holistique, rigoureuse et assumée, capable de briser le cycle de l'effondrement et de donner corps, de manière crédible et durable, aux aspirations nées de la révolution de 2011.
Arthur Keller : penser la résilience systémique
Énergie et Ressources
INTILAQ 2050 – La chaîne YouTube
Articles suivants (Ordre logique de lecture)
- All Post
- Actualités
- Articles
- Conférences et formations
- Humeurs
- La fondation
- La résilience
- La souveraineté
- La Tunisie éternelle
- Le manifeste
- Le plan de transformation
- Les essentiels
- Non classé
- Nos principes directeurs
- Nos vidéos
- Back
- Le modèle de gouvernance de l'état

L’analyse croisée des publications et commentaires publics sur le web entre 2018 et 2024, combinant techniques de scraping et analyse de tendances, met en évidence six préoccupations majeures et récurrentes au sein de la population tunisienne. Si leur hiérarchisation varie selon les périodes et les événements, ces préoccupations demeurent remarquablement...

Penser l’effondrement à travers des regards croisés : occidentaux et arabo-musulmans (Mise à jour Mars 2025) Depuis plusieurs décennies, les sciences sociales et la théorie des systèmes complexes se penchent sur la notion d’« effondrement ». Des analystes comme Dmitry Orlov ou Pablo Servigne proposent des approches détaillant les étapes de désintégration...