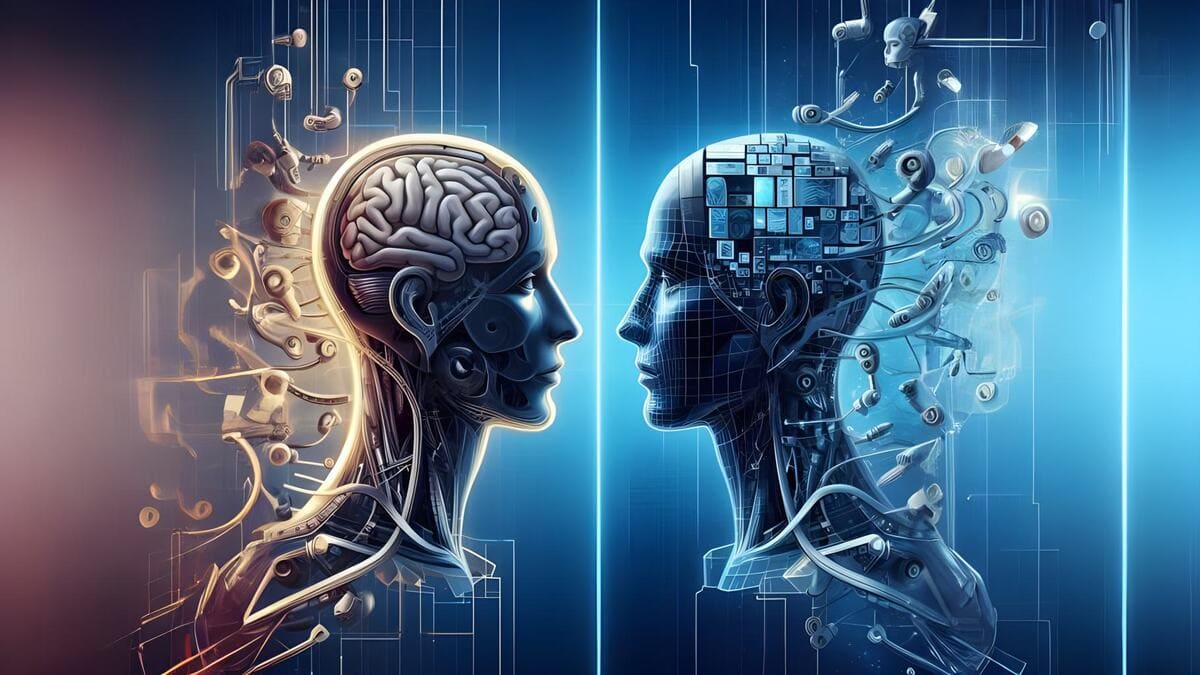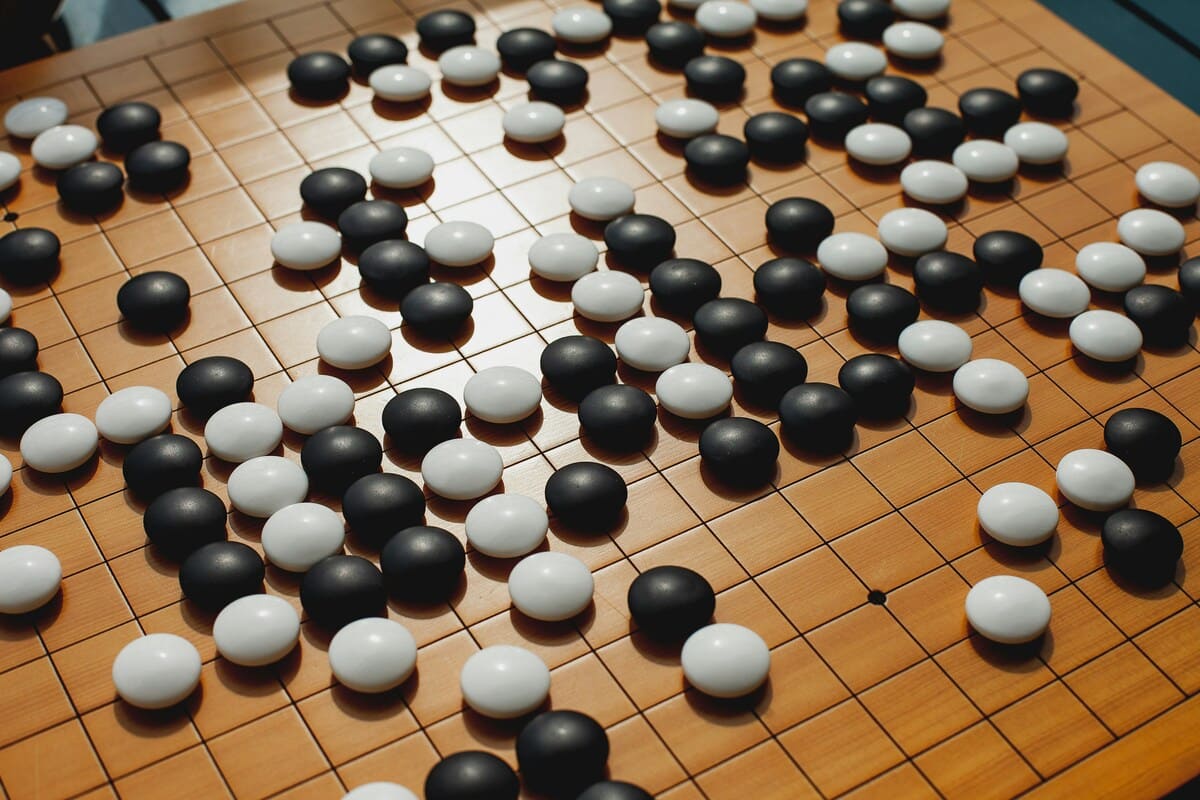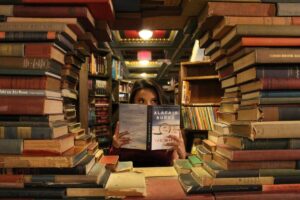Penser l’effondrement à travers des regards croisés : occidentaux et arabo-musulmans
(Mise à jour Mars 2025)
Depuis plusieurs décennies, les sciences sociales et la théorie des systèmes complexes se penchent sur la notion d’« effondrement ».
Des analystes comme Dmitry Orlov ou Pablo Servigne proposent des approches détaillant les étapes de désintégration d’un « système-nation », tandis que d’autres, tels que Jared Diamond ou Joseph Tainter, insistent sur le rôle des ressources et de la complexité sociale.
Bien avant eux, le monde arabo-musulman a produit ses propres réflexions sur la naissance et la chute des civilisations, à l’image de Ibn Khaldoun (1332-1406) ou Al-Farabi (872-950), qui décrivent chacun à leur manière la dynamique d’ascension et de déclin des sociétés.
Dans les lignes qui suivent, nous nous appuierons principalement sur l’analyse proposée par Dmitry Orlov pour comprendre comment un « système-nation » peut s’effondrer progressivement.
Nous la compléterons par d’autres références, occidentales et arabes, afin de dessiner un cadre comparatif qui éclaire de manière factuelle la situation de la Tunisie.
Les cinq phases d’effondrement selon Dmitry Orlov
Le chercheur Dmitry Orlov, célèbre pour ses analyses des dynamiques d’effondrement des systèmes socio-économiques, distingue cinq phases progressives qui caractérisent la désintégration d’un « système-nation ». Inspirées notamment par son observation de l’Union soviétique, ces étapes s’entrecroisent et se renforcent mutuellement, menant potentiellement à une rupture systémique :
Phase 01 : Effondrement financier
Le système financier devient insoutenable ; les banques peinent à survivre, l’accès au capital se raréfie et les placements financiers perdent brutalement leur valeur. Pour compenser, l’État s’endette lourdement ou recourt à la planche à billets, ce qui dévalue la monnaie et accentue la fragilité du pays.
- Exemples :
- Crise de 2008 aux États-Unis : Les faillites bancaires (Lehman Brothers) ont failli entraîner l’ensemble du secteur dans leur chute, et seules des interventions d’urgence de la Réserve fédérale ont évité un effondrement total. Cela s’est fait au prix d’une dette colossale et de conséquences à long terme (recul de la confiance dans les banques, inégalités renforcées).
- Argentine en 2001 : Les retraits bancaires ont été limités (le « corralito »), provoquant des émeutes et une perte totale de confiance dans la monnaie locale (peso).
- Référence : Orlov, D. (2011). The Five Stages of Collapse: Survivors’ Toolkit. New Society Publishers.
Phase 02 : Effondrement commercial
Les circuits d’approvisionnement s’effondrent, la monnaie se déprécie rapidement et l’inflation devient incontrôlable. Les prix des biens essentiels flambent, tandis que la contrebande et la corruption se transforment en mécanismes de survie.
- Exemples :
- Venezuela sous Nicolás Maduro : L’hyperinflation a rendu le bolívar pratiquement inutilisable, et l’approvisionnement en nourriture et en médicaments s’est largement déplacé vers le marché noir.
- Ex-URSS dans les années 1990 : Après l’effondrement soviétique, l’économie de troc et le marché gris ont explosé, remplaçant partiellement les circuits commerciaux officiels en panne.
- Référence : Servigne, P., & Stevens, R. (2015). Comment tout peut s’effondrer : Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes. Seuil.
Phase 03 Effondrement politique
Le gouvernement perd sa légitimité et son autorité, incapable de maintenir les institutions, la sécurité ou de fournir des services de base. Des entités non étatiques (cartels, mafias, groupes extrémistes, forces étrangères) comblent alors le vide de pouvoir dans des ingérences généralisées.
- Exemples :
- Somalie après la chute de Siad Barre (1991) : Le pays s’est morcelé entre seigneurs de guerre et milices rivales, alors que l’autorité centrale ne pouvait plus garantir l’intégrité territoriale ni assurer la sécurité.
- Yougoslavie dans les années 1990 : Les tensions ethniques, le manque de légitimité du pouvoir central et l’explosion de conflits régionaux ont abouti à la désintégration de l’État. (l’ensemble étant bien sur organisé par la CIA dans le cadre de ses pseudos révolutions colorées)
- Référence : Orlov, D. (2013). The Five Stages of Collapse. New Society Publishers.
Phase 04 : Effondrement social
L’État, déjà en crise, abandonne ses missions essentielles de protection et de soutien. Les structures sociales, qu’elles soient caritatives ou mutualistes, se désagrègent sous la pression. La pauvreté se généralise, la détresse psychologique augmente et les pathologies sociales (criminalité, addictions) s’intensifient.
- Exemples :
- Grèce durant la crise de la dette souveraine (2010-2015) : La réduction drastique des dépenses publiques a entraîné la fermeture d’hôpitaux, l’explosion du chômage et une hausse notable des taux de suicide. Des réseaux de solidarité informels (cuisines collectives, dispensaires bénévoles) ont dû suppléer l’État défaillant.
- Irak post-2003 : Après l’intervention militaire et la chute de Saddam Hussein, l’effondrement politique a vite engendré un vide social (services publics démantelés, migrations massives, recrudescence de la criminalité).
- Référence : Servigne, P., Stevens, R., & Chapelle, G. (2018). Une autre fin du monde est possible : Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre). Seuil.
Phase 05 : Effondrement culturel
Les valeurs collectives (solidarité, honnêteté, bienveillance) se délitent, laissant place à la méfiance et à l’individualisme. L’identité nationale se fracture, favorisant les tensions, les émeutes ou le terrorisme. La peur et la violence deviennent le nouveau mode de régulation sociale.
- Exemples :
- Liban : Après des décennies de guerre civile et de crises économiques, le pays fait face à une fragmentation culturelle et communautaire profonde, où les projets de réforme collective sont quasi impossibles.
- Exemple plus lointain : Au sein de l’Empire romain tardif, le sens de la « romanité » s’est étiolé, multipliant les allégeances rivales, jusqu’à ce que l’entité politique s’effondre totalement en Occident.
- Référence : Orlov, D. (2011). The Five Stages of Collapse: Survivors’ Toolkit. New Society Publishers.
L’effondrement comme processus, selon Orlov et Servigne
Dmitry Orlov et Pablo Servigne (figure de la « collapsologie » en France) insistent sur le fait que l’effondrement n’est pas un état figé mais une dynamique lente et progressive qui reconfigure profondément les fondements d’une société. Des pays comme la Grèce ou le Liban en offrent des exemples concrets : leurs territoires et leurs peuples n’ont évidements pas disparus, mais leurs systèmes (financiers, politiques, sociaux) ont perdu leur capacité à répondre aux besoins de la population et se sont donc effondrés.
La théorie des systèmes complexes renforce cette idée
Si l’on considère la Tunisie comme un système thermodynamique complexe, alors les principes de modélisation de ces systèmes (interaction des agents, rétroactions, dépendance aux conditions initiales) s’appliquent directement à notre trajectoire nationale.
Dès l’indépendance de 1956, le pays reposait sur un ensemble d’« équilibres initiaux » (ressources disponibles, croissance démographique maîtrisée, exportation de pétrole, contexte mondial peu concurrentiel). Or, la plupart de ces conditions ont disparu ou se sont même inversées : la population a explosé, la rente pétrolière a disparu, la mondialisation et l’endettement ont fragilisé notre souveraineté économique, culturelle et sociale. Le résultat est mesurable mathématique par l’historique de nos principaux indicateurs socioéconomiques : le « système-Tunisie » a amorcé, dès 2004, un effondrement lent et continu, illustré aussi par les émeutes du bassin minier en 2007, la révolution de 2011 et la dissolution du parlement en 2021 par le président Kaïs Saïed.
Malgré ces secousses, les politiques publiques mises en œuvre depuis 2011 n’ont visé qu’un seul objectif : sauver le système existant, sans jamais créer de véritable rupture. Kaïs Saïed, pour sa part, conteste à raison ce système, mais n’a pas encore proposé d’alternative pertinente s’appuyant sur un nouveau référentiel. Or, la théorie des systèmes complexes montre qu’une fois le point de non-retour franchi (ici, la révolution de 2011), la seule voie de sortie réside dans la construction d’un nouveau système, adossé à de nouvelles conditions d’initialisation (un contexte local, régional et mondial désormais totalement différent de celui de 1956).
Une lecture arabo-musulmane de l’effondrement : Ibn Khaldoun, Al-Farabi et la dynamique des civilisations
Bien avant Orlov, Tainter ou Diamond, le penseur Ibn Khaldoun (1332-1406), père de la sociologie moderne, a analysé le cycle d’ascension et de déclin des civilisations dans sa Muqaddima.
Pour Ibn Khaldoun, toute dynastie ou système de pouvoir se construit d’abord sur la cohésion (ʿasabiyya), s’institutionnalise progressivement, puis sombre dans la décadence lorsque le luxe, la corruption et l’inertie bureaucratique prennent le pas sur la solidarité initiale.
- Exemple historique (dynastie hafside ou abbasside) : Ibn Khaldoun mentionne le délitement de certaines dynasties en Ifriqiya et au Levant, où la perte du sens collectif a facilité les invasions extérieures et les guerres civiles.
- Leçon essentielle : Sans justice redistributive ni solidarité active, l’État se coupe de sa base sociale et s’écroule.
Dans la lignée d’Ibn Khaldoun, Al-Farabi (872-950), philosophe et théoricien du politique, suggère qu’un « ordre vertueux » repose sur l’adéquation entre l’éthique, la connaissance et une gouvernance juste. Quand cette harmonie se rompt, la cité se dirige vers le chaos : le pouvoir se concentre entre les mains d’élites motivées par l’intérêt personnel, et le corps social se fragmente.
Ces penseurs démontrent que l’effondrement n’est ni un hasard ni une pure fatalité, mais le résultat d’un déséquilibre progressif des valeurs, de la morale et des structures institutionnelles.
En proposant d’anticiper et de corriger les dérèglements sociaux et politiques, ils rejoignent, par avance, les conclusions d’auteurs contemporains comme Orlov ou Servigne : la clé pour éviter l’effondrement réside dans la capacité d’une société :
- à comprendre les paramètres stœchiométriques (et thermodynamiques) qui structurent ses fondations,
- à maintenir la cohésion, la justice, l’inclusion et le partage,tout en restant réactive aux évolutions nécessaires pour relever les défis posés par l’avenir.
Application à la Tunisie : une série d’effondrements historiques
L’histoire de la Tunisie peut s’éclairer sous l’angle d’une succession d’« effondrements » au sens d’Orlov, chaque effondrement marquant la fin d’un système de gouvernance ou d’organisation sociale et l’émergence d’un nouveau cadre institutionnel.
Le Beylicat
- Contexte : Héritier de la dynastie husseinite, le Beylicat subit la tutelle économique des puissances européennes au XIXᵉ siècle. L’endettement massif, la pression fiscale et les traités inégaux précipitent sa faillite. (L’escroquerie Rothschild / Baron d’Erlanger)
- Signes d’effondrement : Incapacité à rembourser la dette, révoltes populaires, mise sous tutelle financière (1869).
- Issue : En 1881, le Traité du Bardo instaure le Protectorat français, mettant fin de fait à l’autonomie du Beylicat.
Le Protectorat français (1881 – 1956)
- Contexte : La France administre directement la Tunisie, tout en maintenant formellement un Bey. Les ressources du pays sont exploitées pour la métropole, tandis qu’un mouvement nationaliste grandit progressivement.
- Signes d’effondrement : Montée des revendications indépendantistes (Destour, puis Néo-Destour), marginalisation économique des populations locales.
- Issue : L’indépendance de 1956 met fin au Protectorat et ouvre la voie à un nouveau système, celui de la Tunisie moderne sous Bourguiba.
Le système Bourguiba (1956 – 1987)
- Contexte : Habib Bourguiba met en place un État centralisé et modernisateur (Code du statut personnel, éducation de masse).
- Signes d’effondrement : Crises économiques mondiales (années 1970), vieillissement du leader, autoritarisme et répression des opposants.
- Issue : En 1987, Zine El Abidine Ben Ali destitue Bourguiba lors du « changement du 7 novembre », officialisant la fin de ce système.
Le système Ben Ali (1987 – 2011)
- Contexte : Promesses initiales d’ouverture démocratique, rapidement transformées en autoritarisme policier, avec un fort contrôle des médias et une économie libéralisée mais gangrenée par la corruption et le népotisme.
- Signes d’effondrement : Une société verrouillée : inégalités sociales criantes, jeunesse marginalisée, société civile muselée. L’économie est captée par un cercle restreint d’alliés du régime qui agissent en tandem avec des lobbies et des forces étrangères.
- Issue : Les émeutes du bassin minier de Gafsa (2007), réprimées dans le sang, annoncent la fracture. La révolution éclate en 2011, après l’immolation de Mohamed Bouazizi (et l’aide de quelques forces étrangères parfaitement identifiées). Le régime s’effondre brutalement, ouvrant la séquence instable qu’on appellera « transition post-révolution » ou plus communément « Open Bar, servez vous, le peuple paiera l’adition ! » .
Le système « post-révolution »
- Contexte : Les services Anglo-Otaniens, imposent un régime parlementaire et une politique des quotas pour la nomination des ministres, ceci afin de neutraliser toute réelle démocratie et d’éviter la perte de contrôle au profit de la fameuse « Rue Arabe » qui fait tant peur à l’Occident. Nouvelle Constitution en 2014, élargissement des libertés publiques certes, mais avec des alternances politiques sans propositions, fondées sur des alliances contre-nature, financées évidement de l’étranger, qui neutralisent les rares personnalités sincères, isolées et sans moyens. La stratégie Américaine de « l’Islamic Green Belt » est un succès en Tunisie et ouvrira la porte à l’effondrement de l’ensemble des nations arabes Laïc ! BHL et les néoconservateurs américains, applaudissent haut et fort !
- Signes de fragilité : Instabilité gouvernementale, endettement croissant, absence d’un projet national unificateur, corruption politique généralisée, méfiance vis-à-vis de la classe politique dans son ensemble.
- Enjeu : Un système clairement effondré, dans une phase critique marquée par l’incapacité à apporter des solutions durables qui réinitialise le système.
Le système « État profond »
- Contexte : Héritage direct d’un appareil bureaucratique centralisé, forgé sous le protectorat et consolidé par les régimes post-indépendance. Administration verrouillée, réseaux sécuritaires opaques, logiques clientélistes enracinées, ingérences occultes externes et internes systématiques à tous les niveaux.
- Signes d’un effondrement en cours : Crises budgétaires chroniques, perte de légitimité, pression croissante pour la transparence. L’ancien système résiste, mais il craque de partout. L’arrivée de Kaïs Saïed est l’un des signes de cet effondrement inéluctable, même si pour l’instant, rien n’a véritablement changé.
- Perspectives : S’il s’effondre sans alternative claire, cela provoquera le chaos. Mais s’il est démantelé méthodiquement, la Tunisie pourra rebâtir un État légitime et fondé sur l’intérêt général.
Analyse actuelle de la Tunisie : la grille « Khaldounienne » appliquée
En appliquant la vision d’Ibn Khaldoun, on constate que la ‘asabiyya (cohésion sociale) qui caractérisait le mouvement nationaliste pré-indépendance a progressivement laissé place à une fragmentation croissante.
Chaque nouveau système post-indépendance a reposé sur une forme réelle de légitimité initiale (charisme de Bourguiba, promesses démocratiques de Ben Ali, espoir révolutionnaire de 2011, soutien massif de 98% de la population à la chute du parlement par Kais Said en 2021).
Cependant, à mesure que ces régimes s’institutionnalisaient, les valeurs initiales (solidarité, justice, éthique, transparence, démocratie) se sont érodées, ouvrant la voie à la l’absence de résultat, la corruption, au népotisme et à l’accaparement des ressources par une minorité qui pour l’essentiel est en réalité toujours la même depuis le Beylicat.
Symptômes contemporains :
- Dilution du sentiment d’unité nationale,
- Crises économiques récurrentes et qui s’aggravent à chaque cycle,
- Désaffection massive de la jeunesse (émigration, abstention électorale),
- Incapacité à faire respecter l’État de droit y compris pour les magistrats ou la police.
Ce constat rejoint l’analyse d’Orlov selon laquelle la Tunisie présente déjà des signes d’effondrement progressif, amorcé en 2004 et franchissant un point de non-retour en 2011 :
- Effondrement financier : Endettement croissant, dévaluation du dinar, difficulté d’accès aux marchés.
- Effondrement commercial : Pénuries sporadiques (produits de base), économie informelle en forte expansion au détriment de l’économie légale.
- Effondrement politique : Instabilité des gouvernements, défiance générale envers les partis.
- Effondrement social : Montée de la pauvreté, services publics en crise, jeunesse désabusée.
- Effondrement culturel : Fractures identitaires et régionales, sentiment d’abandon, hausse de la délinquance, drogue, alcool, délitement du langage courant et des règles de vie commune.
Recommandations croisées : Orlov, Servigne, Ibn Khaldoun…
- Pour Dmitry Orlov, l’idée force est de relocaliser et de construire des poches de résilience à l’échelle locale (autonomie alimentaire, coopératives, réseaux d’entraide).
- Pour Pablo Servigne, la clé réside dans l’entraide et la sobriété, afin de renforcer la capacité d’une société à encaisser des chocs.
- Pour Ibn Khaldoun, la cause première de l’effondrement est la perte de la ‘asabiyya, c’est-à-dire la cohésion sociale et le souci du bien commun. Il recommande de maintenir une forme d’équité et de solidarité pour assurer la pérennité du pouvoir politique.
Concrètement :
- Restaurer la confiance par la justice et la lutte contre la corruption (Ibn Khaldoun).
- Développer des mécanismes d’entraide et de gouvernance participative (Servigne).
- Favoriser la décentralisation et l’autonomie locale pour réduire la vulnérabilité systémique (Orlov).
Recommandations INTILAQ 2050 (exemples)
Notre projet INTILAQ 2050 s’inscrit dans cette logique de convergence entre l’approche de la résilience locale et la préservation de la cohésion nationale. Parmi les pistes proposées :
1.Cryptomonnaie du grand Maghreb élargi
- Basée sur un panier de ressources tangibles (blé, phosphate, sable) pour garantir une forme de stabilité et réduire la dépendance vis-à-vis des monnaies internationales.
- S’inspire de la « décentralisation monétaire » suggérée par Orlov, tout en veillant à maintenir une solidarité maghrébine (notion élargie de la ‘asabiyya à l’échelle régionale).
2.Coopératives de production et de distribution
- Garantir la sécurité alimentaire en créant des filières complètes (semences, production, transformation, distribution) localisées dans chaque région.
- Les coopératives deviennent des pôles de cohésion (Ibn Khaldoun) et de sobriété (Servigne), capables de résister aux chocs exogènes.
3.Création de Bio Territoires
- Basées sur la définition des fonctionnalités régionales : agriculture biologique, écotourisme, énergies renouvelables, etc.
- Relocaliser l’économie et renforcer la résilience dans l’esprit des travaux d’Orlov (réduction des interdépendances globales).
4.Énergies renouvelables fabriquées en Tunisie et décentralisées
- Pallier les faiblesses du réseau national, limiter la dépendance énergétique et dynamiser la production locale (investissements « made in Tunisia » : énergie solaire à concentration, vapo-formatage de méthane, éoliennes en bois, coopératives de micro-hydraulique, parc énergétique communautaire pour les terres tribales (Hbous), etc.).
- Aligner la modernité technologique sur la souveraineté économique, l’utilisation de nos ressources, nos compétences régionales et le respect de l’environnement.
5.Normalisation des habitations
- Obligation de collecter l’eau, d’isoler, de doter chaque foyer d’équipements solaires.
- Stockage de l’énergie dans les batteries des véhicules électriques permettant aux citoyens de revendre le surplus d’énergie (on charge le jour, on vend la nuit).
- Approche combinée d’efficacité énergétique (Servigne) et de solidarité institutionnelle (prêts à 1% pour l’amélioration de l’habitat, financés par notre nouveau fond souverain, la taxe de 1% sert à financer la transformation énergétique des biens communs comme pour l’éclairage urbain solaire ou les parkings couverts de panneaux solaires).
- Routage des taxes sur les hydrocarbures vers l’innovation énergétique « Made in Tunisia »
6.Systèmes solidaires
- Entraide, mutualisation des moyens, micro-crédits citoyens, création de fonds de crise régionaux.
- Permettre un filet de sécurité local lorsque l’État central est défaillant, tout en renforçant les liens de proximité (élément clé de la ‘asabiyya).
7.Préparation psychologique et sociale
- Affronter les possibles ruptures de la chaîne d’approvisionnement ou les bouleversements politiques en développant la culture du « changement permanent » et des plans de continuité d’activité (pouvant s’inspirer de la résilience post-catastrophe au Japon, en Suède ou au Maroc).
- Former des « cellules de crise régionales » capables de gérer rapidement les aléas (façon Orlov), en préservant la cohésion de la communauté (vision Ibn Khaldoun).
8.Renforcement du sentiment d’appartenance
- Valoriser l’histoire commune (Beylicat, luttes de libération, soulèvements populaires) pour restaurer la fierté collective et éviter l’effondrement culturel.
- Relire les penseurs arabo-musulmans et promouvoir les figures tunisiennes (Ibn Khaldoun lui-même, Ibn Al Jazzar, Ons Jabeur, scientifiques et artistes locaux, les startuppers ayant réussis (Instadeep, Expensia, Bako Motors, Cumulus, etc..), pour refonder une ‘asabiyya moderne.
La question cruciale qui définira notre avenir commun
Depuis 2011, la Tunisie fait face à une question cruciale : quel nouveau « système » pour remplacer celui qui s’effondre ? Jusqu’ici, ni la classe politique ni les intellectuels n’ont su traiter ce sujet, certains affirmant encore (comme la ministre de l’Économie en 2024) que le système existant permettra de construire la Tunisie de demain ou qu’il n’existe pas d’effondrement.
Il est important de comprendre que, selon Orlov et Servigne, l’effondrement ne signifie pas la fin d’une nation ou d’un peuple, mais l’altération progressive et la désintégration de ses structures fondamentales. Dans la perspective d’Ibn Khaldoun, il se traduit par la perte de la cohésion sociale et la montée de la corruption institutionnelle.
Ainsi, la Tunisie, déjà marquée par plusieurs effondrements historiques (Beylicat, Protectorat, système Bourguiba, système Ben Ali, système « post-révolution »), se retrouve aujourd’hui à un tournant majeur :
- Soit, nous parvenons à bâtir ensemble un nouveau système, répondant aux défis contemporains (emploi, stabilité, justice sociale, gouvernance transparente) et soutenu par la population,
- Soit, la spirale de l’effondrement se poursuivra, laissant place à la précarité, à la fragmentation et à la domination de forces d’ingérence, externes ou internes, qui nous imposeront encore une fois, un nouveau système loin de nos intérêts et de nos aspirations.
Le projet INTILAQ 2050 incarne une proposition concrète pour une refondation en profondeur. Il reste cependant indispensable que cet élan s’accompagne d’une réflexion globale, d’une volonté politique solide et d’une mobilisation citoyenne : c’est à cette condition que nous pourrons créer les bases d’une « réinitialisation » soutenable, adaptée aux réalités actuelles, aux défis de demain, tout en s’appuyant sur l’histoire, la culture et les aspirations profondes de notre peuple et de notre nation, la Tunisie.
Références
- Orlov, D. (2011). The Five Stages of Collapse: Survivors’ Toolkit. New Society Publishers.
- Orlov, D. (2013). The Five Stages of Collapse. New Society Publishers.
- Servigne, P., & Stevens, R. (2015). Comment tout peut s’effondrer : Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes. Seuil.
- Servigne, P., Stevens, R., & Chapelle, G. (2018). Une autre fin du monde est possible : Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre). Seuil.
- Diamond, J. (2005). Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Viking Press.
- Tainter, J. A. (1988). The Collapse of Complex Societies. Cambridge University Press.
- Ibn Khaldoun (XIVᵉ siècle). Al-Muqaddima.
- Al-Farabi (IXᵉ-Xᵉ siècles). Al-Madina al-fadila (La cité vertueuse).
Articles suivants (Ordre logique de lecture)
- All Post
- Actualités
- Article
- Humeurs
- La fondation
- La résilience
- La souveraineté
- La Tunisie éternelle
- Le manifeste
- Les essentiels
- Non classé
- Nos principes directeurs
- Back
- Le modèle de gouvernance de l'état

Dans le tumulte de l’histoire, certaines nations semblent vouées à répéter un cycle implacable : un système politique se forge, se consolide, puis, imperceptiblement, génère les conditions de son propre effondrement. La Tunisie, berceau des civilisations et carrefour de la Méditerranée, n’échappe pas à cette implacable dynamique. Au cœur de...

Notre contre mesures pour réagir face à l’effondrement du système en place Nous détaillerons dans un article dédié notre vision de ce que nous appelons « la fondation de nos rêves », déjà évoquée dans plusieurs de nos publications. Mais dès à présent, nous pouvons en préciser l’ambition centrale :...