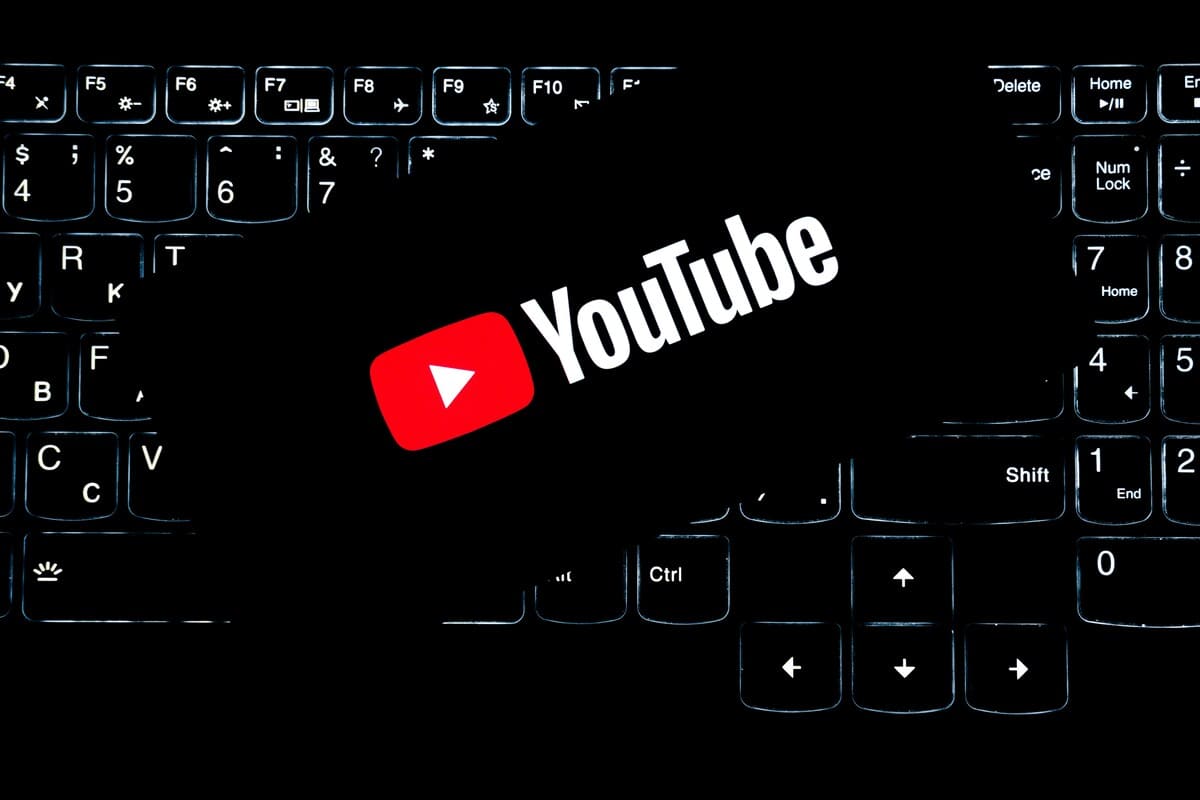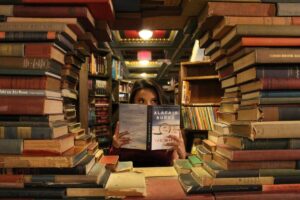Le cri du cœur d’une société en détresse !
(Maj, Mars 2025). L’analyse croisée des publications et commentaires sur le web entre 2018 et 2024 révèle six préoccupations majeures et récurrentes au sein de la population tunisienne (scrapping web des commentaires + analyse de tendances). Bien que leur importance relative fluctue selon les années, ces thèmes demeurent irrémédiablement constants, reflétant des frustrations profondes et persistantes.
De plus nos entretiens réalisés à travers le pays, de Carthage à Sfax, en passant par Tataouine, Makthar et Bizerte, confirment de manière surprenante, que ces inquiétudes transcendent les classes sociales, les niveaux d’éducation et les régions.
Contrairement à toute la classe politique, souvent perçues comme déconnectées, les citoyens tunisiens eux, partagent une vision claire et commune de leurs aspirations, ancrée dans l’imaginaire d’une Tunisie idéale et pragmatique. Cette convergence d’attentes, à la fois simples et réalistes, amplifie l’exaspération face à l’effritement de la classe politique et à l’incapacité des élites à répondre à leurs besoins.
Le travail : un avenir confisqué
Le chômage et la peur de perdre son emploi, avec l’angoisse de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille.
Le chômage ronge la société tunisienne, en particulier les jeunes. En 2023, le taux officiel atteint 15,3 %, mais il bondit à 30 % pour les moins de 30 ans selon l’Institut National de la Statistique (INS, Rapport 2023). Dans un contexte économique stagnant, la croissance reste limitée, les opportunités se font rares.
Mohamed, 28 ans, diplômé en ingénierie, témoigne : « J’ai envoyé 200 CV, rien. On me dit de partir en Europe, mais je veux vivre chez moi. »
Ce désespoir conduit des milliers de jeunes à l’exil ou à l’abandon. En 2024, les chiffres restent alarmants, avec un taux de chômage à 15,1 % (INS, 2024), soulignant l’urgence d’une relance économique, qui ne semble pas prête d’arriver tant que le système en place ne sera pas réellement remis cause. Il suffit pour cela de voir les analyses stratégiques de l’état y compris en 2024 pour voir qu’elles confortent et renforcent ce système qui détruit, lentement mais sûrement, les fondements mêmes de la nation.
Le pouvoir d’achat : une lutte quotidienne
Le niveau de vie et le coût de la vie, avec la peur de ne plus pouvoir assurer les études des enfants, rembourser les crédits ou payer le loyer.
L’inflation persistante en Tunisie continue de peser lourdement sur le pouvoir d’achat des citoyens. En 2023, le taux d’inflation s’élevait à 9,3 %, avec une augmentation de 12 % des prix des produits alimentaires, selon le rapport annuel de la Banque Centrale de Tunisie. Cette tendance s’est poursuivie en 2024, bien que l’inflation ait légèrement ralenti pour atteindre 7 % sur l’ensemble de l’année, selon l’Institut National de la Statistique (INS). Une baguette de pain coûte désormais 0,250 TND contre 0,190 TND en 2018, tandis que le salaire minimum reste bloqué à 450 TND/mois.
Fatima, mère célibataire à Kairouan, confie : « Mes enfants me demandent du poulet, je leur donne des pâtes. Je pleure en cachette. »
Cette érosion du pouvoir d’achat creuse les inégalités et attise la colère. En 2025, cette situation persiste, maintenant les familles sous pression.
La justice : une équité bafouée
La lutte contre la corruption, la fin du « deux poids, deux mesures », des lois archaïques et des procédures interminables, ainsi que la transparence et l’équité pour tous.
La corruption et le favoritisme sapent la confiance des citoyens. En 2023, la Tunisie se classe 70e sur 180 dans l’Indice de perception de la corruption (Transparency International, score de 44/100), marquant un recul par rapport à 2011 (59/100).
Les scandales, comme les détournements dans le secteur public dénoncés par l’ONG I Watch en 2023, révoltent toujours la population.
Ahmed, commerçant à Sfax, déclare : « Si t’as un piston, t’as tout. Sinon, t’es mort. »
Les Tunisiens réclament une justice impartiale, loin des privilèges réservés à une élite. Les réformes judiciaires entamées en 2023, comme la révision du code pénal, restent largement insuffisantes pour restaurer la foi en l’État.
La sécurité : entre peur et désarroi
La sécurité des biens et des personnes, la peur du terrorisme, l’application de la loi et la lutte contre les abus de pouvoir.
Malgré une diminution des attentats depuis 2015, l’attaque près de la synagogue de Djerba en mai 2023 (2 morts, ministère de l’Intérieur) ravive les craintes liées au terrorisme. Par ailleurs, la criminalité juvénile explose : 73 % des 200 000 crimes enregistrés en 2019 impliquent des adolescents (ministère de l’Intérieur, Statistiques 2019).
Leila, mère à Tunis, avoue : « J’ai peur pour mes fils, dehors ou à la maison. Où est l’État ? » « Les Tunisiens aspirent à la paix, pas à l’insécurité ».
En 2024, les tensions persistent, notamment aux frontières avec la Libye, où le trafic d’armes entretient l’instabilité (ONU, Rapport 2024). De la Marsa jusqu’aux villages les plus reculés de nos régions, nul ne se sent véritablement en sécurité, face à une délinquance de plus en plus endémique et violente qui envahit le quotidien des citoyens..
L’administration : un mur infranchissable
Le fonctionnement de l’État et de ses instances, perçu comme un frein par les citoyens et les entreprises.
La bureaucratie entrave le quotidien. Selon le Rapport Doing Business 2022 de la Banque mondiale, 78 % des entreprises tunisiennes considèrent l’administration comme un obstacle majeur. Obtenir un permis ou un certificat peut prendre des mois, décourageant citoyens et investisseurs.
Karim, entrepreneur à Bizerte, ironise : « J’ai attendu six mois pour une autorisation. Pendant ce temps, mon projet est mort. »
Cette inertie paralyse le développement et exaspère. Des tentatives de digitalisation des services publics ont vu le jour en 2016 puis en 2023, mais elles restent limitées, incomplètes et peu accessibles. En réalité, des procédures « soviétiques » même digitalisées restent « soviétiques » et « kafkaïennes ». Le vrai enjeu n’est pas de les digitaliser, mais de les supprimer massivement, tant elles relèvent d’une logique administrative et organisationnelle obsolète.
La vérité : un besoin viscéral
Exigence de vérité et de transparence sur les sujets sensibles.
Les Tunisiens veulent TOUJOURS des réponses sur des dossiers brûlants : La réalité de la révolution, le financement des partis politiques, les assassinats politiques, comme celui de Chokri Belaïd en 2013, la gestion opaque des finances publiques, la corruption, la contrebande et les réseaux terroristes. Selon l’Arab Barometer (2022), 65 % des Tunisiens ne font plus confiance aux institutions.
Amina, militante à Sousse, résume : « On veut la vérité, pas des mensonges pour protéger les puissants. »
Cette quête de transparence est un cri pour la dignité. En 2024, les promesses de réformes, comme la loi sur l’accès à l’information, tardent à se matérialiser.
Une préoccupation transverse : les comportements et la gestion du bien commun
À travers ces échanges, une septième préoccupation émerge, transversale et omniprésente : les comportements face au bien commun.
Les Tunisiens semblent pris dans une forme de schizophrénie collective. À l’échelle individuelle, ils entretiennent leurs maisons et jardins avec soin, planifient l’avenir de leurs enfants, épargnent, investissent. Mais dès qu’ils sortent de leur sphère privée, cette rigueur s’évapore : non-respect du code de la route, dépôts sauvages d’ordures, dégradation des infrastructures publiques, agressivité à la moindre contrariété.
À titre d’illustration, près de 450 000 constructions illégales ont été recensées entre 2012 et 2022 selon les autorités locales, représentant jusqu’à 80 % du bâti dans certaines communes. Ce taux d’informalité reflète un rejet latent de la règle commune.
Dans le même esprit, le citoyen tunisien dénonce la corruption… mais propose spontanément un billet à un agent sans qu’il ne l’ait demandé. Il contourne les procédures via ses relations, évite systématiquement les taxes et les impôts, tout en exigeant un État efficace, juste et moderne.
Ce paradoxe entre vouloir un État « civilisé » sans s’y conformer, illustre une contradiction culturelle profonde, résumée par un adage devenu système de pensée : « Les autres d’abord… et après moi, le déluge ».
Cette dualité comportementale affaiblit la confiance collective, fragilise le contrat social, et sabote toute tentative sérieuse de réforme.
Les aspirations des tunisiens et tunisiennes
Des rêves simples et universels : Au-delà de ces frustrations, les citoyens, de Tunis à Tataouine, portent une vision commune bien plus cohérente que celle des élites déconnectées. Voici ce qui les anime :
- Organisation de la cité et vivre-ensemble : Tous âges et conditions confondus, les Tunisiens rêvent d’une « nation civilisée ». Loin de fantasmer Dubaï ou Singapour, ils veulent un État qui assure des services publics efficaces (éducation, santé, sécurité), entretient les infrastructures et promeut le respect des règles, comme le code de la route ou l’urbanisme. Les jeunes, notamment les femmes, expriment un fort désir d’autonomie. Plusieurs enquêtes (PNUD, OCDE, 2022-2023) montrent une nette évolution vers des aspirations individuelles plus affirmées et un rejet du conservatisme traditionnel.
- Appartenir au monde : L’accès à des plateformes comme PayPal (toujours inaccessible en 2024), Netflix, Amazon, ou encore le gaming et l’intelligence artificielle, incarne leur désir d’intégration globale. Connectés via les réseaux sociaux, les Tunisiens refusent d’être de simples spectateurs et aspirent à consommer et voyager librement, comme leurs pairs internationaux.
- Bancarisation et entreprendre : L’accès à des services financiers modernes est une priorité. Les citoyens veulent des prêts abordables pour acheter une voiture ou lancer une entreprise, un soutien réel aux start-ups et une ouverture aux cryptomonnaies. Selon l’OCDE (2022), 60 % des jeunes souhaitent entreprendre, mais seuls 12 % y parviennent faute de moyens.
- Représentativité : Le fossé avec les élites est béant. L’idée d’une classe dirigeante proche du peuple s’est éteinte, laissant place à un « tous pourris » qui englobe politiciens, médias, hommes d’affaires, fonctionnaires, forces de police, douanes et magistrats. En 2024 Seuls 12 % des Tunisiens déclarent faire confiance au Parlement, et 13 % au système judiciaire (Arab Barometer, 2024). En parallèle, plus de 40 % des personnes interrogées soutiennent une ligne encore plus dure de la présidence, estimant que les actions de Kaïs Saïed « ne vont pas assez loin ». L’expression populaire résume l’état d’esprit : « Qu’ils aillent tous en prison, Dieu reconnaîtra les siens.
- Social : Près d’un million de personnes vivent en extrême pauvreté et deux millions dans la précarité, soit trois millions de Tunisiens en détresse (INS, 2023). Ces populations cumulent immigration clandestine, analphabétisme, délinquance, drogue et conditions indignes. Leur discours oscille entre blâme envers un État corrompu, désillusion et attente paradoxale d’un secours étatique : « C’est la faute de l’État, mais seul l’État peut me sauver. » ou pour beaucoup « seul Kais Said peut me sauver »
Des aspirations partagées par tous les peuples : l’amour de nos enfants et la quête de paix
Les rêves des Tunisiens s’inscrivent dans une universalité frappante : l’amour pour leurs enfants et le désir de vivre décemment en paix. En France, 60 % des citoyens craignent une chute de leur pouvoir d’achat (IFOP, octobre 2023); au Brésil, 45 % des jeunes peinent à trouver un emploi stable (IBGE, 2023).
À Sfax comme à São Paulo, à Gafsa comme à Gaza, les parents partagent les mêmes vœux : nourrir leurs enfants, les voir grandir en sécurité et leur offrir un avenir serein de décent. Une étude de l’UNICEF (2021) montre que 87 % des parents, toutes régions confondues, placent l’éducation et la stabilité de leurs enfants en priorité.
De Kasserine à Karachi, cet instinct, protéger ceux qu’on aime et vivre dignement, transcende les frontières. Les Tunisiens ne demandent rien d’extravagant : un toit, du pain et la paix en toute chose.
Articles suivants (Ordre logique de lecture)
- All Post
- Actualités
- Article
- Conférences et formations
- Humeurs
- La fondation
- La résilience
- La souveraineté
- La Tunisie éternelle
- Le manifeste
- Le plan de transformation
- Les essentiels
- Non classé
- Nos principes directeurs
- Back
- Le modèle de gouvernance de l'état

Penser l’effondrement à travers des regards croisés : occidentaux et arabo-musulmans (Mise à jour Mars 2025) Depuis plusieurs décennies, les sciences sociales et la théorie des systèmes complexes se penchent sur la notion d’« effondrement ». Des analystes comme Dmitry Orlov ou Pablo Servigne proposent des approches détaillant les étapes de désintégration...

Dans le tumulte de l’histoire, certaines nations semblent vouées à répéter un cycle implacable : un système politique se forge, se consolide, puis, imperceptiblement, génère les conditions de son propre effondrement. La Tunisie, berceau des civilisations et carrefour de la Méditerranée, n’échappe pas à cette implacable dynamique. Au cœur de...