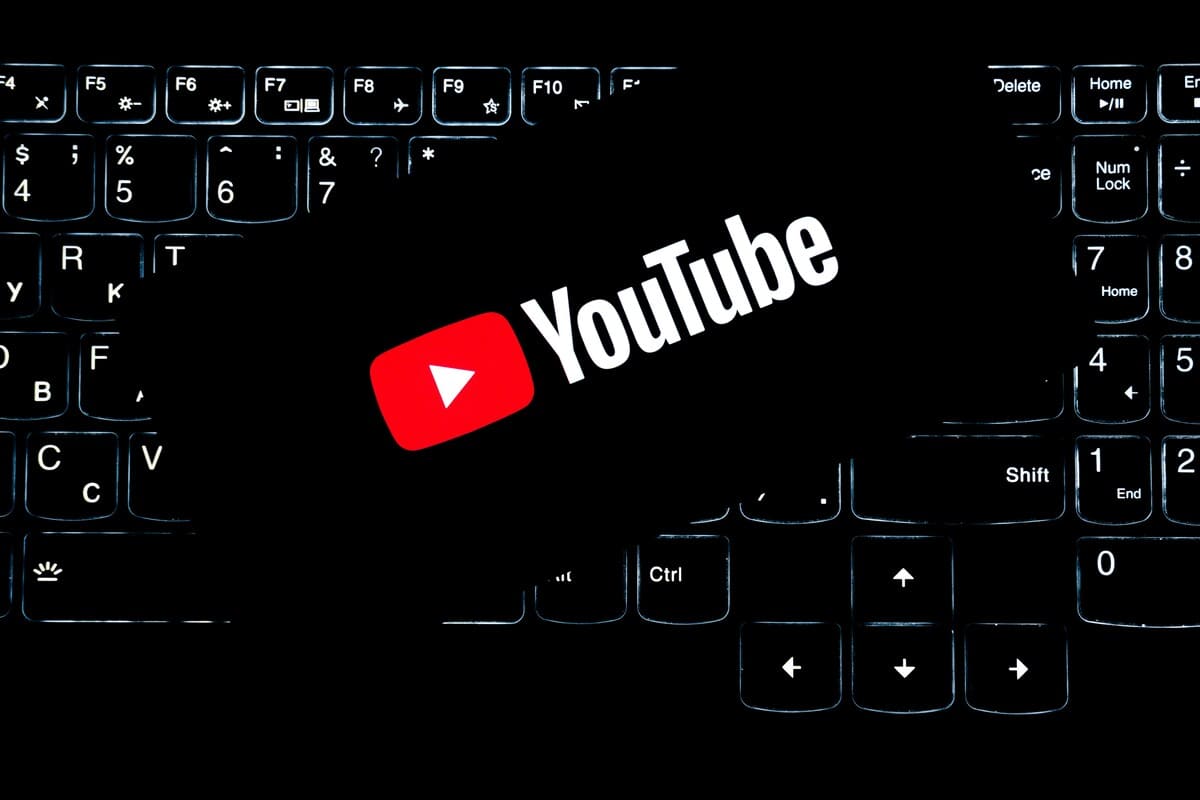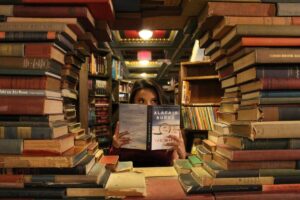Comprendre notre stratégie politique
Cet article est une mise à jour ou plutôt une refonte de celui publié en 2021 sur le même sujet. À cette époque, beaucoup d’entre vous soulevaient une objection légitime : Vous vous présentez comme un mouvement apolitique, et pourtant vous publiez un article intitulé « Notre stratégie politique » ?
Il n’y a en réalité aucune contradiction, et nous assumons pleinement cette position. Tout dépend de ce que l’on entend par “politique”.
Nous sommes une organisation qui revendique une orientation politique si l’on se réfère au sens noble du terme celui du politikos, c’est-à-dire la gestion raisonnée de la cité, le souci du bien commun, la capacité à penser le long terme et à organiser collectivement notre avenir.
À ce titre, nous nous engageons dans les débats sur les grandes orientations nationales, qu’il s’agisse de politique énergétique, industrielle, agricole ou environnementale. Et pour garantir la cohérence de ces engagements sectoriels, nous avons défini en amont une stratégie politique fondée sur une idéologie claire, exposée dans notre manifeste accessible sur ce site.
Cependant, nous sommes bien « apolitiques » s’il s’agit de définir le mot politique comme celui du politikè, c’est-à-dire la lutte pour le pouvoir.
Nous ne portons aucun candidat, nos travaux sont open source, et nous discutons avec tout le monde, y compris l’État.
Nous sommes une organisation d’influence par les idées, qui s’inscrit dans le temps long, une approche fondamentalement opposée à celle de la course aux échéances électorales, qui oblige à penser en temps court.
Le Shift Project en France et Jean-Marc Jancovici ont rédigé le plan de transformation de l’économie française. L’introduction de ce plan définit clairement « l’idéologie politique » qui structure l’ADN des travaux. Le Shift n’a jamais eu de candidat et il est considéré comme l’un des mouvements ayant le plus influencé les politiques publiques, non seulement en France, mais aussi en Europe et même au Maghreb, puisque une partie de nos travaux s’inspire des analyses de Jean-Marc Jancovici.
Pourquoi c’est important
En 2018, avant la création de notre mouvement citoyen, nous avons fait le tour des partis politiques en Tunisie qui présentaient un candidat à l’élection présidentielle. Nous avons échangé avec des candidats et des membres de différents bureaux politiques. Le constat a été affligeant : dans un même bureau politique, pour un même parti, certains affirmaient que le changement climatique n’existait pas, alors que la section jeunesse de ce même parti se présentait comme écologiste. Toujours dans un même parti, certains expliquaient que les monopoles étaient utiles au pays, pendant que leur propre candidat les dénonçait en meeting.
La même chose pour quelques think tanks avec qui nous avons échangé : ils se disent souverainistes, mais préconisent dans leurs études la privatisation de l’ensemble des entreprises publiques.
En réalité, cela concerne l’ensemble de la classe politico-intellectuelle. Une grande partie de nos élites égrène des buzzwords sans en donner la moindre définition : souverainisme, résilience, humanité, progressisme, modernité, politique, climat et évidemment stratégie politique, sans jamais leur donner un sens clair.
La conséquence est simple et vérifiable : depuis 2011, on assiste à une succession d’alliances contre nature, au fantasme d’un gouvernement de “compétences” sans idéologie commune, et à une avalanche d’études stratégiques ou de décisions opérationnelles sans aucune cohérence d’ensemble.
Oui, notre mouvement affiche clairement sa stratégie politique. Celle-ci définit à la fois les orientations internes de notre mouvement, et les principes qui structurent les solutions que nous proposons.
Définir une stratégie politique : plusieurs approches possibles
Ainsi, vous l’avez compris, dans toute entreprise de transformation profonde, qu’il s’agisse de refonder un État ou de relancer une nation, le premier acte de lucidité stratégique consiste à définir une stratégie politique.
Élaborer une stratégie politique est un exercice fondamentalement complexe. Il ne s’agit pas simplement de gagner des élections ou de convaincre des électeurs, mais (notamment dans notre cas) de structurer dans le temps une trajectoire d’action collective, capable de transformer en profondeur la société, ses représentations, ses structures économiques, son rapport au territoire et à la souveraineté.
Face à cette ambition, plusieurs approches stratégiques sont possibles, chacune reflétant une certaine vision du politique, du pouvoir et du rôle des citoyens. Ces approches peuvent s’opposer ou se compléter. En voici quelques-unes :
A. L’approche par les valeurs et les principes
Cette approche consiste à fonder l’action politique sur un socle de valeurs structurantes : liberté, justice, égalité, souveraineté, dignité, solidarité, humanisme. Elle repose sur une conviction forte : c’est l’orientation morale d’un projet politique qui lui donne sa légitimité historique et sa capacité à mobiliser dans la durée.
Dans cette logique, la stratégie ne peut être réduite à un simple calcul d’intérêt ou à une optimisation d’outils techniques. Elle devient une construction narrative et symbolique, fondée sur des repères stables qui guident les choix, y compris dans des contextes d’incertitude, de conflit ou de pression extérieure. L’exigence est donc double : construire une cohérence idéologique, et veiller à ce que les moyens employés n’annulent pas la finalité visée. Autrement dit, refuser le cynisme stratégique, et assumer une éthique de la transformation.
Dans la tradition islamique, cette exigence de cohérence entre moyen et finalité trouve un écho dans la pensée d’Al-Farabi, pour qui le but ultime de la politique est la réalisation du bonheur collectif (al-sa‘āda al-mushā‘a) dans une « cité vertueuse » (al-madīna al-fāḍila). Le gouvernant juste, selon lui, ne peut prétendre au pouvoir que s’il agit en vue du bien commun, et non par ambition personnelle ou par soumission à des intérêts extérieurs. De même, Ibn Khaldoun rappelle que la stabilité des États repose sur l’‘asabiyya (la cohésion sociale) mais qu’elle doit être nourrie par une cause juste et non par la seule force coercitive.
Historiquement, cette approche a été au cœur des luttes de libération. Les mouvements de décolonisation ont bâti leur légitimité sur des valeurs fortes : la souveraineté, l’émancipation, la justice sociale. Le FLN en Algérie a fondé sa stratégie sur la restitution de la dignité nationale. L’ANC en Afrique du Sud, malgré les décennies de répression, a maintenu une ligne éthique claire contre l’apartheid. Plus récemment, des mouvements panafricanistes s’appuyant sur le refus du franc CFA ou la dénonciation des logiques néocoloniales illustrent cette même dynamique.
En Tunisie, la figure de Farhat Hached incarne cette approche : syndicaliste et patriote, il a articulé lutte sociale et indépendance nationale autour de principes non négociables. Sa vision n’était pas technocratique, mais profondément éthique : refuser l’exploitation, affirmer la souveraineté, construire la justice.
Dans le cadre d’INTILAQ 2050, cette approche nous impose une rigueur particulière : nos choix techniques qu’ils concernent la fiscalité, l’agriculture, l’énergie ou l’éducation doivent toujours refléter notre échelle de valeurs. Il n’est pas admissible, par exemple, de parler de souveraineté énergétique tout en maintenant une dépendance systémique à des acteurs extérieurs sans transparence ni contrepartie. De même, toute politique agricole qui aggraverait la dépendance alimentaire ou marginaliserait les petits producteurs serait incompatible avec notre principe fondamental : mettre l’humain d’abord.
Adopter cette stratégie, ce n’est pas idéaliser. C’est assumer un niveau d’exigence stratégique supérieur, où la cohérence entre valeurs, actions et objectifs devient un facteur de puissance. C’est ce qui distingue les projets durables des slogans vides. Car ce qui donne de la force à un mouvement politique, ce n’est pas seulement son programme : c’est la clarté de ses repères et la sincérité de son engagement.
B. L’approche programmatique et technocratique
Cette démarche repose sur la construction de solutions concrètes à des problèmes identifiés : chômage, précarité, transition écologique, fracture éducative, déséquilibres macroéconomiques… Elle s’appuie sur des données quantitatives, des modélisations, des tableaux de bord de performance, des scénarios prospectifs. Elle cherche à incarner une compétence technique au service de l’État, souvent présentée comme un gage de sérieux et de crédibilité, notamment auprès des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers.
C’est l’approche privilégiée par les gouvernements dits « technocratiques », qui prétendent dépasser les clivages idéologiques pour « faire tourner la machine ». L’accent est mis sur la « bonne gouvernance », la « rationalité économique », et la mise en œuvre de réformes dites structurelles dont le contenu, en réalité, reste fortement idéologique, même s’il se pare de neutralité scientifique.
Elle séduit les élites réformistes, centristes ou issues du monde de l’expertise consultants, économistes, hauts fonctionnaires qui voient dans la technocratie une voie de modernisation apaisée. Cette approche a façonné les politiques publiques de nombreux pays du Sud, en particulier après les années 1980, avec les programmes d’ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale, centrés sur la réduction des dépenses sociales, la libéralisation économique, et la privatisation des services publics.
Mais ces logiques technocratiques, présentées comme « rationnelles », ont souvent échoué à produire un développement endogène ou durable. En réalité, elles traduisent une incapacité à penser les transformations sociales dans leur profondeur historique et culturelle. En l’absence de projet de société assumé, elles conduisent à des politiques déconnectées du vécu populaire, imposées « d’en haut », et privées de légitimité démocratique.
Prenons l’exemple de la Tunisie : les Plans nationaux de développement, rédigés avec le soutien de cabinets internationaux ou d’experts mandatés par des bailleurs, regorgent de « recommandations » souvent génériques, interchangeables, et recyclées d’un pays à l’autre sans que soit posée une seule fois la question centrale : à quoi voulons-nous que la Tunisie ressemble dans vingt ans ? Quelle agriculture voulons-nous ? Quelle souveraineté alimentaire ? Quelle justice territoriale ? En l’absence de réponse politique à ces questions, l’ingénierie technocratique tourne à vide, reproduit les inégalités, ou les aggrave sous couvert d’efficience.
Le sociologue James Ferguson a bien montré, dans ses travaux sur le « développement dépolitisé » en Afrique, que les dispositifs technocratiques servent souvent à évacuer les vrais enjeux politiques et sociaux. On réforme sans débattre, on modernise sans écouter, on gère sans transformer.
Dans le cadre d’INTILAQ 2050, nous rejetons cette approche si elle se coupe du sens, si elle remplace la politique par la gestion, si elle donne l’illusion qu’un pays peut être gouverné comme une entreprise ou un tableur Excel. La compétence technique est nécessaire, mais elle doit être subordonnée à une vision claire, à un projet collectif assumé, et à un engagement éthique.
Autrement dit : sans souveraineté du sens, il n’y a pas d’efficacité durable.
C. L’approche identitaire ou civilisationnelle
Dans cette approche, la stratégie politique repose sur la définition d’un “nous” collectif, enraciné dans l’histoire, la culture, la spiritualité, ou la mémoire partagée d’un peuple. Il s’agit de réactiver une conscience d’appartenance profonde, souvent marginalisée ou fragmentée, pour fédérer autour d’un projet de renaissance nationale ou de réenracinement civilisationnel.
Cette démarche est particulièrement puissante dans les contextes post-coloniaux, où l’effacement des repères culturels a produit une dépossession symbolique durable, ou dans les sociétés en crise de sens, où l’individualisme de marché et la segmentation communautaire ont disloqué le lien social. Elle vise à restaurer une continuité historique, à donner une cohérence au passé, au présent et au futur, en reconnectant les aspirations contemporaines à un imaginaire collectif.
Mais cette approche peut prendre deux formes opposées : inclusive ou excluante. Mal utilisée, elle peut dériver en nationalisme fermé, en rejet de l’autre, ou en instrumentalisation identitaire à des fins de pouvoir. Utilisée avec sagesse, elle devient une force émancipatrice et structurante, capable de rassembler au-delà des fractures sociales ou politiques, en donnant du sens à l’action collective.
De nombreux exemples illustrent cette logique : en Turquie, la stratégie d’Erdoğan repose sur une réactivation de l’identité ottomane et musulmane comme levier de mobilisation, offrant une vision alternative à l’héritage kémaliste occidentaliste. En Iran, la République islamique post-1979 s’est construite sur un socle chiite révolutionnaire, mêlant symboles religieux, mémoire historique et anti-impérialisme. En Bolivie, Evo Morales a mis en avant la cosmovision andine, revalorisant les peuples autochtones comme fondement d’un État plurinational.
Dans le monde arabe, cette dynamique traverse aussi bien les mouvements islamistes que les courants arabistes ou amazighs. Au Maghreb, certains projets politiques s’appuient sur l’arabité, l’islam ou l’amazighité comme piliers de reconstruction. En Tunisie, bien que cela soit souvent minoré, la Révolution de 2011 a aussi été une tentative — confuse mais réelle — de réappropriation symbolique : slogans, chants, appels à la dignité, tous portaient une charge identitaire, bien que non canalisée politiquement.
Plus profondément encore, cette approche trouve un écho dans notre propre tradition intellectuelle. Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima, explique que la survie et la grandeur des civilisations reposent sur la cohésion morale et culturelle des groupes humains. Al-Farabi, quant à lui, fonde la cité idéale sur une unité philosophique et spirituelle, où les individus sont liés par une vision commune du bien et du juste. Ce sont là des fondements profondément politiques.
Dans le cadre d’INTILAQ 2050, cette approche implique de réhabiliter notre récit civilisationnel, non comme un repli passéiste, mais comme un levier de projection stratégique. Elle nous invite à puiser dans nos propres matrices culturelles — islamiques, méditerranéennes, africaines — pour penser l’avenir sans aliénation. Elle pose une exigence forte : être les héritiers actifs de notre histoire, et non ses orphelins silencieux.
D. L’approche par le récit et l’imaginaire collectif
Cette stratégie vise à mobiliser les foules par un grand récit d’avenir, à réenchanter le politique par la puissance du langage, de l’émotion, de la narration et parfois même de la mise en scène symbolique. Là où les programmes échouent à susciter l’adhésion et où les chiffres peinent à convaincre, le récit permet de redonner confiance, de rallumer l’espoir, de faire rêver.
Elle repose sur l’activation de l’imaginaire collectif : archétypes culturels, figures mythiques, héros nationaux, mémoire partagée, rêves refoulés… Autant d’éléments qui forment l’ossature d’un imaginaire latent, que cette approche rend opératoire dans l’espace public. Elle s’appuie sur les outils de la communication moderne, du marketing politique, mais aussi sur la culture populaire, la poésie, le cinéma, la musique, qui tous participent à créer un climat affectif propice à la mobilisation.
C’est cette voie qu’ont empruntée les grandes utopies modernes : le rêve américain, le socialisme du XXe siècle, la promesse européenne de paix après 1945, ou plus récemment les récits de transition écologique comme projet de refondation civilisationnelle. Leurs succès initiaux reposaient moins sur la rigueur des plans que sur la force des visions proposées.
En Tunisie, les moments de mobilisation populaire les plus intenses — la révolution de 2011, ou la ferveur populaire autour de la Coupe du monde 2022 ont été précédés ou portés par un imaginaire fort : dignité, revanche historique, désir de renouveau, sentiments d’injustice refoulés. Ces récits, même sans articulation programmatique, ont servi de déclencheurs collectifs puissants. Le slogan « dégage ! » en 2011 est emblématique : il n’exposait ni vision, ni solution, mais condensait un récit de rupture.
Dans notre tradition, le Coran lui-même recourt au récit comme outil pédagogique, mobilisant les exemples des peuples passés, les métaphores et les images du futur pour éveiller les consciences. De même, Ibn Khaldoun insiste sur la nature narrative de l’histoire, comme miroir permettant aux peuples de comprendre les dynamiques du pouvoir et de la décadence.
Mais cette approche, si elle est utilisée seule, comporte un risque majeur : celui de substituer l’émotion au projet, le rêve à la stratégie, le symbole à la transformation réelle. Sans structuration politique, sans vision de société, le récit reste un moment — pas un mouvement. Il peut catalyser des énergies mais rester sans traduction concrète, voire être récupéré par des forces contraires à ses promesses initiales. La déception post-2011 en Tunisie en est une illustration tragique.
Pour INTILAQ 2050, cette approche est essentielle, mais elle doit être articulée à une stratégie claire, à un programme cohérent et à des choix assumés. Le récit est une porte d’entrée émotionnelle et symbolique, mais il ne peut remplacer la rigueur de la planification, ni la construction patiente des institutions et des politiques publiques. Il doit inspirer l’action, pas s’y substituer.
Autrement dit : le récit est une étincelle, mais ce sont la vision, la méthode et la volonté qui construisent le feu.
E. La stratégie de la peur
Moins noble, mais redoutablement efficace, cette approche repose sur la mise en scène de menaces imminentes : chaos, insécurité, effondrement économique, menace extérieure, immigration incontrôlée, invasion culturelle ou « guerre des civilisations ». Elle cherche à provoquer un réflexe défensif, une adhésion immédiate à un pouvoir présenté comme seul rempart contre le danger. Elle suspend le jugement critique, affaiblit la délibération démocratique, et réoriente l’énergie collective vers la survie plutôt que la transformation.
Cette stratégie est très utilisée par les régimes autoritaires, mais elle n’épargne pas les systèmes démocratiques fragiles, en particulier en période de crise. Elle s’appuie sur des leviers puissants : médias de masse, réseaux sociaux, images chocs, discours d’urgence, souvent orchestrés pour saturer l’espace public de peur et de confusion. L’objectif n’est pas d’informer, mais de sidérer, de paralyser, puis de canaliser l’opinion.
L’ouvrage de Pierre Conesa, Vendre la guerre, illustre parfaitement ce mécanisme. Il y démontre comment les États-Unis, par le biais des médias, du cinéma et de la rhétorique présidentielle, ont construit un climat de peur pour « vendre » à leur propre population les guerres en Irak et en Afghanistan. De même, après les attentats du 11 septembre, la rhétorique sécuritaire a permis l’adoption de lois liberticides, la généralisation de la surveillance, et l’acceptation quasi aveugle de politiques d’intervention extérieure.
En Europe, cette stratégie connaît aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Les discours sur l’invasion russe, le « grand remplacement », ou la rupture civilisationnelle avec l’islam participent de cette gestion stratégique des peurs collectives. Il ne s’agit plus d’argumenter, mais de polariser l’espace politique, de délégitimer l’adversaire en le désignant comme danger existentiel.
Plus subtilement, certains gouvernements utilisent la peur de la faillite, des agences de notation, ou des sanctions internationales pour imposer des politiques d’austérité ou de dérégulation qui seraient autrement inacceptables. Le discours technocratique devient alors un discours de contrainte, dans lequel « il n’y a pas d’alternative », comme le résumait Margaret Thatcher — une autre forme de peur : la peur du chaos si l’on ose changer de cap.
En Tunisie, cette approche a été largement utilisée depuis 2011. Les élites en place ont régulièrement agité le spectre de l’instabilité, du retour à l’autoritarisme, de la guerre civile ou de la faillite financière, pour maintenir un statu quo économique et institutionnel profondément impopulaire. Le discours dominant sur la nécessité des réformes « douloureuses mais indispensables » relève souvent de cette stratégie : il ne cherche pas à convaincre sur le fond, mais à fermer le débat par la peur du pire.
La peur, comme toute émotion politique, n’est pas en soi illégitime. Elle peut être mobilisatrice lorsqu’elle est intégrée à une vision éthique, rationnelle et émancipatrice. Mais lorsqu’elle devient un outil de domination, de manipulation ou d’infantilisation des masses, elle détruit le lien démocratique et corrompt la décision publique. Une société gouvernée par la peur ne pense plus : elle obéit ou se replie.
Pour INTILAQ 2050, il est impératif de dénoncer cette logique et de proposer un contre-récit fondé sur le courage, la lucidité et l’espérance. Il ne s’agit pas de nier les dangers, mais de refuser qu’ils deviennent des outils de soumission. Nous devons apprendre à affronter la complexité sans céder à la terreur. Réarmer l’intelligence collective est aujourd’hui un acte de résistance.
F. L’approche schmittienne : désigner l’adversaire (INTILAQ 2050)
Formalisée par le juriste et philosophe allemand Carl Schmitt, cette approche affirme que le politique commence avec la désignation d’un adversaire. Selon lui, toute véritable action politique repose sur une distinction claire entre ami et ennemi, non au sens moral, mais au sens existentiel : qui menace notre mode de vie, notre souveraineté, notre cohésion ? Qui s’oppose structurellement à la communauté que nous voulons faire advenir ?
Derrière cette grille de lecture se cache une vérité brutale mais souvent occultée : tout projet politique suppose un conflit de visions du monde. Vouloir éviter le conflit, nier l’existence d’intérêts antagonistes, prétendre gouverner au nom de tous de manière neutre, c’est le propre des régimes post-politiques, où l’on dissout la démocratie dans la technocratie.
L’approche schmittienne invite au contraire à assumer le caractère conflictuel du politique, à clarifier les lignes de fracture, et à structurer la mobilisation autour d’un adversaire identifié — qu’il soit un système, une élite, un modèle économique ou un imaginaire dominant. Il ne s’agit pas d’un appel à la haine, mais d’un acte de lucidité stratégique : on ne construit pas un projet de transformation profonde sans identifier ce qu’il doit renverser ou dépasser.
Historiquement, cette approche a été utilisée avec des finalités diverses : les mouvements de décolonisation ont clairement désigné le colonialisme comme adversaire à abattre ; les mouvements ouvriers du XXe siècle ont désigné le capitalisme bourgeois ; les luttes anti-apartheid ont désigné le système racial et ses soutiens internationaux. C’est ce cadrage clair du conflit qui a permis d’élargir la mobilisation et de forger des alliances.
Pour INTILAQ 2050, cette approche constitue un pivot stratégique assumé. Dans un contexte tunisien marqué par la confusion idéologique, la dilution des responsabilités et la paralysie institutionnelle, il est indispensable de clarifier le champ de bataille. Notre adversaire, ce n’est pas tel ou tel acteur individuel, mais un système composite : celui de la rente, de l’impunité, du clientélisme technocratique, et de la soumission stratégique à des intérêts extérieurs.
Désigner l’adversaire, pour nous, c’est nommer les logiques mortifères qui empêchent toute transformation :
- Une élite hors-sol, convertie à la gouvernance sans peuple, sans projet, sans vision.
- Des réseaux d’intérêt, qui instrumentalisent l’État à des fins privées.
- Un modèle de développement sous perfusion, qui interdit la souveraineté réelle.
- Un imaginaire appauvri, qui nous présente le déclin comme inévitable et l’alternative comme dangereuse.
Cette désignation est le point de départ d’un récit politique mobilisateur. Elle permet de structurer la confrontation, d’élever le débat, et surtout de créer une dynamique de clarté. Car on ne peut pas rassembler un peuple autour d’un projet sans dire clairement à quoi il s’oppose.
Mais cette approche suppose une discipline éthique : l’adversaire n’est pas un ennemi à anéantir, mais une force à désarmer politiquement, idéologiquement et symboliquement. Il ne s’agit pas de tomber dans la diabolisation, mais dans la mise en lumière des mécanismes systémiques. Notre combat est un combat de civilisation : repolitiser l’avenir, remettre la volonté populaire au centre, restaurer l’idée même de transformation stratégique.
La stratégie politique d’INTILAQ 2050 : une hybridation assumée
Notre stratégie politique centrale s’inspire de l’approche schmittienne pour structurer le combat : nommer l’adversaire, identifier les logiques systémiques qui s’opposent à la transformation, clarifier les lignes de fracture et sortir de la neutralité paralysante.
Mais nous y ajoutons plusieurs dimensions essentielles pour bâtir une vision politique complète et mobilisatrice :
Les valeurs comme fondement : liberté, souveraineté, justice, dignité et bien commun guident nos choix et ancrent notre démarche dans une éthique de la transformation.
L’imaginaire collectif comme boussole : notre horizon 2050 n’est pas un simple objectif temporel, c’est une vision du futur désirable, construite avec le peuple, pour rallumer l’espérance et restaurer l’envie de projet.
La profondeur civilisationnelle comme socle : nous puisons dans la richesse de notre héritage — de Carthage aux soufis, de Kairouan à l’Afrique — pour construire une stratégie enracinée, cohérente avec notre trajectoire historique, mais résolument tournée vers l’avenir.
La compétence prospective comme méthode : notre vision ne reste pas dans le registre du rêve ou du slogan. Elle est traduite en scénarios, plans d’action, outils de pilotage, dans une logique rigoureuse et moderne de transformation systémique.
Autrement dit, INTILAQ 2050 ne choisit pas entre la lutte et la construction, entre la mémoire et le futur, entre la stratégie et la vision : nous les articulons. Nous assumons le conflit, mais pour le dépasser. Nous assumons la complexité, mais pour mieux la transformer.
Car notre ambition est claire : faire de la Tunisie un laboratoire politique, civilisé et souverain, à même de montrer qu’une alternative stratégique est non seulement possible, mais réalisable.
Nos quatre axes structurants
Notre principe transversal, de Machiavel à Ibn Khaldoun, désigner l’adversaire pour unir et transformer : Notre stratégie politique s’appuie sur un principe fondamental, partagé par les grandes traditions de pensée politique : la cohésion d’un peuple, sa capacité à se projeter, à se mobiliser et à se transformer, dépendent de la clarté avec laquelle il identifie ce qui l’empêche d’agir.
Nicolas Machiavel l’enseigne dans Le Prince : un souverain avisé doit « satisfaire le peuple » en désignant clairement les responsables des maux publics (chap. XIX).
Carl Schmitt insiste sur le fait que toute unité politique se cristallise autour de l’ennemi existentiel, celui qui incarne une menace pour la survie ou l’autonomie du corps politique.
Ibn Khaldoun montre que la ʿasabiyya (cohésion sociale) se forme face à un adversaire commun, mais que l’injustice (ẓulm) la détruit de l’intérieur.
Al-Fârâbî, enfin, nous enseigne que tout système politique qui détourne la communauté de la recherche du bien commun devient, de fait, l’ennemi de la cité vertueuse.
Ce principe de désignation de l’adversaire structure notre stratégie. Il ne s’agit pas de détourner les colères populaires, mais de leur donner un cadre d’intelligibilité et une direction stratégique. Sans ennemi clair, pas de cohésion. Sans cohésion, pas de transformation.
Axe 1 : Notre adversaire : le système néolibéral
Nous désignons clairement notre adversaire : le système néolibéral, qui depuis quarante ans détruit méthodiquement les fondations de nos sociétés.
Ce système :
Accapare les richesses au profit d’une minorité transnationale déconnectée du peuple,
Détruit la classe moyenne, moteur historique de stabilité et d’innovation,
Crée des pauvres encore plus pauvres, par la précarisation généralisée du travail et la marchandisation des services publics,
Désintègre nos écosystèmes, en sacrifiant l’environnement à la logique du profit immédiat,
Dissout notre identité, en imposant des modèles culturels standardisés et consuméristes,
Efface notre patrimoine, en dévalorisant ce qui fait notre singularité au nom de la compétitivité.
Ce système n’est pas une fatalité. C’est une construction idéologique, soutenue par des intérêts bien identifiés. Le désigner, c’est refuser de l’accepter comme horizon indépassable.
Axe 2 : Notre idéologie : une pensée structurée par les valeurs
À l’opposé de la froideur technocratique, notre pensée politique est structurée autour de trois repères essentiels :
- L’humain,
- Le bien commun,
- La Patrie.
Ces valeurs ne sont pas des slogans. Elles structurent nos choix stratégiques, nos politiques publiques, nos priorités budgétaires. Elles s’inspirent de la pensée d’Al-Fârâbî, pour qui la cité juste vise la réalisation du bonheur collectif, et de celle d’Averroès, qui défendait une rationalité politique fondée sur la justice, l’éthique et l’intérêt général.
Dans notre projet, ces valeurs orientent tous les arbitrages : un modèle fiscal juste, une politique de santé fondée sur la dignité, une agriculture régénérative, un système éducatif émancipateur, un État stratège au service de la population et non des marchés.
Axe 3 : Notre moyen : mobiliser par l’espoir et la vision
Nous croyons à la puissance du récit d’avenir. Nos sociétés ont été vidées d’horizons, privées de rêves, enfermées dans la gestion du présent et la peur du lendemain.
Nous affirmons : nos enfants doivent impérativement rêver de 2050.
Comme nous avons rêvé de l’an 2000 dans notre jeunesse, ils doivent rêver de la Tunisie de demain : souveraine, prospère, juste, créative. Le projet INTILAQ 2050 est un récit structurant, qui redonne du sens, de la direction, et la fierté d’agir.
L’espoir, dans notre stratégie, n’est pas une émotion passive : c’est un levier stratégique pour activer les énergies dormantes, pour construire une majorité sociale prête à s’engager dans la transformation.
Axe 4 : Notre démarche : rebâtir, pas réformer
Nous ne voulons pas « améliorer l’existant ». Nous voulons rebâtir notre pays sur de nouvelles fondations. Cela suppose de sortir du cadre hérité, de rompre avec les modèles imposés, et d’oser proposer une refondation politique, sociale, économique, culturelle. Nous assumons une stratégie de rupture. Nous ne suivons pas les tendances : nous traçons un chemin. Et nous disons à la nation : « Voilà où nous allons. »
C’est cette démarche volontariste, claire, assumée, qui fait notre différence. Elle s’appuie sur des compétences solides en prospective stratégique, en sciences politiques, en design institutionnel, pour traduire notre vision en leviers d’action réels.
Nos ambitions prioritaires
La transformation que nous portons exige une montée en puissance progressive mais déterminée. Nos priorités ne relèvent pas du souhait ou de l’intuition : elles sont stratégiquement ciblées, car elles constituent les conditions d’émergence d’un véritable contre-pouvoir politique citoyen, structuré et durable.
Créer un mouvement profond de prise de conscience collective : Diffuser massivement notre plan de transformation sur les réseaux sociaux et via notre chaîne YouTube. L’objectif est clair : imposer nos idées dans le débat national en suscitant une prise de conscience populaire généralisée, face à un système qui vit de l’apathie et de la résignation.
Identifier et former les compétences nationales d’excellence : Repérer, former et mobiliser les talents les plus prometteurs dans chaque région du pays, pour constituer une garde stratégique capable de porter et mettre en œuvre notre vision à tous les niveaux du territoire.
Établir des partenariats stratégiques solides : Construire un écosystème puissant d’acteurs publics, privés, citoyens et associatifs qui partagent nos valeurs fondamentales, pour multiplier notre force d’impact, diffuser nos propositions et soutenir leur implémentation sur le terrain.
Nos outils pour atteindre ces objectifs
Pour traduire ces ambitions en actions concrètes, nous avons défini des outils structurants, complémentaires et opérationnels, qui articulent présence numérique, ancrage local, formation stratégique et coopération internationale.
Une stratégie digitale ambitieuse et efficace : Déployer les leviers du numérique pour augmenter notre visibilité, influencer le débat public et accélérer la viralité de nos idées, tout en maîtrisant nos canaux de communication.
Un réseau actif de 300 ambassadeurs INTILAQ 2050 : Répartis sur tout le territoire national, ces ambassadeurs seront les piliers de notre action locale : présence de terrain, relais d’information, animation de la mobilisation, adaptation de notre discours aux réalités régionales.
L’Académie Tunisienne des Leaders de Demain : Un pôle de formation stratégique et civique, destiné à former des leaders d’impact, capables de porter nos idées avec rigueur, courage et intelligence. Ils seront les futurs piliers de la gouvernance que nous appelons de nos vœux.
Des initiatives de coopération internationale ciblées : Construire des ponts avec des mouvements similaires à travers le Maghreb, le Moyen-Orient et l’Afrique pour construire une convergence souveraine et résiliente, promouvoir des modèles alternatifs, et briser l’isolement des initiatives transformatrices.
Les leviers de notre organisation
Notre mouvement ne repose pas seulement sur des idées, mais sur une organisation agile, ancrée, intelligente et sécurisée, capable d’évoluer avec le terrain tout en gardant le cap stratégique.
Agilité et efficacité organisationnelle :Une structure souple, claire, orientée vers les résultats, capable d’atteindre efficacement ses objectifs d’influence et de transformation sans lourdeur bureaucratique.
Participation active et reconnaissance des membres : Une dynamique d’engagement fondée sur la reconnaissance, l’inclusion et la responsabilité. Chaque membre est porteur d’une part de notre projet commun.
Ancrage social significatif : Une présence réelle et visible dans toutes les couches de la société tunisienne. Nous ne sommes pas un mouvement hors-sol : nous sommes au cœur du réel.
Rayonnement national personnalisé : Grâce à nos ambassadeurs, nous adaptons nos discours et actions à la diversité des contextes régionaux, pour un enracinement authentique.
Gouvernance proactive fondée sur l’intelligence collective : Nous mobilisons des outils analytiques avancés, des boucles de rétroaction terrain, et des processus de décision partagés pour anticiper les dynamiques sociales et politiques.
Priorité absolue à la sécurité : Nous garantissons à nos membres et partenaires une sécurité optimale, tant sur le plan physique que numérique, face à un environnement de plus en plus instable.
Les valeurs fondamentales de notre mouvement
Notre force repose sur quatre valeurs structurantes, explicitées dans notre manifeste et présentes à chaque étape de notre stratégie :
Excellence : une exigence permanente d’amélioration, d’innovation et de dépassement de soi. Elle est le moteur de notre crédibilité.
Travail : l’engagement rigoureux, discipliné et résilient dans la mise en œuvre de notre vision. Sans effort, pas de transformation.
Partage : la solidarité comme fondement de notre communauté politique. Personne ne réussit seul, et chaque réussite individuelle doit renforcer le collectif.
Éthique : la transparence, la responsabilité et la cohérence comme conditions de la confiance, indispensable pour durer et rassembler.
Ces valeurs ne sont pas des oriflammes. Elles forment la colonne vertébrale de notre stratégie politique, et nous permettent de mobiliser les énergies citoyennes autour d’un projet ambitieux, juste, structuré et profondément humain.
Conclusion : Pour une reconquête stratégique de la Tunisie
Nous vivons une époque de basculement. Les anciens repères s’effondrent, les élites traditionnelles s’enferment dans le déni, et une majorité silencieuse continue de subir un modèle qui a épuisé ses promesses. Face à cette impasse, INTILAQ 2050 n’est ni une simple réaction, ni une amélioration de l’existant — c’est une refondation stratégique.
Notre démarche repose sur un principe fondamental : la Tunisie n’a pas besoin d’un plan de réformes, elle a besoin d’un projet de renaissance. Une vision structurée, assumée, profondément politique, qui articule lucidité sur les rapports de force, clarté sur les valeurs, maîtrise des outils, et audace dans l’imaginaire.
Nous avons nommé notre adversaire : le système néolibéral et ses relais locaux, qui bloquent toute souveraineté réelle, tout projet collectif, toute dynamique d’espoir.
Nous avons défini notre socle : des valeurs fortes, une culture politique enracinée, une stratégie claire, une vision du futur désirable.
Nous avons identifié nos leviers : une organisation agile, un réseau actif sur le terrain, une stratégie digitale puissante, une formation des élites de demain, et une capacité à coopérer au-delà de nos frontières.
Et surtout, nous avons posé un cap : 2050. Non pas comme une date lointaine, mais comme une boussole commune, un horizon qui nous oblige à penser grand, à agir vite, et à construire durable.
INTILAQ 2050 n’est pas une candidature, un parti ou une promesse. C’est un mouvement de transformation collective, un instrument d’éveil stratégique, une offre politique au service du peuple tunisien.
Le chemin est ouvert : À chacun de décider s’il veut rester spectateur, ou devenir bâtisseur.