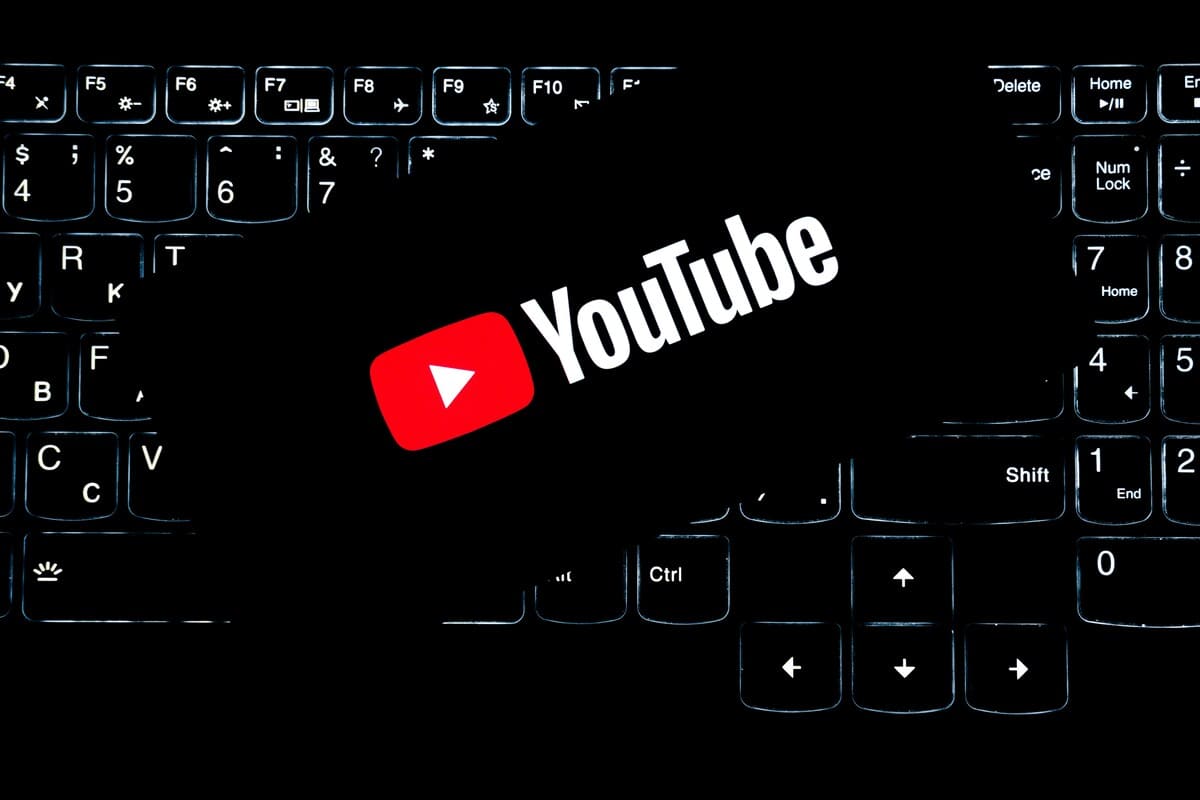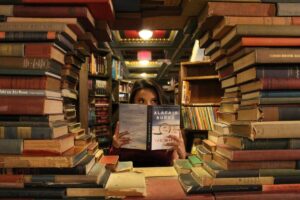La démocratie est un mode d’organisation et de gouvernance dans lequel le peuple confie le pouvoir de diriger la nation à ses représentants élus. Ce processus, souvent attribué à la Grèce antique, trouve en réalité des racines bien plus anciennes : les Sumériens disposaient déjà, il y a plus de 4000 ans, d’assemblées délibératives comparables à un parlement et un sénat, démontrant que l’idée de représentation politique n’est pas l’apanage exclusif de l’Occident moderne.
La démocratie suppose l’existence de plusieurs espaces distincts mais complémentaires. Le premier est celui de la compétition politique, qui permet à ceux qui aspirent à gouverner d’exposer leur vision et leurs plans d’action. Cet espace est essentiel pour garantir un véritable choix citoyen entre plusieurs projets de société. Le deuxième est l’espace législatif, où se construit le cadre juridique qui encadre et formalise les orientations politiques. Le troisième est l’espace exécutif, chargé de mettre en œuvre ces décisions et de diriger effectivement la nation.
L’organisation de ces espaces, et surtout la manière dont ils interagissent, définit ce que l’on appelle un modèle démocratique. Or, la démocratie — ou plus précisément, ses modalités concrètes d’expression — n’est pas un concept figé. Elle évolue avec les sociétés, avec la conscience des peuples, avec les rapports de pouvoir, mais aussi avec les technologies de l’information et les modes d’organisation sociale.
Depuis 2011, la classe politique tunisienne semble toutefois paralysée dans des schémas anciens. Certains prônent un retour en arrière vers les modèles autoritaires d’inspiration islamiste ou bourguibiste ; d’autres rêvent d’un alignement pur et simple sur le modèle occidental, notamment français, considérant qu’il suffit de copier-coller les institutions d’ailleurs pour construire la démocratie ici. L’herbe semble toujours plus verte de l’autre côté de la Méditerranée.
Or, comme sur de nombreux sujets, nos positions vont à rebours des discours dominants. Nous pensons qu’il est temps d’interroger les fondements réels des modèles démocratiques occidentaux, non pas pour les rejeter par principe, mais pour en comprendre les limites, les logiques implicites, et les conséquences sur nos sociétés. Ce texte propose une lecture stratégique, critique et contextualisée de ces modèles, dans une perspective tunisienne ambitieuse.
Historique et Transformations du Modèle Démocratique
XIXe siècle – Démocratisation de l’éligibilité
Au XIXe siècle, l’accès à l’éligibilité politique a connu une évolution progressive vers une plus grande ouverture, marquant le passage d’un système aristocratique ou censitaire vers une forme de participation élargie aux classes bourgeoises, puis populaires. Cette démocratisation n’est pas née d’un idéal abstrait de souveraineté populaire, mais du jeu d’alliances et de rapports de force entre différents groupes sociaux et d’intérêts. Bernard Manin (1995), dans Principes du gouvernement représentatif, rappelle que ce processus fut porté par des forces bien identifiables : la presse d’opinion, les parlementaires réformistes, les réseaux d’entreprises capitalistes émergents, les cercles intellectuels libéraux, les loges maçonniques influentes, les mutuelles ouvrières, les sociétés secrètes radicales, les ligues politiques, et certains groupes religieux en quête de légitimité sociale.
La prétendue universalisation du suffrage fut donc avant tout une stratégie d’élargissement contrôlé, où l’inclusion de nouvelles catégories d’électeurs s’est accompagnée de mécanismes d’encadrement idéologique et institutionnel. Le suffrage censitaire, par exemple, ne fut supprimé que lorsque les élites purent garantir que les masses voteraient « raisonnablement », souvent via l’école, la presse, ou l’Église. En France, la Troisième République (1870-1940) en est une illustration : républicaine en apparence, elle restait largement contrôlée par des élites parisiennes formées dans les grandes écoles et connectées aux milieux financiers et industriels.
Dans le monde arabo-musulman, la modernisation politique au XIXe siècle s’est également accompagnée de tentatives d’élargissement de la participation, notamment sous l’effet des réformes ottomanes dites Tanzimat (1839-1876), qui visaient à créer une nouvelle forme de citoyenneté. En Tunisie, le Pacte Fondamental (ʿAhd al-Amān) de 1857, suivi de la Constitution de 1861 — première du monde arabe —, posait déjà les bases d’un embryon de représentation, même si ces réformes restèrent largement symboliques et furent récupérées ou freinées par les élites beylicales et coloniales.
Ces transformations montrent que la démocratisation de l’éligibilité ne fut jamais neutre : elle s’est toujours construite sur une ingénierie politique, sociale et culturelle qui garantissait le maintien du pouvoir réel au sein d’un cercle restreint. Comprendre cela est essentiel pour ne pas idéaliser a posteriori les modèles démocratiques occidentaux, souvent présentés comme des aboutissements naturels de la liberté, alors qu’ils sont le produit d’une histoire conflictuelle et d’une logique de contrôle.
Après la Seconde Guerre mondiale – Guerre Froide
Durant la seconde moitié du XXe siècle, et plus intensément après la Seconde Guerre mondiale, les systèmes politiques occidentaux se sont cristallisés autour de clivages idéologiques structurants : gauche contre droite, capital contre travail, secteur public contre secteur privé. Ces clivages, analysés par Seymour Martin Lipset et Stein Rokkan (1967) dans Party Systems and Voter Alignments, reflétaient des tensions sociales profondes héritées de la révolution industrielle et des conflits du XIXe siècle, institutionnalisées dans des partis politiques désormais enracinés dans des bases militantes solides.
Les partis de gauche puisaient leur légitimité dans les syndicats ouvriers, les mouvements coopératifs, les mutuelles et les intellectuels critiques ; tandis que les partis de droite s’adossaient aux milieux patronaux, aux institutions religieuses, aux agriculteurs propriétaires et à une presse généralement conservatrice. Ce paysage se traduisait par une forte politisation de la société, où l’engagement partisan était perçu comme un prolongement naturel de l’identité sociale et professionnelle. La démocratie représentative fonctionnait alors sur un mode de canalisation des conflits sociaux, chaque parti servant d’intermédiaire entre des groupes d’intérêt bien définis et l’appareil d’État.
Dans le contexte de la Guerre Froide, ce clivage idéologique fut exacerbé et encadré par une logique géopolitique binaire. À l’Ouest, les démocraties libérales furent renforcées par la peur du communisme, avec le soutien actif des États-Unis via le Plan Marshall, l’OTAN et une stratégie globale d’endiguement. Ce soutien ne fut pas sans conditions : il impliquait l’alignement des forces politiques occidentales sur un consensus atlantiste, libéral et anti-communiste. Le modèle démocratique occidental, présenté comme le rempart contre le totalitarisme, s’est ainsi consolidé non pas par une dynamique purement interne, mais par une structuration géostratégique.
Ce contexte explique aussi pourquoi les expériences démocratiques dans les pays du Sud — souvent soutenues ou instrumentalisées par les puissances occidentales — ont été soit interrompues (comme au Chili en 1973), soit vidées de leur substance au profit de régimes clientélistes et autoritaires. En Tunisie, par exemple, le régime bourguibien post-indépendance s’est inscrit dans une logique de modernisation autoritaire, largement tolérée, voire soutenue, par les puissances occidentales tant qu’elle garantissait stabilité, libéralisme économique progressif et opposition au communisme. Cela révèle que la consolidation démocratique, dans les pays du Nord comme du Sud, ne s’est jamais faite en dehors des rapports de force globaux.
2008 – Fin des clivages traditionnels Gauche/Droite
Depuis l’élection de Barack Obama en 2008, symbole d’une rupture narrative dans la politique américaine, on observe un affaiblissement progressif — puis structurel — des clivages idéologiques classiques entre gauche et droite. Selon Manuel Castells (Networks of Outrage and Hope, 2012), cette mutation est le produit de l’essor des réseaux numériques, de la saturation médiatique et de la montée des logiques identitaires. Ce n’est plus l’appartenance à une classe sociale ou à une idéologie qui structure les choix politiques, mais l’adhésion émotionnelle à des récits, des figures incarnées et des causes transversales.
L’émergence des plateformes sociales a permis une personnalisation radicale du discours politique, en remplaçant les canaux institutionnels par des logiques de viralité, de communauté et de co-construction narrative. La « démocratie participative numérique » — avec ses déclinaisons telles que le financement participatif (crowdfunding), les pétitions en ligne, ou les consultations citoyennes ouvertes — a déplacé le centre de gravité du pouvoir symbolique : ce ne sont plus les partis, mais les plateformes et leurs algorithmes qui organisent la visibilité des idées.
2017 – Vers une disparition des partis traditionnels
À partir de 2016-2017, avec les élections de Donald Trump aux États-Unis et d’Emmanuel Macron en France, ce basculement devient manifeste. Les partis traditionnels, fondés sur des ancrages idéologiques, syndicaux ou territoriaux, s’effondrent ou se vident de leur substance. Paolo Gerbaudo, dans The Digital Party (2019), décrit ce nouveau type d’organisation comme une « démocratie digitale personnalisée et protéiforme », dans laquelle l’identité du leader, sa capacité à incarner une narration, prime sur tout programme structuré ou sur toute fidélité partisane.
Ce phénomène ne se limite pas à l’Occident. Dans le monde entier, des mouvements transnationaux se développent en dehors des structures classiques : le féminisme intersectionnel, l’écologie radicale, la décroissance, le transhumanisme, le souverainisme ou les identitarismes minoritaires (black power, indigénisme, islamisme, etc.). Ces mouvements ont en commun une capacité à mobiliser rapidement, de manière décentralisée, souvent horizontale, autour de causes perçues comme urgentes, sans médiation partisane.
En Tunisie, cette dynamique mondiale s’est incarnée de manière singulière. Le phénomène Kaïs Saïed ne constitue pas une rupture solitaire mais l’expression locale d’une tendance globale : le rejet des partis, la suspicion envers les élites politiques, et la recherche d’une incarnation morale de la souveraineté populaire. Comme l’ont analysé Chouikha & Geisser (2021) dans Tunisie, une démocratisation au-dessus de tout soupçon ?, Saïed n’a pas provoqué l’effondrement du système partisan tunisien — il en a tiré parti, en s’appuyant sur la défiance généralisée envers les appareils classiques pour imposer un pouvoir fondé sur la verticalité et la légitimité morale.
Un exemple frappant de cette reconfiguration : en 2019, le mouvement initié par Greta Thunberg a mobilisé plus de 6 000 jeunes Tunisiens âgés de 16 à 25 ans lors de manifestations pour le climat — un niveau d’engagement et d’organisation qu’aucun parti politique local n’avait réussi à atteindre depuis la révolution. Cela illustre que les nouvelles mobilisations ne dépendent plus de structures, mais de causes partagées et de narrations émotionnelles globalisées.
Critique du modèle démocratique occidental
Longtemps érigé en modèle universel de gouvernance, le système démocratique occidental montre aujourd’hui des signes clairs de dérive oligarchique et de délitement structurel. Derrière l’apparente pluralité électorale et le formalisme institutionnel, se cache une concentration toujours plus forte du pouvoir entre les mains de l’élite économique.
Aux États-Unis, une étude de Gilens & Page (2014), Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens, révèle que sur 1 723 lois promulguées entre 1997 et 2017, environ 80 % favorisaient les 20 % les plus riches. Moins d’une centaine de lois ont eu un impact tangible sur les classes moyennes ou les populations défavorisées, confirmant l’hypothèse que les élites économiques orientent majoritairement les politiques publiques. Ce constat invalide le mythe d’un système fondé sur l’expression majoritaire de la volonté populaire.
En Europe, les dynamiques sont similaires. En France comme au Royaume-Uni, l’alternance politique n’a pas enrayé la montée des inégalités ni le démantèlement progressif de l’État social. Comme l’a montré Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle (2013), la croissance des inégalités de patrimoine et de revenus est désormais structurelle : le capital croît plus vite que le revenu du travail, accentuant la concentration des richesses d’une génération à l’autre. Le vote, dans ce contexte, devient un simple rituel démocratique vidé de son effet redistributif réel.
Les chiffres globaux confirment cette tendance. En 2019, selon Oxfam, 2 153 milliardaires détenaient à eux seuls 60 % des richesses mondiales. En 2023, ce chiffre est monté à 2 760 milliardaires concentrant 70 % des richesses. La pandémie du COVID-19, loin de corriger ces déséquilibres, les a aggravés : les marchés financiers ont continué à s’envoler pendant que des millions de travailleurs perdaient leurs emplois ou tombaient dans la précarité. Les grandes fortunes ont capté l’essentiel des plans de relance — non pas via des fraudes, mais grâce à la structure même du système économique.
La France illustre crûment ce paradoxe. En 2023, les 10 % les plus riches détiennent plus de 50 % du patrimoine national, tandis que 10 millions de citoyens vivent avec moins de 1 000 euros par mois. Pire encore, pendant la crise sanitaire, les milliardaires français ont vu leur fortune croître de 30 %, accaparant près de 80 % des aides publiques censées soutenir le tissu économique (Rapport Oxfam France, 2022). Le modèle démocratique semble désormais produire ce qu’il prétend combattre : l’inégalité, l’injustice, et la marginalisation des classes laborieuses.
À cette crise sociale s’ajoutent des crises politiques et géopolitiques. La montée des extrêmes — en Europe comme aux États-Unis —, la perte de confiance dans les médias, l’attrition de la participation électorale et l’effritement du contrat social, témoignent d’un basculement dangereux. Comme l’explique Dmitry Orlov dans Les cinq stades de l’effondrement (2013), les sociétés en phase terminale d’effondrement passent d’abord par une faillite économique et institutionnelle, avant de glisser vers la désintégration culturelle et politique. Plusieurs pays occidentaux semblent avoir atteint ces seuils critiques.
Enfin, cette critique n’est pas une attaque idéologique contre la démocratie en tant que principe, mais une mise en lumière de la dénaturation de ses mécanismes. Ce qui est en crise, ce n’est pas l’idée de souveraineté populaire, mais son instrumentalisation au profit d’intérêts privés. Cela nous invite à repenser en profondeur les modèles de gouvernance, de représentation et de justice économique à l’échelle globale — y compris en Tunisie, où la fascination pour l’Occident continue souvent d’aveugler l’analyse stratégique.
Typologies des organisations politiques
Organisation Centric Culture : une logique dépassée
La culture politique dominante au XXe siècle s’est fondée sur une logique organisation-centric, centrée sur des structures institutionnelles rigides : partis traditionnels, associations loi 1901, syndicats classiques, think tanks élitistes, et entreprises politiques « verticalisées ». Ces entités fonctionnent selon une logique hiérarchique et descendante : le citoyen est invité à choisir entre des structures existantes, avec cette question implicite en filigrane : « Quelle organisation me convient le mieux ? »
Cette approche, héritée du fordisme organisationnel et des partis de masse du XXe siècle (voir Panebianco, Political Parties: Organization and Power, 1988), tend à reproduire les mêmes logiques d’entre-soi, de verrouillage des carrières militantes et de déconnexion vis-à-vis des préoccupations populaires. Dans ce modèle, les programmes sont rédigés par des cercles restreints d’experts ou de responsables, puis diffusés vers la base militante et l’électorat, souvent sans réel mécanisme de feedback.
En Tunisie, cette logique a largement prévalu depuis 2011, avec une multiplication des partis sans base idéologique forte, souvent fondés autour d’un leader ou d’un intérêt électoral ponctuel. Les partis traditionnels n’ont pas su renouveler ni leur lien au terrain, ni leurs pratiques internes. Cette culture politique fermée est aujourd’hui largement rejetée par une jeunesse en quête de participation directe et d’impact concret.
People Centric Culture : l’avenir de l’engagement politique
À l’opposé, une nouvelle logique émerge : celle d’une People Centric Culture, c’est-à-dire une culture centrée sur les citoyens, leurs aspirations, leurs imaginaires et leur capacité d’agir. Le cœur de cette dynamique repose sur une question radicalement différente : « Quelle Tunisie souhaite réellement le peuple ? » — une interrogation qui ne postule plus la primauté de la structure, mais celle du projet collectif.
Cette approche s’inspire des mouvements de démocratie délibérative (Fishkin, 2009), de gouvernance collaborative (Ansell & Gash, 2008) et des pratiques issues des civic tech : plateformes de consultation citoyenne, budgets participatifs, assemblées locales ouvertes, intelligence collective territoriale, etc. Elle donne la priorité à la co-construction, à l’écoute active et à la décentralisation des processus décisionnels.
Le projet INTILAQ 2050 s’inscrit pleinement dans cette dynamique en proposant un modèle de transformation systémique fondé sur l’intelligence collective, l’écoute des territoires et l’ancrage dans les besoins réels des citoyens. Il ne s’agit pas d’un simple programme politique, mais d’un mouvement structurant de refondation nationale, qui inverse la logique classique du pouvoir : non plus décréter d’en haut, mais co-imaginer avec les acteurs de terrain.
Par exemple, la démarche d’INTILAQ repose sur plus de 120 entretiens qualitatifs, la visite de 50 villages, et la participation active de citoyens, experts, responsables locaux et jeunes engagés, montrant ainsi que la démocratie peut se réinventer par la base, sans attendre l’aval des structures existantes.
Dans le monde arabe, cette approche fait écho à des traditions de choura (consultation collective) ancrées dans l’histoire islamique, mais souvent oubliées ou marginalisées. Al-Fârâbî ou Ibn Khaldoun, chacun à leur manière, avaient déjà posé les fondements d’un modèle politique fondé sur la participation, la vertu civique et la responsabilité partagée du pouvoir.
La People Centric Culture n’est pas une utopie : c’est une nécessité face à l’épuisement du modèle classique. Elle invite à repenser non seulement la manière dont on gouverne, mais surtout avec qui et pour qui l’on gouverne.
Perspectives et risques futurs
L’avenir politique sera sans doute façonné par des formes d’expression de plus en plus protéiformes : communautés citoyennes agiles, collectifs numériques décentralisés, plateformes électorales flexibles, coalitions éphémères autour de causes spécifiques. Ces nouvelles dynamiques traduisent une volonté profonde de se réapproprier l’espace public, en dehors des structures partisanes classiques. Elles ouvrent la voie à une démocratie plus fluide, réactive et horizontale.
Cependant, cette fluidité peut aussi se transformer en fragilité. Les structures émergentes sont particulièrement vulnérables aux manipulations externes, à la dépendance financière vis-à-vis d’acteurs internationaux, ou à des instrumentalisations idéologiques. Le rôle de l’Open Society de George Soros, par exemple, dans la structuration de réseaux associatifs post-révolutionnaires en Tunisie, interroge sur les limites d’une démocratie influencée par des agendas exogènes (Herman & Chomsky, Manufacturing Consent, 1988). L’ingénierie sociale opérée par des fondations transnationales, souvent au nom des « droits humains » ou du « développement démocratique », soulève des questions cruciales de souveraineté culturelle, politique et stratégique.
Face à ces risques, notre responsabilité collective est de redéfinir les modes d’expression politique à partir de nos propres fondations civilisationnelles. Il ne s’agit pas de rejeter l’innovation démocratique, mais de l’ancrer dans un imaginaire propre, nourri par notre histoire, notre pensée politique et nos dynamiques sociales contemporaines. La choura islamique, les jamaâs de gouvernance locale, les formes de solidarité communautaire, ou encore les expériences constitutionnalistes tunisiennes du XIXe siècle (comme la Constitution de 1861), sont autant de ressources oubliées qu’il nous faut réactiver et adapter.
INTILAQ 2050 s’inscrit dans cette perspective : construire un avenir politique en harmonie avec les aspirations des jeunes générations, tout en renouant avec l’essence participative et morale de notre culture politique. Cette démarche vise à garantir une représentation authentique, autonome et résiliente, capable de résister aux vents dominants du néolibéralisme global et de bâtir un avenir fondé sur la justice, la souveraineté et la dignité.