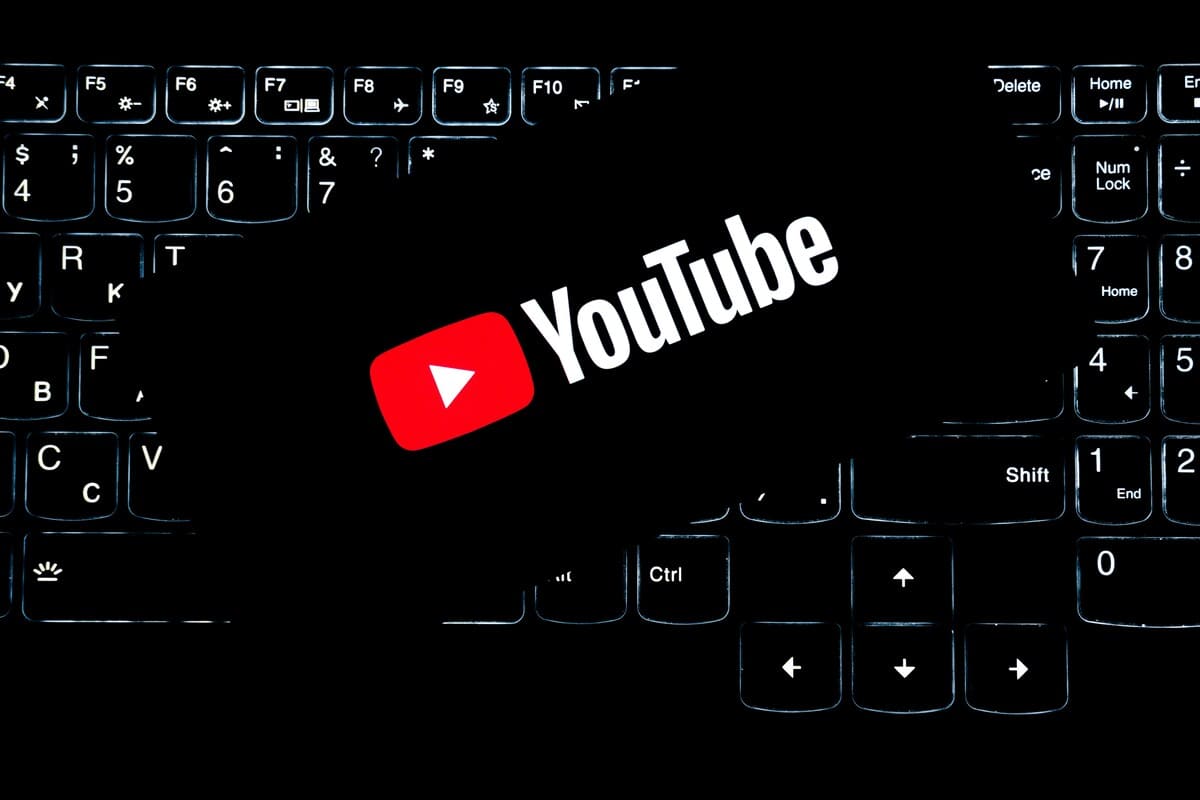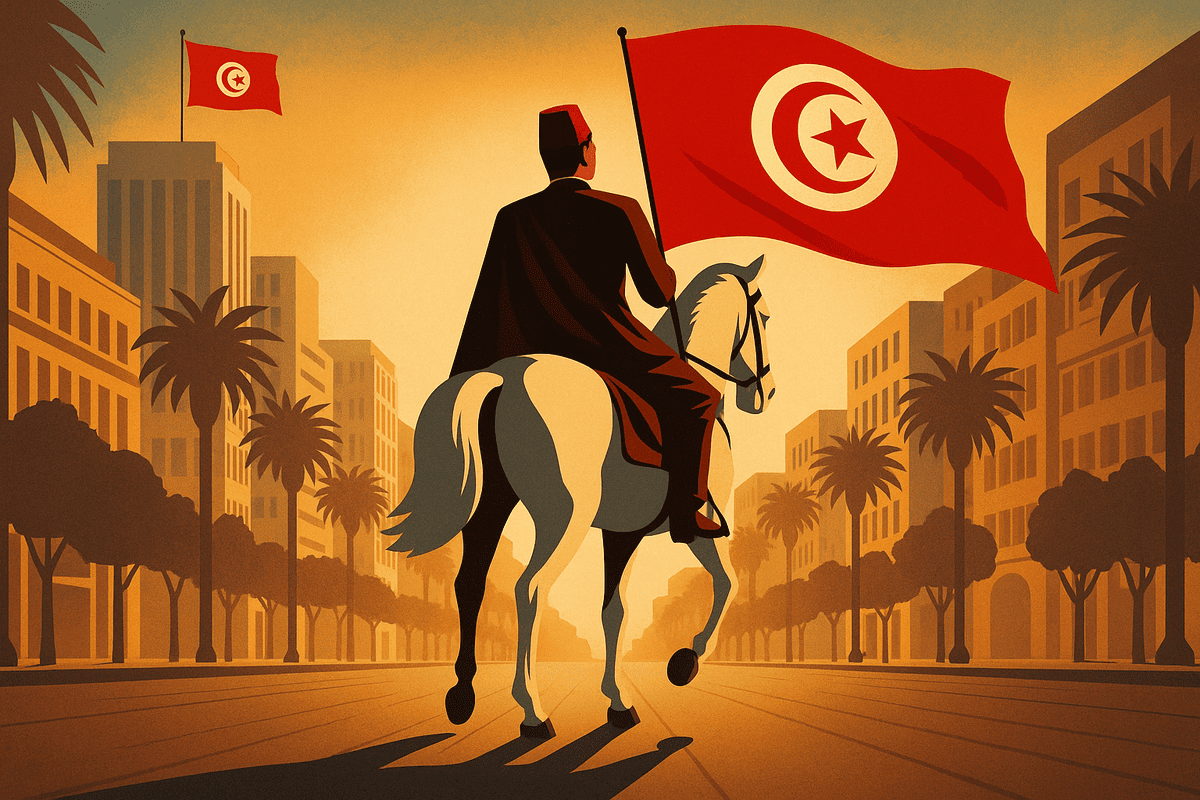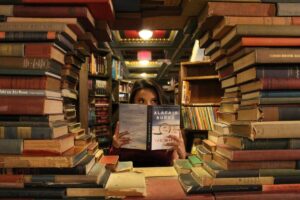La souveraineté, loin d’être un concept statique ou une abstraction juridique désincarnée, est le pouvoir inaliénable et suprême d’une nation à disposer d’elle-même, à forger son propre destin et à défendre ses intérêts vitaux, à l’abri de toute ingérence, qu’elle soit politique, économique, culturelle ou stratégique. C’est le fondement sur lequel repose l’autonomie d’un État et la dignité d’un peuple. Dans un monde de plus en plus interconnecté, mais aussi fragmenté par des luttes de pouvoir et des influences diffuses, la réaffirmation de la souveraineté est devenue un impératif catégorique pour toute nation désireuse de construire un avenir juste et résilient.
Une Trajectoire historique et sociologique de la Souveraineté
L’émergence du concept moderne de souveraineté est intrinsèquement liée à la naissance de l’État-nation. Des monarchies absolues aux républiques populaires, la question de qui détient le pouvoir suprême, le monarque, le peuple, la loi, a façonné les systèmes politiques. Le XIXe siècle, avec l’éveil des nationalismes, a vu la souveraineté se cristalliser autour de l’idée d’autodétermination des peuples, notamment face aux empires coloniaux. Pour des nations comme la Tunisie, l’accès à l’indépendance fut une conquête héroïque de cette souveraineté arrachée, marquant le début d’une nouvelle ère de construction nationale.
Habib Bourguiba, fondateur de la République tunisienne, insistait sur le fait que l’indépendance n’avait de sens que si elle se traduisait par une capacité réelle de décision dans tous les domaines vitaux de la nation : « Il ne s’agit pas seulement de chasser le colon, mais de nous rendre capables de gouverner par nous-mêmes, pour nous-mêmes. »
Cependant, la souveraineté n’est pas seulement une affaire de frontières ou d’institutions. Elle est profondément enracinée dans l’inconscient collectif d’un peuple, dans ses récits fondateurs, ses mythes et ses luttes. Sociologiquement, elle se manifeste par la capacité d’une communauté à préserver son identité profonde, ses valeurs, ses traditions, et à les faire évoluer en accord avec ses propres aspirations, sans les voir diluées ou dénaturées par des forces exogènes. « L’identité de faits », cette empreinte systémique de notre héritage sur nos comportements et notre vision du monde, est ainsi une composante essentielle de notre souveraineté intime.
Cette quête de souveraineté a, par ailleurs, été pensée et vécue différemment selon les civilisations et les époques. Dans la pensée arabo-musulmane, la notion de pouvoir suprême s’articule souvent autour de la souveraineté divine (Hakimiyyat Allah), qui impose aux gouvernants des principes cardinaux de justice (Adl), de consultation (Shura) et de bien-être de la communauté (Umma). Des penseurs aussi fondamentaux qu’Ibn Khaldun et Al-Farabi ont exploré, dans leurs réflexions sur l’État et la gestion de la cité, la manière dont l’autorité doit être exercée pour garantir l’ordre et le progrès, enracinant ainsi la souveraineté dans une responsabilité éthique et collective envers le divin et la société.
Dans cette logique, Jean-Jacques Rousseau affirmait que « La souveraineté ne peut être représentée », car elle appartient au peuple tout entier. La volonté générale ne se délègue pas ; elle se construit dans un processus démocratique conscient. Pour la Tunisie, cela signifie réinventer une forme d’expression souveraine à la fois enracinée et ouverte.
Plus récemment, à l’ère de la mondialisation et du numérique, des intellectuels occidentaux ont interrogé les mutations des formes de souveraineté. Des penseurs comme Manuel Castells ont mis en lumière l’émergence de nouvelles logiques de pouvoir, désormais structurées en réseaux transnationaux, échappant au contrôle des États-nations. De son côté, Michel Foucault a exploré les mécanismes complexes par lesquels le pouvoir s’exerce, non plus seulement par la coercition frontale, mais aussi par des systèmes de savoir, des normes et la régulation subtile des corps et des esprits (biopouvoir), défiant les notions classiques de souveraineté étatique et individuelle. Ces analyses contemporaines nous rappellent la nécessité de repenser la maîtrise du pouvoir et de l’identité dans un environnement globalisé et digitalisé, où les menaces sont plus diffuses et multiformes.
Comme le rappelait Ibn Khaldoun, « La souveraineté repose sur la force, la force repose sur la richesse, la richesse vient des impôts, les impôts dépendent de la justice, et la justice est la base de la souveraineté. » Cette chaîne logique nous rappelle que le cœur d’un État souverain ne réside pas uniquement dans son appareil militaire, mais dans la cohésion entre ses institutions économiques, judiciaires et sociales.
Le Souverainisme Tunisien face aux nouveaux défis de « l’Ère Globale »
La Tunisie, héritière d’une histoire millénaire de civilisations maritimes et terriennes, a toujours été un carrefour d’échanges, mais aussi un champ de bataille pour des influences extérieures. La période post-coloniale a été marquée par une quête de consolidation institutionnelle et économique. Cependant, l’ère de la mondialisation et les bouleversements géopolitiques contemporains posent des défis inédits à notre souveraineté, bien au-delà des frontières physiques ou des ingérences classiques que chacun connaît.
Des doctrines stratégiques visant à la déstabilisation de régions entières, des politiques économiques imposées par des institutions supranationales, ou encore l’érosion culturelle par une homogénéisation des modes de vie, ont menacé l’autonomie de décision et l’identité des nations. En Tunisie, la révolution de 2011, si elle fut une immense aspiration à la liberté, a aussi révélé la fragilité de nos structures face aux ingérences et la nécessité impérieuse de reprendre pleinement le contrôle de notre destinée. Les tentatives d’importer des modèles politiques inadaptés à notre sociologie profonde, sans tenir compte de notre « inconscient collectif », ont engendré instabilité et déception.
Mais aujourd’hui, de nouvelles menaces, plus insidieuses, pèsent sur notre souveraineté :
- La souveraineté culturelle et narrative à l’ère numérique : Comment garder la maîtrise de notre culture, de notre roman national et de nos valeurs lorsque notre jeunesse baigne dès son plus jeune âge dans les flux ininterrompus de séries Netflix, les algorithmes des plateformes sociales et les flots d’informations non maîtrisés ? Qui contrôle le récit, et comment s’assurer que notre singularité culturelle ne soit pas diluée par des influences exogènes massives ?
- La souveraineté technologique et de défense : Comment garantir notre autonomie stratégique lorsque chaque arme, chaque munition de nos forces de sécurité dépendent de l’étranger ? Notre capacité à nous défendre et à agir de manière indépendante est directement liée à notre maîtrise technologique et industrielle dans des domaines critiques.
- La souveraineté numérique et de l’intelligence artificielle : Le défi est d’autant plus pressant concernant les grandes technologies, et surtout l’intelligence artificielle. Lorsque l’IA devient la principale source d’aide à la décision dans des secteurs vitaux – de l’économie à la sécurité, en passant par la gouvernance – comment garantir que ces systèmes soient alignés avec nos intérêts nationaux et non avec ceux de leurs concepteurs étrangers ? Qui détient les algorithmes, les données, et donc le pouvoir de décision qui en découle ?
- La souveraineté alimentaire et sanitaire : La dépendance vis-à-vis des marchés étrangers pour l’approvisionnement en denrées essentielles ou en médicaments vitaux expose également notre nation à des vulnérabilités critiques, affectant directement la sécurité et le bien-être de notre population en cas de crise globale.
Ces nouvelles formes d’ingérence et de dépendance exigent une réflexion stratégique d’un niveau supérieur, allant bien au-delà des approches classiques.
La Vision INTILAQ 2050 : Une souveraineté maîtrisée pour tous les secteurs de la nation
Face à ces enjeux cruciaux, INTILAQ 2050 affirme une vision audacieuse et intégrale de la souveraineté. Notre souverainisme n’est pas un repli frileux sur soi, mais une affirmation puissante de notre autonomie, pour mieux nous projeter et interagir sur la scène internationale. Il s’agit de reconquérir la maîtrise de la décision dans chaque domaine essentiel de notre État et de notre société, afin de garantir une véritable autodétermination dans la construction d’un avenir réellement choisi, prospère, fidèle à notre identité, à nos valeurs et aux aspirations d’un peuple qui, en conscience, a choisi de confier le pouvoir de diriger la nation à ses représentants élus et à eux seuls. Cette ambition se concrétise par une série de « maîtrises » stratégiques, qui constituent les piliers de notre action et les fondements de notre République renouvelée. Elles sont la feuille de route pour une Tunisie forte, respectée et indépendante :
- Article 04.1 – La maîtrise du pouvoir : Redéfinir un régime politique adapté à notre histoire et à notre inconscient collectif, garantissant la légitimité et l’efficacité de l’autorité de l’État face aux impératifs géopolitiques.
- Article 04.2 – La maîtrise de notre vie politique : Rénover en profondeur notre code électoral, le financement des partis et les mécanismes de participation citoyenne, pour une démocratie authentique, résiliente aux i
- Article 04.3 – La maîtrise de nos frontières : Assurer la sécurité et l’intégrité de notre territoire, socle inviolable de notre souveraineté influences et véritablement représentative.
- Article 04.4 – La maîtrise de notre identité : Cultiver et faire évoluer notre roman national, nos valeurs, notre héritage culturel et nos pratiques sociales, en reconnaissant et protégeant notre diversité au sein d’une communauté nationale unifiée.
- Article 04.5 – La maîtrise de notre langue : Revaloriser notre langue nationale et développer une stratégie linguistique ambitieuse pour l’unité, la transmission du savoir et le rayonnement régional et international.
- Article 04.6 – La maîtrise de notre justice : Établir une justice indépendante, transparente et équitable, véritable pilier de l’État de droit et garante des droits et libertés de chaque citoyen.
- Article 04.7 – La maîtrise de notre monnaie : Retrouver le contrôle de nos leviers monétaires et financiers pour garantir la stabilité économique, la souveraineté budgétaire et la protection de nos choix de développement face aux ingérences extérieures.
- Article 04.8 – La maîtrise de nos dépendances stratégiques : Identifier, réduire et sécuriser nos vulnérabilités structurelles dans les domaines critiques (énergie, alimentation, médicaments, cybersécurité, technologies…) afin d’assurer notre résilience nationale en toutes circonstances.
- Article 04.9 – La maîtrise holistique du développement de la nation : Concevoir une stratégie intégrée de développement national fondée sur la justice sociale, l’harmonie territoriale, la durabilité écologique et la participation active du peuple dans la construction de son avenir.
Ces neuf maîtrises constituent le cœur de notre engagement pour une Tunisie qui, consciente de notre passé, lucide sur notre présent, nous donne les moyens de décider pleinement et en conscience de notre propre avenir, pour le bien-être de notre peuple et le rayonnement de notre nation.
Articles suivants (Ordre logique de lecture)
- All Post
- Actualités
- Article
- Conférences et formations
- Humeurs
- La fondation
- La résilience
- La souveraineté
- La Tunisie éternelle
- Le manifeste
- Le plan de transformation
- Les essentiels
- Non classé
- Nos principes directeurs
- Back
- Le modèle de gouvernance de l'état

Une grille de lecture hydrologique des civilisations (MAJ Juin 2025) Notre vision du monde classe les civilisations humaines en deux grandes méta-catégories : celles qui se sont développées avec l’abondance d’eau potable et celles qui se sont construites sur le déficit d’eau potable. Les premières ont élaboré un modèle de...

Réforme du Code Électoral : Des fondations solides pour une vie politique renouvelée (MAJ Juin 2025) Nous nous engageons résolument dans une réforme complète et indispensable de notre code électoral, pierre angulaire d’une démocratie saine et fonctionnelle. Cette refonte est guidée par des principes fondamentaux destinés à corriger les défaillances...