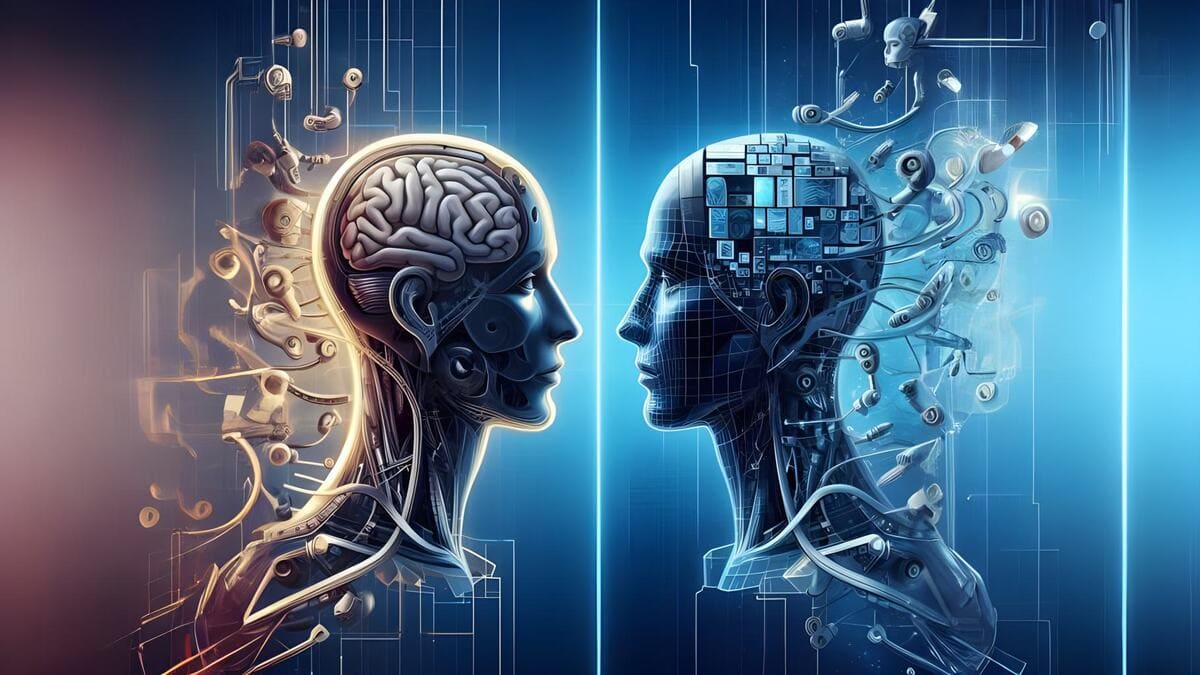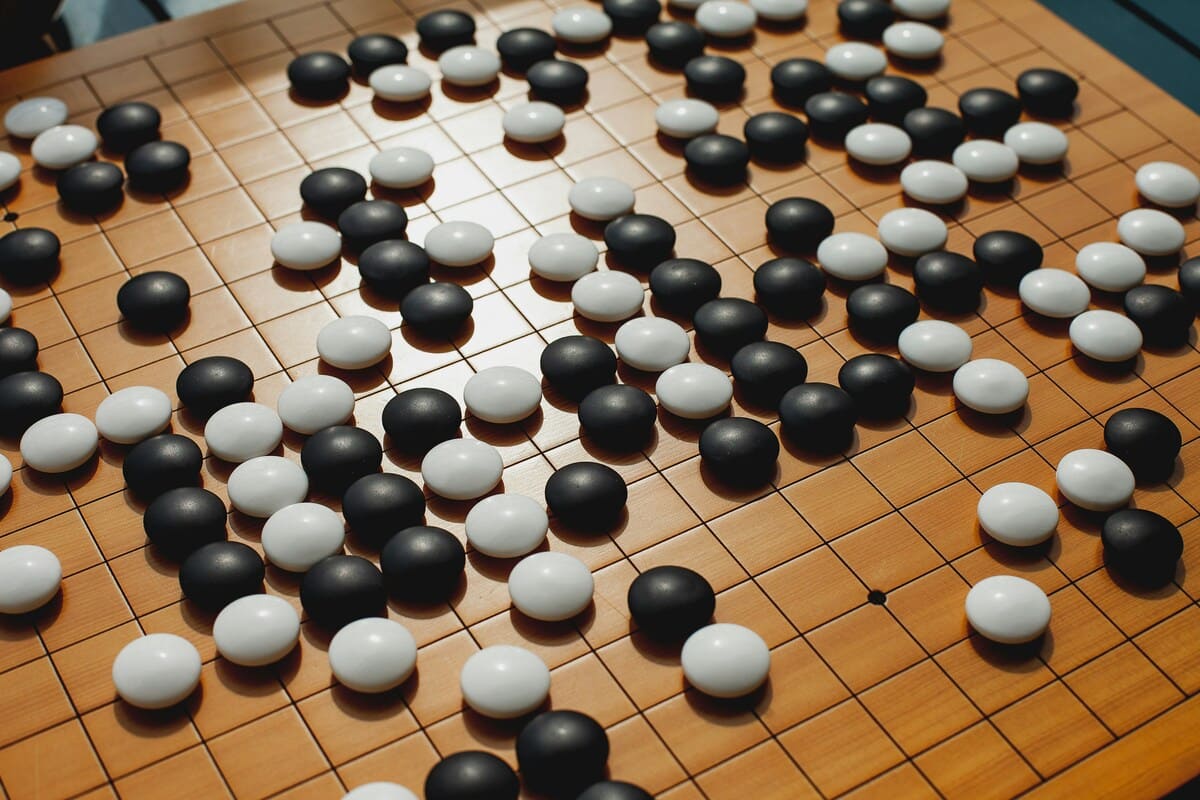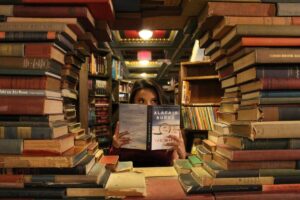Notre identité nationale est au cœur de notre vision souverainiste. Elle transcende les réductions simplistes et excluantes, dans une vision inclusive fondée sur notre passé et tournée vers un avenir de paix, de modernité et de résilience.
Pour être clair, nous rejetons avec vigueur et sans discussion, les idéologies qui définissent l’identité sur des bases raciales ou qui la restreignent à la seule dimension religieuse.
Par notre adhésion à ce manifeste, nous affirmons que l’identité de notre nation est un concept profondément complexe et multidimensionnel. Elle s’articule autour d’un ensemble dynamique d’éléments distinctifs et de caractéristiques partagées qui nourrissent à la fois un puissant sentiment d’appartenance et la singularité de notre communauté nationale, qui se veut une et indivisible.
Ainsi, cette identité se doit d’être indissociable dans sa richesse et sa diversité, et constitue le ciment inaliénable de notre unité.
Note de méthode – À lire avant de découvrir l’article 4.4.Bis
Cet article fait partie intégrante de notre manifeste fondateur, et a pour objectif de formaliser notre vision (notre idéologie) à travers la déclinaison de nos quatre grandes valeurs.
La préservation de notre identité en est une composante essentielle, indissociable de notre souveraineté collective.
Les articles du manifeste ont pour vocation de décrire notre Tunisie idéale et éternelle, telle que nous la rêvons et la pensons pour 2050.
Ils ne constituent pas en eux-mêmes le plan de transformation opérationnel INTILAQ 2050, qui sera publié selon une méthode rigoureuse, à la suite des étapes de fondation que nous avons posées.
Mais pour répondre à de nombreuses demandes de lecteurs, chercheurs ou décideurs curieux de mieux comprendre la nature des propositions concrètes que nous portons, nous avons décidé de publier cet article 4.4.Bis, qui reprend l’article 4.4 original (« La maîtrise de notre identité »), enrichi de trois volets :
- Un extrait illustratif de nos propositions stratégiques issues du plan de transformation ;
- Une estimation des emplois directs et indirects générés ;
- Une projection chiffrée de l’investissement nécessaire sur 10 ans.
Cet article n’a pas vocation à détailler l’ensemble de notre vision sectorielle. Des sujets comme les musées, l’archéologie, les arts, les langues, ou le patrimoine territorial feront l’objet d’un traitement complet dans notre plan de transformation finalisé.
Nous insistons sur le respect de notre démarche méthodologique structurée, qui repose sur une progression claire et assumée :
- Le manifeste : pour affirmer notre vision idéologique
- Les enjeux de civilisation et de société
- Les principes directeurs de reconstruction de notre système productif
- Le plan d’urgence national
- Le plan de transformation complet, structuré en deux streams :
- Stabilisation des douleurs de la nation
- Transformation systémique et souveraine de la nation
Nous croyons que seule une méthode exigeante permet de porter des solutions réellement innovantes, courageuses, parfois radicales, capables de remettre en cause l’ensemble du système existant.
C’est à ce prix que nous regagnerons notre souveraineté culturelle, économique et sociale.
Héritage culturel : Le fondement de notre conscience collective
Nous sommes profondément et sincèrement dédiés à la sauvegarde et à la valorisation de notre patrimoine culturel, véritable trésor national.
Nos traditions ancestrales, nos coutumes, nos mythes et légendes ne sont pas de simples reliques du passé : elles sont les fondations vivantes de notre conscience collective et le miroir de l’âme tunisienne.
Notre engagement va bien au-delà de la simple préservation de cet héritage. Avec force, nous nous engageons activement à son évolution dynamique, à son enrichissement continu, à sa promotion à l’échelle nationale et internationale, et à son partage intergénérationnel et universel.
Pour cela, nous mettrons en œuvre :
- Un programme national des « Trésors humains vivants » (il faut trouver un meilleur nom), sur le modèle de l’UNESCO, afin d’identifier, rémunérer et soutenir les maîtres-artisans, conteurs, musiciens traditionnels, agriculteurs, éleveurs, ou détenteurs de savoir-faire rares, en les plaçant au cœur d’un réseau de transmission dans les écoles et maisons de culture. Une plateforme nationale multimédia accompagnera ce programme pour numériser ces savoirs, les mettre en scène grâce à l’intelligence artificielle, et faciliter leur diffusion. Les associations régionales seront mobilisées pour identifier les porteurs de ces savoirs et les accompagner dans le recueil de leur histoire.
- Le principe du « 1 % artistique tunisien » : chaque construction publique intégrera une œuvre inspirée de notre patrimoine, à l’image du modèle français mis en place en 1951, pour réaffirmer la présence de la culture dans l’espace public.
- Un Fonds d’innovation sociale culturelle, financé en partie par la diaspora et les entreprises à travers des dons défiscalisés, permettra de soutenir la création de festivals ruraux, de résidences artistiques itinérantes et de contenus numériques (podcasts, web séries, plateformes artistiques) célébrant nos racines.
- Un plan d’urgence pour le patrimoine artistique national : dès la création du nouveau ministère de la Culture, un audit complet sera lancé pour identifier les milliers d’œuvres acquises depuis l’époque de Bourguiba grâce à une allocation budgétaire dédiée à l’achat d’œuvres tunisiennes et maghrébines (peinture, sculpture, art). Ces œuvres, souvent oubliées dans les sous-sols ou entrepôts, seront restaurées, exposées et intégrées à notre réseau de néomusées « Beit Al Fan », mêlant musées, enseignement artistique, conférences, espaces de bien-être et de loisir, et incubateurs de startups culturelles. Certaines œuvres pourront être louées à l’international ou mises aux enchères si jugées non stratégiques, pour financer ce réseau.
- La plus grande collection d’art islamique au monde, plus de 120 000 pièces tunisiennes sera enfin valorisée : un audit exhaustif permettra d’inventorier ces œuvres et de les numériser en 3D pour nourrir notre stratégie de tourisme virtuel. À titre d’exemple, Kairouan sera proclamée capitale des arts, des savoirs et de la philosophie islamique, et accueillera un « Beit Al Fan » majeur, intégrant : un musée de 200 000 œuvres, une école d’art islamique, maghrébin et contemporain, des espaces de débats, de projection, de méditation, une maison de la calligraphie, des jardins, cafés, librairies, un marché d’artisans, un FabLab patrimonial, un centre de numérisation, une BnF islamique, des résidences d’artistes et des archives ouvertes.
- Un programme d’urgence pour les sites archéologiques : plus de 30 000 sites historiques sont aujourd’hui à l’abandon. Ils seront cartographiés, restaurés, sécurisés et intégrés à nos nouvelles routes du savoir et de la connaissance, reliant lieux, récits et éducation.
- Une campagne nationale de rachat ou de location d’objets culturels privés, notamment des livres, œuvres d’art et objets rares conservés par des familles tunisiennes, permettra d’enrichir nos collections publiques. Parallèlement, une campagne de numérisation offrira à ces objets une seconde vie numérique.
- Le lancement d’une plateforme nationale de streaming culturel tunisien, accessible gratuitement aux écoles et aux familles, permettra de diffuser documentaires, captations théâtrales, récits animés, contes, concerts, séries et interviews de créateurs. Cette plateforme sera nourrie par des appels à projets régionaux et ouverte aux créateurs indépendants.
- La création d’un Campus national des métiers du patrimoine, une école supérieure dédiée à la restauration, à la muséographie, à la conservation numérique, à la scénographie ou encore à l’archivage des savoirs immatériels. Cette école formera les futurs experts de notre souveraineté patrimoniale.
- Un label « Artisanat national d’exception », garantissant l’authenticité, la qualité et l’origine des objets issus de savoir-faire uniques (tapis, tissage, poterie, cuivre, etc.). Ce label permettra de soutenir l’export, d’augmenter la valeur ajoutée locale et de structurer une filière d’excellence tunisienne.
- L’intégration de la culture vivante à l’école : chaque établissement scolaire sera jumelé avec un centre culturel ou un artiste local pour permettre à chaque enfant de vivre au moins un projet artistique par an. Une révolution douce mais durable dans l’éducation à la fierté locale.
- Un passeport culturel tunisien, physique pour les enfants, numérique pour les jeunes adultes, leur permettra de tracer leurs visites culturelles, d’accéder à des avantages ou de recevoir des ouvrages et invitations selon leur parcours.
- La Nuit nationale des patrimoines vivants sera instaurée dans chaque région : une nuit annuelle de fête, de spectacle vivant, de transmission orale, d’ateliers d’artisanat, de musique, de cuisine et de projection, pour reconnecter les familles à leur culture.
- La création d’une Archive orale nationale participative, appuyée par une application mobile et des dispositifs fixes, permettra de recueillir les récits de vie, proverbes, chansons, traditions, mémoires régionales, et de les classifier à l’aide de l’intelligence artificielle pour en faire un bien commun accessible à tous.
Ces actions concrètes viseront à faire de notre culture un vecteur de fierté, d’unité et de rayonnement, un pont entre notre passé glorieux et un avenir que nous construisons ensemble, où chaque citoyen est un gardien et un acteur de notre richesse identitaire.
Comportements, civilité et pratiques sociales : Un dialogue pour l’avenir
Nous reconnaissons que certains aspects de notre modèle social traditionnel, bien qu’enracinés, ne correspondent plus entièrement aux aspirations profondes de notre jeunesse et aux dynamiques contemporaines. Des domaines aussi variés que la sexualité, le mariage, l’héritage, les modes de vie, ou même les interactions sociales et intergénérationnelles, sont concernés par cette évolution naturelle.
Pour bâtir un avenir harmonieux, un grand débat national sera initié sans délai, s’inscrivant au cœur de notre plan d’urgence. Ce dialogue ne sera ni idéologique ni moraliste, mais ouvert, structuré, enraciné dans notre réalité. Il constituera le point de départ d’un vaste programme de transformation sociale audacieux et inclusif, conçu pour la jeunesse et avec elle.
Ce programme visera à poser les bases d’un nouveau contrat social fondé sur le respect mutuel, l’autonomie individuelle, l’égalité des chances et la solidarité collective. Il se concrétisera notamment par :
- La mise en place du « Umuganda tunisien », une demi-journée mensuelle de service civique régional (nettoyage, plantations, réfection d’écoles, entretien de places publiques) pilotée par les municipalités, les écoles et les associations de jeunes. Ce rituel mensuel d’utilité publique, inspiré du Rwanda où plus de 80 % des citoyens y participent, permettra de recréer du lien social, du respect de l’espace collectif et un sentiment d’utilité commune.
- Une plateforme nationale de débat civique, ouverte à tous les citoyens et construite autour de principes de démocratie participative. Elle permettra d’initier des propositions, de voter, d’amender des idées et de débattre sur les normes sociales, les valeurs à faire évoluer, les règles de civilité à partager. Ce système numérique s’inspire du modèle de « vTaiwan », où des consensus publics émergent sur des sujets sensibles sans polarisation.
- La création d’espaces de dialogue intergénérationnels, physiques dans les maisons de quartier, bibliothèques ou universités populaires, mais aussi numériques via des plateformes d’échange. Ces espaces permettront aux générations de dialoguer sur leurs représentations du monde, leurs blessures communes, leurs attentes respectives. Ils seront animés par des médiateurs formés, pour garantir un dialogue profond, respectueux et productif.
- Un cadre de soutien à l’innovation sociale, à travers des appels à projets dans chaque gouvernorat, visant à expérimenter de nouveaux modèles de famille, de parentalité, de vie communautaire, de colocation intergénérationnelle, d’habitat solidaire ou de lieux d’accueil alternatifs. Ces expériences pilotes seront accompagnées, évaluées et, si elles réussissent, répliquées à grande échelle.
- La mise en œuvre d’un programme national d’éducation civique renouvelée, conçu pour déconstruire les comportements nocifs (violence domestique, harcèlement, incivilité, corruption ordinaire…), réhabiliter la notion de bien commun, et diffuser une culture de la responsabilité et du respect mutuel. Ce programme s’appuiera sur des formats pédagogiques innovants (web-séries, jeux de rôle, théâtre participatif, BD interactives, challenges entre classes ou quartiers, etc.).
- L’instauration d’un baromètre national du civisme et des pratiques sociales, fondé sur des enquêtes régulières mesurant le respect des règles, la civilité dans l’espace public, le sens de la responsabilité collective, et le niveau de confiance dans les normes sociales partagées. Il servira à piloter les politiques publiques et à ajuster les actions de terrain.
- L’organisation de forums citoyens dans chaque région, une fois par an, pour faire remonter les attentes sociales, les transformations culturelles à l’œuvre, et les tensions à apaiser. Ces forums seront également l’occasion de célébrer les pratiques sociales positives, de valoriser les initiatives locales et de renforcer la cohésion nationale.
Ce chantier de transformation sociale ne cherchera pas à imposer un modèle unique, mais à ouvrir les possibles, à valoriser les expériences réussies, et à garantir à chacun le droit de vivre selon ses convictions dans le respect des règles communes. Car une nation forte se construit aussi par la qualité de ses comportements quotidiens, le respect de ses diversités internes et la capacité à réinventer un vivre-ensemble à la hauteur de son époque.
Valeurs et croyances : Fondements d’une identité fédératrice et juste
Nous protégeons et respectons la diversité des convictions politiques, des rites, des pratiques et des croyances spirituelles et religieuses. Cette diversité constitue la richesse même de notre identité nationale. Elle ne doit jamais être un facteur d’opposition ou de hiérarchisation, mais une source de compréhension, de dialogue et de vitalité collective.
Pour garantir cette vision, nous lancerons une série d’actions structurantes :
- La création d’une Commission « Vérité, Sciences et Réconciliation », destinée à restaurer la confiance par un travail de mémoire sur les traumatismes collectifs, les épisodes de violence ou d’exclusion, notamment ceux vécus par des communautés marginalisées. Cette commission travaillera en lien avec les historiens, les scientifiques, les témoins et les familles, en s’inspirant de la démarche canadienne de réconciliation nationale.
- L’adoption d’une Charte nationale des droits et devoirs envers la communauté, document fondateur qui clarifiera les principes d’inclusion, d’égalité, d’appartenance, de pluralisme et de responsabilité partagée au sein de la communauté nationale. Cette charte aura une portée symbolique, éducative et juridique.
- L’intégration dans les programmes scolaires d’une histoire inclusive, rendant hommage à toutes les composantes de notre société : les juifs de Tunisie, les chrétiens, les berbères, mais aussi les communautés italiennes, françaises ou andalouses qui ont marqué notre culture, notre architecture, notre gastronomie, notre musique et nos villes.
- L’instauration dans le calendrier national de jours fériés symboliques reconnus, à commencer par une fête juive (comme Yom Kippour ou Pessah), Noël pour les chrétiens, et Yennayer, le Nouvel An amazigh. Ces journées deviendront des fêtes nationales à part entière. Elles ne seront pas seulement des jours chômés, mais des moments de dialogue culturel, de festivités interreligieuses et de médiation symbolique, célébrant la pluralité tunisienne.
- Un audit des bibliothèques publiques et centres culturels sera mené afin d’évaluer et garantir l’accessibilité réelle de toutes les communautés à une offre culturelle diversifiée. Cet audit identifiera les manques, les déséquilibres et les besoins spécifiques (langues, ouvrages de référence, représentations, etc.), notamment en arabe, amazigh, français et autres langues pratiquées. Il servira de base à une stratégie de diversification des fonds, des formats et des médiations.
- La création d’un Observatoire des pratiques et croyances sociales, structure consultative rattachée à la Présidence, qui aura pour mission de :
- Assurer une veille sur les dynamiques d’inclusion, les discriminations ou les tensions sociales liées à des pratiques culturelles ou religieuses ;
- Lutter contre les dérives sectaires, les pratiques coercitives ou manipulatoires, en collaboration avec les instances religieuses, éducatives et judiciaires ;
- Produire des recommandations publiques sur les équilibres à préserver entre liberté individuelle, cohésion nationale et laïcité positive.
- La mise en place de cycles de formation civique et culturelle dans les lycées et universités, autour des grandes traditions spirituelles présentes en Tunisie, des principes d’éthique républicaine et des figures historiques du dialogue interculturel (Ibn Khaldoun, Abdelwahab Meddeb, Albert Memmi, etc.).
- L’ouverture de « Maisons de la Pluralité » dans chaque capitale régionale, lieux de rencontre, d’exposition, de dialogue interconvictionnel et de médiation culturelle, animées par des associations locales et appuyées par l’État.
Ces mesures visent à transformer la diversité tunisienne en un socle conscient, assumé et célébré de notre république renouvelée. Une république où chaque Tunisien, quelle que soit sa croyance ou son origine, se sent pleinement membre d’une seule et même communauté nationale, fondée sur la justice, la fraternité et le respect mutuel.
Histoire commune : Un roman national d’unité et de résilience
Nous construirons un récit national fondé sur l’intégrité scientifique, la participation citoyenne et l’ouverture culturelle. L’histoire ne doit plus être une suite figée de dates à réciter, mais un moteur de fierté, de transmission et de compréhension collective. Notre objectif est de transformer la mémoire en levier de cohésion nationale et de résilience démocratique.
Pour cela, nous mettrons en œuvre :
- La création d’un Institut national des luttes et résistances tunisiennes, accompagné de son musée central. Il aura pour mission de documenter, préserver et mettre en valeur les grandes luttes qui ont façonné la Tunisie : résistance contre les occupations, combats syndicalistes, luttes des femmes, mouvements étudiants, révoltes populaires. Ce musée mêlera archives, témoignages oraux, installations interactives et expositions itinérantes.
- Le développement du musée numérique immersif « Tunisie 3000Y », une plateforme nationale accessible gratuitement pour les élèves, les chercheurs et les touristes. Elle proposera une reconstitution 3D des grandes périodes de notre histoire, des visites guidées en réalité virtuelle, et des outils pédagogiques interactifs. Ce projet s’inspire d’initiatives comme « Europeana » ou le British Museum VR Lab.
- Un programme de sensibilisation à l’histoire tunisienne dans les écoles, co-construit avec les historiens, archéologues, artistes et enseignants. Il mettra l’accent sur les récits incarnés, les personnages méconnus, les récits locaux et les objets patrimoniaux. Les élèves découvriront leur passé à travers des expériences sensibles, créatives et participatives.
- La transformation de la ville d’El Jem en site historique vivant, à travers la reconstitution d’une ville romaine à taille réelle. L’objectif est de permettre une immersion complète dans la vie quotidienne de l’époque, avec des parcours scénarisés, des artisans en résidence, et des spectacles grand public dans l’amphithéâtre restauré. Le modèle sera inspiré du « Puy du Fou » en France, avec une narration centrée sur l’histoire tunisienne.
- La création d’une chaîne nationale culturelle et historique, diffusant documentaires, archives, débats, séries historiques, reconstitutions, interviews d’experts et formats jeunes. Cette chaîne valorisera également la recherche tunisienne et les travaux des universités.
- Un soutien renforcé à la recherche historique, archéologique et anthropologique, avec des budgets dédiés, des bourses doctorales, des partenariats internationaux et des campagnes annuelles de fouilles dans chaque région. Les résultats seront mis à disposition du public via les musées, les médias et les écoles.
- La refonte des filières éducatives liées à l’histoire, pour les moderniser et les ancrer dans les pratiques de recherche contemporaine. Les étudiants en histoire et en patrimoine seront formés à l’utilisation de l’IA, de la modélisation 3D, des SIG historiques, de l’analyse de données, de la cartographie interactive et de la narration numérique.
- La mise en place d’un vaste programme de recherche internationale sur l’histoire tunisienne, en partenariat avec des universités du Sud et du Nord, pour réinscrire notre récit dans les dynamiques régionales et globales, et déconstruire les lectures coloniales encore dominantes.
- La reconnaissance des figures historiques plurielles : au-delà des grandes figures classiques, notre projet mettra en lumière les résistants anonymes, les femmes oubliées, les savants tunisiens méconnus, les minorités actives, les bâtisseurs des époques carthaginoise, aghlabide, hafside, andalouse, ottomane ou beylicale.
Cette histoire partagée ne sera ni nostalgique ni instrumentalisée. Elle sera un outil de vérité, de fierté, de lien, et surtout d’avenir. Car une nation ne peut pas se projeter sans mémoire. Et une mémoire digne ne se construit que dans l’honnêteté, la transmission, la complexité assumée et l’accès égal pour tous.
Symboles nationaux : Ancrage de notre identité et de notre avenir
Les symboles d’une nation ne sont jamais figés. Ils incarnent une vision, une mémoire collective, un imaginaire partagé et une projection vers l’avenir. Drapeaux, armoiries, hymnes, monuments, emblèmes : ces représentations ne doivent pas être réduites à des artefacts institutionnels, mais devenir les vecteurs vivants d’une identité assumée, unifiée et dynamique.
Dans cette optique, nous enrichirons nos symboles nationaux à travers les actions suivantes :
- Une refonte participative des armoiries de la République, via un concours national ouvert aux artistes, historiens, graphistes et jeunes talents. Le projet retenu fera l’objet d’un vote citoyen sécurisé, organisé à l’échelle nationale, s’inspirant du processus exemplaire mené par la Nouvelle-Zélande lors de son référendum sur le drapeau en 2015. Cette refonte devra refléter les valeurs de notre république renouvelée : souveraineté, modernité, justice, unité et diversité.
- La création de nouveaux emblèmes pour nos forces de sécurité et de défense, afin de redonner à nos institutions une représentation visuelle forte, respectée et moderne. Ces emblèmes devront refléter la mission de protection du citoyen, l’éthique républicaine, la souveraineté nationale et l’attachement à la loi. Chaque force (police, garde nationale, armée, protection civile, renseignement, cyberdéfense) bénéficiera d’un emblème spécifique, élaboré en concertation avec les acteurs de terrain.
- La construction de nouveaux monuments emblématiques dans toutes les régions, en concertation avec les habitants, les artistes et les historiens locaux. Ces monuments incarneront nos grandes époques, nos martyrs, nos figures méconnues, nos savoirs anciens, nos résistances populaires et nos luttes contemporaines. Ils seront conçus comme des lieux vivants (scènes culturelles, lieux de rencontre, expositions en plein air), et non comme de simples objets figés dans l’espace public.
- La création d’un Itinéraire national des symboles, un parcours culturel, éducatif et touristique reliant les grands symboles matériels (monuments, sites mémoriels, musées) et immatériels (hymnes, discours historiques, récits populaires, objets patrimoniaux). Chaque étape sera dotée d’une signalétique unifiée et d’un contenu numérique en réalité augmentée accessible via une application publique.
- L’introduction d’un volet « symboles et citoyenneté » dans les programmes scolaires, pour permettre aux enfants et adolescents de comprendre, questionner, s’approprier et même proposer des symboles, tout en réfléchissant aux valeurs qu’ils véhiculent. Des ateliers de création d’hymnes locaux, de drapeaux de classe ou de cérémonies symboliques renforceront l’éducation civique par l’expérience.
- La rénovation de nos cérémonies nationales : la fête de l’indépendance, le 1er juin (réforme agraire), le 20 mars, le 14 janvier (la révolution) et d’autres, seront repensées avec des formats plus inclusifs, ancrés dans les territoires, avec une participation active des citoyens, des artistes, des jeunes et des institutions locales.
- Un programme d’art public monumental, soutenu par un fonds dédié, permettra à chaque capitale régionale de faire appel à des artistes contemporains pour créer une œuvre monumentale exprimant l’identité de leur territoire, dans une vision fédératrice et futuriste.
- La généralisation de la signalétique symbolique dans l’espace public : chaque rue, place, édifice public devra progressivement intégrer une plaque ou un dispositif expliquant le choix du nom, la signification historique, et son lien avec la mémoire tunisienne. Cela permettra de faire de chaque pas dans l’espace public une expérience de mémoire collective.
- Par ces actions, nous voulons restaurer la puissance symbolique de l’État, renforcer l’attachement collectif à nos institutions et réconcilier notre peuple avec son histoire. Car sans symboles vivants, il n’y a ni mémoire incarnée, ni vision partagée. Et sans vision partagée, il ne peut y avoir d’avenir commun.
Territoire : Socle de notre identité et pilier de développement
Le territoire tunisien n’est pas une simple entité géographique. Il est le creuset historique, culturel et économique de notre identité collective. Il incarne notre héritage, notre diversité, nos ressources naturelles et humaines, et notre capacité à bâtir un avenir commun.
Nous proposerons la labellisation de « Bioterritoires tunisiens », un dispositif structurant et ambitieux qui fera de chaque région un pôle de développement autonome, cohérent, enraciné dans ses spécificités et tourné vers l’innovation. (Voir chapitre sur la résilience)
Chaque gouvernorat sera invité à identifier son écosystème stratégique dominant qu’il soit agricole (huile d’olive, dattes, céréales, plantes médicinales), artisanal (tapis, poterie, tissage), culturel (villes saintes, musées, festivals), écologique (zones humides, désert, forêt), ou technologique (universités, technopoles, pôles logistiques).
Les territoires labellisés bénéficieront de plusieurs leviers d’appui :
- Un guichet unique de soutien régional, facilitant l’accès aux financements, à la formation, au conseil et à la simplification des démarches administratives pour les initiatives locales.
- Des incitations fiscales ciblées, attractives pour les PME, les coopératives, les investisseurs ou les porteurs de projets engagés dans la valorisation du territoire : exonérations, allègements fiscaux, déductions sur réinvestissement local, etc.
- Un accompagnement technique multidisciplinaire, mobilisant urbanistes, agronomes, designers, architectes, experts en circuits courts, sociologues ou écologues pour coconstruire une stratégie durable de développement local.
- Un Fonds national des territoires créatifs, abondé par l’État, les partenaires internationaux et les entreprises citoyennes, qui financera les projets emblématiques à fort impact identitaire, social et économique.
- Une plateforme numérique des Bioterritoires, accessible à tous, pour promouvoir chaque territoire, ses savoir-faire, ses récits, ses ressources, ses produits, ses talents, ses sites remarquables et ses projets en cours. Elle servira aussi d’interface entre citoyens, chercheurs, acteurs publics et investisseurs.
- Des écoles du territoire et de la résilience, dans chaque gouvernorat, pour former les jeunes aux métiers d’avenir liés à leur région : gestion des ressources naturelles, tourisme responsable, patrimoine, artisanat, numérique rural, économie circulaire, etc.
- L’intégration des Bioterritoires dans les programmes éducatifs, dès le collège, avec des visites, des projets pédagogiques, des partenariats avec les structures locales et une carte interactive des écosystèmes régionaux.
Ce dispositif, inspiré du réseau des « Creative Cities » de l’UNESCO, mais adapté aux réalités tunisiennes, permettra :
- De restaurer la fierté locale en valorisant les identités régionales dans une dynamique nationale.
- De réduire les inégalités territoriales en stimulant des dynamiques propres à chaque région, loin des modèles centralisés et uniformes.
- De favoriser la cohésion nationale, en transformant notre diversité géographique en force collective au service du développement souverain.
Le territoire, loin d’être une variable d’ajustement technique, sera pleinement reconnu comme socle de notre identité et pilier stratégique de notre avenir commun.
Langue : Pilier de notre identité et vecteur d’avenir
La langue est bien plus qu’un outil de communication : elle est la structure de notre pensée, le véhicule de notre mémoire, et le socle vivant de notre souveraineté culturelle. En Tunisie, l’absence de stratégie linguistique claire a entraîné une perte de repères, une confusion éducative, et une fracture entre les élites et le peuple.
Notre stratégie, décrite dans notre article « la maitrise de notre lange » vise à faire du tunisien une langue à part entière, au même titre que le maltais qui a suivi ce chemin à Malte. Cette démarche s’appuiera sur une institution centrale : l’Académie de la langue tunisienne, chargée de formaliser sa grammaire, son vocabulaire, ses usages, ses outils éducatifs et son rayonnement dans les arts, la recherche, l’audiovisuel et la diplomatie culturelle.
Nous engagerons les actions suivantes :
- La création de 1 000 manuels scolaires et techniques en arabe standard, dialectal tunisien et amazigh, dans des domaines aujourd’hui dominés par l’anglais ou le français : intelligence artificielle, design, biotechnologie, écologie, économie circulaire, gouvernance, droit, etc. Ces contenus seront produits en open source, validés par des commissions académiques et alimentés par des contributions citoyennes, dans un modèle inspiré de l’Estonie (librairie numérique publique).
- La création de l’Académie de la langue tunisienne, en tant qu’autorité de référence, indépendante, dotée de moyens suffisants et rattachée à la Présidence. Elle pilotera la codification, la publication d’ouvrages de référence, la certification linguistique, l’introduction du tunisien dans les technologies (IA, interfaces vocales, traduction automatique) et l’intégration du dialecte dans l’éducation et les médias.
- Un programme de terminologie arabe et tunisienne moderne, co-construit avec des experts scientifiques, linguistes, ingénieurs et créateurs, pour fournir une base de vocabulaire à jour dans les domaines de l’innovation, du numérique, des sciences sociales et de l’intelligence artificielle. Cette terminologie sera diffusée via des API ouvertes à tous les développeurs tunisiens (médias, startups, plateformes éducatives).
- Le lancement d’une plateforme nationale de traduction et de co-création linguistique, qui permettra à tout citoyen, étudiant ou enseignant, de proposer des traductions, des néologismes, des reformulations, sous supervision académique. Elle encouragera l’innovation langagière et la création de contenus originaux.
- L’introduction du tunisien et de l’amazigh dans les programmes éducatifs comme langues premières, notamment dans les premières années de scolarité, pour renforcer l’ancrage cognitif et culturel des élèves, tout en assurant une transition maîtrisée vers l’arabe standard et les langues étrangères.
- Une politique linguistique des médias, avec l’obligation progressive de proposer des contenus en arabe clair et en dialecte tunisien de qualité. Un soutien sera apporté à la création de séries, documentaires, formats web, émissions scientifiques ou culturelles dans ces langues.
- La reconnaissance officielle du multilinguisme tunisien, en tant que richesse nationale. Des cursus d’excellence seront proposés en anglais et en français, notamment pour les filières internationales, mais dans le respect d’un socle linguistique national fort, stable et partagé.
- La numérisation de notre patrimoine linguistique, à travers un grand projet d’archivage sonore et écrit des contes populaires, proverbes, chants, sermons, correspondances et discours historiques, pour alimenter à la fois la mémoire nationale et les futures intelligences artificielles tunisiennes.
- L’intégration de la langue tunisienne dans notre diplomatie culturelle, à travers des festivals, productions audiovisuelles, traduction d’œuvres tunisiennes, présence sur les grandes plateformes numériques mondiales, et partenariats avec les diasporas tunisiennes.
Cette stratégie linguistique constitue un socle fondamental pour bâtir une République cognitive souveraine, où le tunisien, langue du quotidien, de la création et de l’émotion, côtoie l’arabe comme langue savante, et dialogue harmonieusement avec les langues du monde. C’est dans cette pluralité enracinée que se construit la souveraineté intellectuelle et culturelle de la Tunisie de demain.
Expression artistique et intellectuelle : Moteurs de développement et catalyseurs nationaux
L’expression artistique et intellectuelle est l’un des leviers les plus puissants de l’enrichissement de notre identité, de l’émancipation individuelle, de la cohésion sociale et du rayonnement international. Elle est le miroir de notre époque, la mémoire de notre histoire et le laboratoire de notre avenir. Or, en Tunisie, ces domaines restent marginalisés, sous-financés et peu structurés, alors qu’ils pourraient devenir des secteurs stratégiques majeurs de notre développement.
Notre stratégie repose sur un principe simple mais ambitieux : faire de la culture et de la pensée tunisiennes des acteurs économiques, éducatifs et géopolitiques à part entière. Pour cela, nous établirons :
- Un label « Made in Tunisia – Haute Culture », adossé à un dispositif fiscal incitatif, pour toute production culturelle à fort contenu tunisien (cinéma, séries, jeux vidéo, animation, design sonore, réalité augmentée, bande dessinée, musique, etc.). Inspiré du modèle irlandais « Section 481 », ce label imposera un quota minimal de talents locaux et une exigence de qualité narrative et artistique. Il sera promu dans les festivals internationaux et via les plateformes de streaming.
- Un Pass Culture Jeune, crédité chaque année d’un montant défini, pour les 16–25 ans, afin de leur permettre d’accéder à des biens et services culturels de leur choix : concerts, livres, expositions, cours artistiques, festivals, abonnements numériques, théâtre ou cinéma. Ce pass pourra aussi être utilisé pour co-financer des projets culturels ou associatifs initiés par les jeunes eux-mêmes.
- Un fonds stratégique pour la recherche artistique, esthétique, philosophique et intellectuelle, centré sur les savoirs du Sud, les héritages philosophiques arabo-musulmans, africains et méditerranéens, les narrations alternatives, les esthétiques décoloniales, les récits oubliés ou minoritaires, les imaginaires de la souveraineté, de la mémoire et de l’utopie. Ce fonds financera aussi les résidences d’artistes, les revues d’idées, les séminaires de création, les ateliers d’écriture collective et les laboratoires artistiques transdisciplinaires.
- La création d’un réseau de « Maisons de la création » dans chaque gouvernorat, des lieux hybrides mêlant salles de répétition, ateliers de prototypage, studios numériques, galeries, ciné-clubs et coworking créatif. Elles serviront à accompagner les jeunes artistes, à mutualiser les équipements et à ancrer l’activité culturelle dans les territoires.
- La mise en place d’un Observatoire de la création et des industries culturelles, qui assurera le suivi des dynamiques artistiques, mesurera leur impact économique et social, produira des indicateurs annuels (emplois, PIB culturel, exportation, taux de fréquentation, accès par classe sociale ou région), et pilotera les politiques publiques dans ce domaine.
- Un programme d’intégration de l’art à l’école, allant au-delà des heures théoriques : résidences d’artistes dans les établissements, partenariats avec les musées et les maisons de culture, ateliers d’expérimentation artistique intégrés aux parcours pédagogiques, concours créatifs régionaux, valorisation des productions des élèves.
- Une politique ambitieuse de diplomatie artistique, mobilisant nos artistes comme ambassadeurs culturels, soutenant leur mobilité à l’international, traduisant leurs œuvres, organisant des tournées, des expositions itinérantes et des saisons culturelles dans les pays partenaires, avec une priorité aux pays du Sud, aux diasporas tunisiennes et aux espaces francophones, arabophones et africains.
- L’expression artistique et intellectuelle ne sera plus un supplément d’âme, mais un vecteur central de transformation, d’emploi, de souveraineté culturelle et de conscience collective. Car sans art, il n’y a ni imagination politique, ni espace symbolique pour rêver, ni langage pour penser librement la Tunisie de demain.
Relations et perceptions internationales : Rayonner par l’estime de soi collective
L’image de la Tunisie sur la scène internationale est la vitrine de notre nation. Elle n’est ni un simple outil de communication, ni une opération de marketing : elle est avant tout le reflet de notre estime de soi collective. Une nation fière d’elle-même, lucide sur ses forces, consciente de ses vulnérabilités et claire sur sa vision du monde, dégage naturellement du respect et de la considération. Inversement, une nation qui se méconnaît ou se déprécie inspire peu la confiance.
C’est pourquoi nous nous attacherons à promouvoir une représentation authentique, plurielle, souveraine et vivante de la Tunisie contemporaine. Cette image reposera moins sur des slogans que sur des faits, des personnes, des trajectoires, des œuvres et des récits inspirants. Nous soutiendrons activement nos sportifs, artistes, intellectuels, scientifiques, ainsi que nos entreprises et startups innovantes.
Nous développerons un tourisme conscient, diversifié et décentralisé, qui valorise à la fois notre patrimoine millénaire, nos territoires naturels, nos savoir-faire locaux, nos scènes artistiques, et nos initiatives contemporaines. Il s’agira d’un tourisme intelligent, centré sur l’expérience, la rencontre et la durabilité.
Enfin, nous déploierons une diplomatie ambitieuse, proactive et innovante, qui redéfinit les termes de nos relations extérieures. Elle s’appuiera sur notre souveraineté assumée, notre histoire partagée avec l’Afrique, le monde arabe, la Méditerranée et l’Europe du Sud, et s’inscrira dans notre proposition stratégique de « Reset Géopolitique », un rééquilibrage des rapports Nord-Sud fondé sur la réciprocité, la co-construction, le respect et les intérêts mutuels.
Nous mettrons en œuvre :
- Le programme « Year of Return – Tunis 2030 », destiné à mobiliser la diaspora afro-maghrébine autour de grands événements culturels, intellectuels et économiques. Ce programme proposera des forums de co-investissement, des festivals identitaires, des opportunités de mentorat pour les jeunes en Tunisie, et des symboles forts de réappropriation (passeport symbolique, carte d’honneur, espaces de mémoire). Il s’inspire du modèle ghanéen de 2019, qui a généré plus de 3 milliards de dollars de retombées touristiques et d’investissements.
- Un Visa « Découvrir & Investir », d’une durée de 12 mois renouvelables, pour les créateurs, chercheurs, entrepreneurs, enseignants, artisans ou bâtisseurs du monde entier désireux de s’installer temporairement en Tunisie. Ce visa offrira un accès simplifié à un réseau de services (logement, coworking, incubateurs, universités, espaces culturels) et permettra de faire rayonner la Tunisie comme plateforme méditerranéenne d’innovation et d’accueil.
- Un programme national d’identification et de valorisation des talents de la diaspora tunisienne, dans tous les domaines stratégiques : ingénierie, médecine, arts, musique, cinéma, intelligence artificielle, design, justice, diplomatie, recherche, etc. Ce programme recensera les profils de haut niveau (ex. chercheurs à la NASA, ingénieurs chez Tesla, artistes internationaux, etc.), les mettra en réseau et proposera des formats de collaboration concrets avec l’État tunisien, les universités, les entreprises ou les collectivités locales.
- La création d’un Réseau collaboratif stratégique de la diaspora, plateforme numérique et physique permettant aux membres identifiés de participer à des projets nationaux (mentorat, co-investissement, mission d’expertise, conseil stratégique, chaire universitaire, résidence artistique, etc.). Ce réseau pourra s’appuyer sur les Maisons de la Tunisie contemporaine et sur les ambassades.
- Une politique publique de reconnaissance symbolique, avec la création d’un Prix national de la diaspora tunisienne, décerné chaque année dans plusieurs disciplines (sciences, humanités, entrepreneuriat, sport, culture, solidarité), accompagné d’une cérémonie officielle et médiatisée. Cette politique s’étendra également aux établissements scolaires, où les biographies de ces figures seront intégrées dans les parcours éducatifs.
- Une diplomatie culturelle et entrepreneuriale structurée, mobilisant nos artistes, sportifs, startups et scientifiques comme ambassadeurs de l’esprit tunisien, un esprit à la fois enraciné, audacieux, ouvert et créatif. Cela inclura : des tournées internationales, des résidences croisées, des pavillons tunisiens dans les grands événements mondiaux, des conventions bilatérales de soutien à l’entrepreneuriat créatif et une meilleure coordination entre les ministères concernés (culture, affaires étrangères, industrie, tourisme, éducation, numérique).
- Un réseau mondial de « Maisons de la Tunisie contemporaine », lieux de rayonnement culturel, économique et scientifique installés dans des villes stratégiques (Paris, Dakar, Berlin, Montréal, Le Caire, Alger, Londres, Abidjan, Kuala Lumpur…), intégrant à la fois des galeries, des espaces d’accueil pour étudiants, des vitrines pour les marques tunisiennes et des lieux de dialogue intellectuel.
Nous croyons que la transformation de l’image de la Tunisie dans le monde commence par la transformation de la Tunisie elle-même. C’est par la cohérence entre ce que nous sommes, ce que nous faisons, et ce que nous montrons que naîtra une estime internationale durable. Et cette estime sera l’un des leviers les plus puissants de notre souveraineté, de notre attractivité et de notre confiance retrouvée.
L’identité de « faits » : la structure invisible de notre esprit collectif
Notre héritage culturel et historique, nos valeurs et croyances, notre langue, notre rapport au territoire et ses spécificités, ainsi que notre expression artistique, philosophique, scientifique et intellectuelle forment un socle systémique, profondément enraciné dans notre réalité.Ce socle produit ce que nous appelons une « identité de faits », ou identité factuelle. Contrairement aux identités abstraites fondées sur des idéaux, des récits ou des appartenances déclarées, l’identité de faits émerge de nos pratiques réelles, de nos réflexes quotidiens, de notre rapport intime au pouvoir, au travail, à la loi, à la famille, au temps, à la mémoire ou à l’innovation. Elle structure notre manière d’interagir, de coopérer, de nous projeter dans l’avenir. Elle façonne notre mentalité collective et nourrit ce que nous appelons l’esprit tunisien : un mélange de ruse et de résilience, d’autodérision et de fierté, d’indépendance critique et de besoin de reconnaissance.
Cette identité de faits est méthodiquement décrite dans l’Axe 04 de notre plan de transformation : « Fédérer, mobiliser et remotiver la nation ». Elle nous sert de colonne vertébrale pour élaborer des propositions réalistes, ancrées dans les comportements réels de notre société. Elle nous oblige à penser à partir de ce que nous sommes vraiment, et non de ce que nous prétendons être.
Elle est précieuse pour plusieurs raisons :
- Elle permet de faire le lien entre nos concepts philosophiques et notre quotidien vécu.
- Elle révèle nos paradoxes structurels (ex. : attachement aux traditions et désir de modernité, aspiration à l’ordre et rejet de l’autorité injuste).
- Elle offre une grille de lecture puissante pour concevoir des politiques publiques qui résonnent avec la réalité et non avec des dogmes.
- Elle est un outil de réconciliation intérieure, car elle part du réel et non du fantasme.
Notre ambition n’est pas de figer cette identité, mais de la rendre consciente, partagée, maîtrisée. Loin de subir nos traits collectifs, nous devons les comprendre, les assumer, les questionner et, quand cela est nécessaire, les transformer.
En conclusion : L’identité, flamme de la confiance et moteur de notre avenir
L’identité tunisienne est une fresque vivante, en constante métamorphose, nourrie par notre héritage, nos luttes, nos expressions, nos langues, nos territoires et notre diaspora. Elle ne se réduit à aucune étiquette ni modèle importé : elle se redessine en permanence dans un dialogue fécond entre notre histoire profonde et les dynamiques contemporaines. Elle se réinvente sans relâche, portée par les interactions sociales, les mutations culturelles, les avancées scientifiques et technologiques, les circulations diasporiques, les crises surmontées et les rêves partagés. C’est une identité en mouvement, à la fois enracinée et prospective.
Mais nous sommes lucides. La Tunisie traverse une période de doute profond. Le sentiment d’abandon et de désespérance gagne du terrain. Nos jeunes rêvent d’ailleurs, prêts à quitter un territoire qu’ils ne reconnaissent plus. Dans les rues, la tension est palpable : chaque croisement peut devenir le théâtre d’un éclat de colère. La violence verbale, la criminalité, le laisser-aller dans la gestion des déchets, le repli sur soi, les discours haineux, tout cela clignote comme autant de lumières rouges signalant une nation en danger.
Les réseaux sociaux, sans régulation ni vision commune, déforment notre rapport au monde et à nous-mêmes. Les conflits du Moyen-Orient nourrissent frustrations, confusions identitaires et désignations de boucs émissaires. Et l’absence d’un État fort, protecteur et inspirant se fait ressentir chaque jour dans le quotidien du citoyen : dans la rue, dans l’école, dans le foyer. Mais ce constat ne doit pas nous paralyser. Il doit nous réveiller. Car nous devons croire à nouveau en l’avenir, en nous-mêmes, en notre destin collectif. Nous avons les ressources humaines, culturelles, historiques, morales et symboliques pour inverser la tendance. Pour reconstruire. Pour rassembler.
Pour réenchanter notre contrat social, réhabiliter notre espace public, et faire de notre identité une force agissante. Et au cœur battant de cette identité réside une chose essentielle : la confiance. Une confiance collective, populaire, lucide, structurée. C’est elle qui permet à un peuple de se lever, de créer, d’investir, de défendre, de rayonner.
Sans confiance en nous-mêmes, aucun projet ne peut prospérer. Réaffirmer notre identité, c’est donc raviver cette flamme : celle de la dignité retrouvée, de la fierté assumée, de l’estime de soi collective, et du respect mutuel entre les nations. C’est la clé pour passer d’une société fragmentée à une nation souveraine et rassemblée.
Et c’est seulement en cultivant, célébrant, protégeant et projetant notre identité dans toutes ses dimensions historiques, culturelles, linguistiques, sociales, artistiques, territoriales et factuelles que nous pourrons bâtir un avenir résolu, durable et souverain pour notre peuple.
Vous l’avez compris : tel est le sens profond de notre engagement. Enraciner la Tunisie dans la vérité de ce qu’elle est, pour mieux la propulser dans l’ambition de ce qu’elle peut devenir.
Une stratégie créatrice de 50000 à 80 000 emplois
Au-delà des débats idéologiques ou symboliques, la stratégie identitaire proposée par INTILAQ 2050 est un plan économique, territorial, technologique et culturel concret.
Sur une période de 10 ans, elle permettra la création de 50 000 à 80 000 emplois, dans tous les gouvernorats, dans des secteurs stratégiques, aujourd’hui trop souvent sous-exploités.
Voici les grands chantiers structurants, avec leur estimation d’emplois et une description claire des opportunités qu’ils créent. (Ces chiffres sont basés sur des projets réels équivalents, en Afrique, au Maroc, en Indonésie et au Portugal)
1. Réseau de musées Beit Al Fan
→ 19 000 à 29 000 emplois (6 000 à 9 000 directs / 13 000 à 20 000 indirects)
Création d’un réseau de 12 à 24 musées régionaux, intégrant musée, centre de formation, fablab patrimonial, marché d’artisans, résidence artistique et pôle bien-être.
Un pôle central à Kairouan accueillera 200 000 œuvres, une BnF islamique, une école d’art et de calligraphie, des jardins et des espaces immersifs.
Métiers concernés : conservateurs, médiateurs culturels, scénographes, artisans, régisseurs, guides, restaurateurs d’œuvres, techniciens de maintenance, personnel d’accueil, agents de production culturelle.
Effets induits : développement de l’artisanat local, tourisme intérieur, hôtels, commerces, librairies, métiers du transport et de la restauration.
2. Reconstitution immersive d’El Jem
→ 3 000 à 5 000 emplois (1 000 à 1 500 directs / 2 000 à 3 500 indirects)
Restauration complète de l’amphithéâtre et création d’une ville romaine immersive : spectacles historiques vivants, artisans en résidence, parcours scénarisés, reconstitutions 3D, expositions itinérantes.
Un projet comparable au parc historique français Puy du Fou, mais dans un cadre romain et tunisien unique.
Métiers concernés : architectes, archéologues, costumiers, acteurs, cavaliers, régisseurs de scène, scénaristes, spécialistes de la reconstitution historique, animateurs 3D, ingénieurs son et lumière.
3. Déploiement des bioterritoires culturels (1 par gouvernorat)
→ 11 000 à 17 000 emplois (3 000 à 5 000 directs / 8 000 à 12 000 indirects)
Chaque gouvernorat définira son écosystème stratégique (artisanat, musique, agriculture, patrimoine naturel, culture locale) et recevra un guichet unique, des incitations fiscales, des infrastructures légères, et un accompagnement technique.
Métiers concernés : chargés de développement local, animateurs de projets, guides, producteurs artisanaux, formateurs, responsables de site, gestionnaires de circuits touristiques.
Effets induits : renforcement des emplois agricoles et artisanaux, relance du tourisme intérieur, redynamisation des communes rurales.
4. Plateformes culturelles et industries créatives
→ 9 000 à 17 000 emplois (4 000 à 7 000 directs / 5 000 à 10 000 indirects)
Mise en place d’un écosystème complet : studios de production, plateforme de streaming tunisienne, fonds de coproduction pour le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la BD, les podcasts, les performances scéniques.
Métiers concernés : scénaristes, réalisateurs, monteurs, ingénieurs du son, développeurs, producteurs, illustrateurs, musiciens, auteurs, compositeurs, directeurs artistiques.
Effets induits : impression, logistique, distribution numérique, événementiel, sous-traitance technique, hébergement web.
5. Académie de la langue tunisienne & stratégie linguistique
→ 4 000 à 7 000 emplois (2 000 à 3 000 directs / 2 000 à 4 000 indirects)
Création de l’Académie de la langue tunisienne, développement de manuels open source en dialecte et en arabe moderne, production de dictionnaires de terminologie, lancement d’une plateforme participative Arabic+.
Métiers concernés : enseignants, linguistes, traducteurs, développeurs de contenus éducatifs, lexicographes, terminologues, spécialistes en IA linguistique, formateurs.
6. Pass Culture Jeune (16–25 ans) et actions éducatives
→ 1 500 à 2 500 emplois (essentiellement directs)
Le Pass Culture Jeune permettra à plus de 500 000 jeunes d’accéder à des biens et services culturels subventionnés (livres, théâtre, cinéma, cours d’art, etc.).
Cela générera des emplois dans la distribution culturelle, les lieux de diffusion, les centres de formation.
Métiers concernés : formateurs artistiques, animateurs culturels, libraires, gestionnaires de centres, médiateurs.
7. Maisons de la Tunisie à l’international (10 capitales)
→ 3 000 à 5 000 emplois (1 000 à 2 000 directs / 2 000 à 3 000 indirects)
Création de lieux culturels multidimensionnels dans des capitales stratégiques (Paris, Berlin, Montréal, Dakar, Kuala Lumpur…) : expositions, événements, coworking culturel, bibliothèque, espace startup.
Métiers concernés : attachés culturels, programmateurs, agents d’accueil, responsables de projet, communicants, logisticiens, agents diplomatiques culturels.
8. Programme diaspora et réseau stratégique
→ 2 000 à 3 000 emplois (mobilisation + administration + communication)
Identification des talents tunisiens à l’étranger (NASA, Tesla, médecine, IA, arts), création d’un réseau de collaboration stratégique, prix annuels, valorisation éducative dans les écoles.
Métiers concernés : chercheurs en données, communicants, animateurs de réseau, responsables de programme, profils hybrides diaspora/innovation.
9. Numérisation, IA culturelle et patrimoine 3D
→ 3 500 à 5 500 emplois (1 500 à 2 500 directs / 2 000 à 3 000 indirects)
Développement d’une plateforme immersive « Tunisie 3000 », numérisation 3D des sites historiques, IA linguistique et culturelle tunisienne, archives sonores et visuelles accessibles en open source.
Métiers concernés : ingénieurs IA, développeurs 3D, archivistes numériques, chercheurs en humanités numériques, designers d’expérience immersive.
Total estimé :
→ Emplois directs : 17 500 à 28 500
→ Emplois indirects : 32 000 à 52 000
→ Emplois totaux : 50 000 à 80 000
Un investissement structurant : 10 à 12 milliards de dinars sur 10 ans
Ce plan d’action national, réparti sur 10 ans, repose sur un investissement public et privé estimé à 10 milliards de dinars tunisiens. Ce montant correspond à environ 0,5 % du PIB par an, un effort soutenable pour une stratégie à fort retour économique, social et géopolitique.
Répartition estimative des investissements (millions de dinars) :
- Grands musées & pôles Beit Al Fan : entre 2 000 et 4 000 M TND selon les ambitions
Construction ou rénovation de 12 à 24 musées régionaux, centre culturel central à Kairouan, infrastructures de formation, espaces d’exposition, résidences d’artistes. - Reconstitution immersive d’El Jem : 800 M TND
Restauration de l’amphithéâtre, création d’un parc historique vivant, événements culturels permanents. - Bioterritoires culturels dans chaque gouvernorat : 1 200 M TND
Aménagements territoriaux, circuits culturels, signalétique, centres d’accueil, studios mobiles, aides aux initiatives locales. - Industries culturelles et créatives (cinéma, jeux, édition) : 1 000 M TND
Studios de production, plateformes de streaming, fonds de coproduction, crédits d’impôt culture. - Stratégie linguistique & Académie de la langue tunisienne : 700 M TND
Création de manuels, numérisation du corpus tunisien, IA linguistique, dictionnaires, contenus éducatifs. - Pass Culture Jeune sur 10 ans : 300 M TND
30 millions de dinars par an alloués à plus de 500 000 jeunes pour accéder à la culture (arts, livres, théâtre…). - Maisons de la Tunisie à l’international : 600 M TND
Création de 10 à 12 centres culturels dans des capitales stratégiques, dédiés au rayonnement culturel, économique et diasporique. - Programme diaspora & réseau d’élites tunisiennes : 400 M TND
Plateforme collaborative, valorisation des talents, événements de reconnaissance, intégration dans les projets nationaux. - Diplomatie culturelle & rayonnement international : 500 M TND
Pavillons tunisiens, saisons croisées, festivals, partenariats stratégiques. - Numérisation, IA, patrimoine 3D & archives vivantes : 1 000 M TND
Reconstitutions immersives, plateforme Tunisie 3000, scan 3D des sites historiques, open archives, traitement IA. - Fonds de soutien, mécénat & incitations fiscales : 1 500 M TND
Fonds d’innovation culturelle, dons défiscalisés, mécénat structuré, appui aux initiatives citoyennes.
Comment financer une stratégie identitaire ambitieuse ? Une approche réaliste, plurielle et souveraine
On pense souvent que l’identité nationale est un sujet abstrait, difficile à financer. C’est évidemment totalement faux. Le plan INTILAQ 2050 propose une stratégie claire, réaliste et structurée pour financer 10 milliards de dinars d’investissement sur 10 ans, soit 1 milliard par an, environ 0,5 % du PIB annuel.
C’est un effort soutenable, surtout lorsque l’on sait que ce plan génère des dizaines de milliers d’emplois, redonne du sens collectif, soutient la paix sociale et renforce l’attractivité internationale de la Tunisie.
Un financement réparti en 4 piliers
A) 🇹🇳 35 % financés par l’État tunisien – 3,5 milliards de dinars
L’identité n’est pas un luxe, c’est une fonction régalienne. Une part significative de cet investissement doit venir du budget de l’État, réparti entre plusieurs leviers :
- Création d’un Fonds souverain culturel et identitaire, doté chaque année via la loi de finances ;
- Intégration dans une loi de programmation pluriannuelle (10 ans) sur la culture, l’éducation, la langue et les territoires ;
- Mobilisation des budgets déjà existants dans les ministères concernés (Culture, Éducation, Jeunesse, Tourisme, Affaires sociales) avec un fléchage clair.
👉 Ce financement public permettra de garantir l’accès gratuit ou subventionné à tous, l’égalité territoriale, et l’ancrage républicain de la démarche.
B) 30 % via des subventions internationales – 3 milliards de dinars
De nombreux financements internationaux sont disponibles pour soutenir les pays du Sud dans les domaines du patrimoine, de l’éducation, du multilinguisme ou du numérique. La Tunisie, bien positionnée diplomatiquement, peut mobiliser :
- UNESCO : pour les musées, sites patrimoniaux, formations artistiques et éducation à la diversité ;
- Union européenne : à travers les programmes Europe Créative Méditerranée, Voisinage Sud, ou Interreg Sud ;
- Banque mondiale et Banque africaine de développement : pour les infrastructures culturelles, la formation, la numérisation ;
- Fonds arabes ou islamiques : comme la Banque islamique de développement, le Fonds arabe pour la culture ou des fonds du Golfe ;
- Fonds environnementaux et climatiques : pour la protection des écosystèmes culturels et les bioterritoires.
👉 Ces subventions sont souvent sous-utilisées en Tunisie, faute de vision stratégique, de portage politique et de coordination. Ce plan leur donne un cadre clair.
C) 25 % via des crédits d’investissement et partenariats – 2,5 milliards de dinars
L’identité peut aussi attirer des investisseurs, à condition d’être structurée autour de projets rentables ou porteurs de sens. Trois leviers complémentaires :
- Partenariats public-privé (PPP) : pour les musées, plateformes culturelles, festivals, circuits touristiques ;
- Obligations culturelles ou patrimoniales : à émettre au niveau national ou local, auprès de citoyens, de banques ou d’institutions ;
- Fonds mixtes thématiques : réunissant l’État, des investisseurs privés et des acteurs de la diaspora, pour financer les industries culturelles, les reconstitutions historiques, les studios ou les projets éducatifs.
👉 Ce pilier permet de diversifier les ressources et de responsabiliser le secteur privé et les collectivités locales.
D) 10 % par des ressources innovantes – 1 milliard de dinars
Ce dernier levier fait appel à la créativité financière et à l’intelligence collective. Il inclut :
- Mécénat culturel et fiscalité incitative : les entreprises peuvent déduire tout ou partie de leurs dons à la culture (comme en France ou au Maroc) ;
- Plateformes de crowdfunding souverain : pour mobiliser la diaspora sur des projets concrets (restauration d’un site, résidence d’artiste, équipement d’un musée…) ;
- Revenus générés par les projets eux-mêmes : billetterie, ventes, location d’œuvres, licences numériques, merchandising, tourisme thématique.
👉 Ce levier est stratégique pour créer un lien direct entre les citoyens (en Tunisie ou à l’étranger) et les projets identitaires du pays.
Un modèle hybride, souverain, reproductible
Ce montage financier repose sur une articulation volontaire entre ressources nationales, internationales, citoyennes et privées. Il est :
- Souverain, car l’État reste pilote stratégique ;
- Partagé, car les acteurs privés, les citoyens et les partenaires étrangers y prennent part ;
- Modulable, car il s’adapte aux projets et aux territoires.
Et surtout, il crée une dynamique positive : chaque investissement déclenche des retombées économiques, sociales et symboliques bien supérieures à son coût initial. Ce plan est conçu pour être progressif, partenarial et générateur de retours économiques dans les régions, les filières de création, l’hôtellerie, l’artisanat et les services numériques.
Bénéfices stratégiques et mesurables
L’investissement dans l’identité nationale ne produit pas seulement de l’emploi et de la croissance. Il génère des bénéfices profonds, durables et transversaux, qui touchent à l’unité nationale, à la paix sociale, à l’innovation et à la projection géopolitique du pays.
Bénéfices économiques
- Montée en puissance de filières innovantes (industries culturelles, éducation linguistique, patrimoine numérique).
- Valorisation des territoires oubliés via les bioterritoires.
- Création d’un tourisme alternatif, durable et décentralisé.
- Récupération de la dépense culturelle à l’étranger (streaming, éditions, produits créatifs…).
Bénéfices sociaux
- Réduction des fractures intergénérationnelles, régionales et communautaires.
- Inclusion effective de toutes les composantes de la société : amazighes, juifs, chrétiens, régions rurales, jeunes sans emploi…
- Revalorisation de la culture civique et du respect collectif à travers les actions participatives.
- Retournement du sentiment de fatalisme grâce à la fierté, la narration et l’horizon collectif.
Bénéfices géopolitiques
- Affirmation de la Tunisie comme puissance culturelle méditerranéenne.
- Déploiement d’une diplomatie culturelle proactive, portée par ses artistes, chercheurs, sportifs, créateurs.
- Mise en place de relations bilatérales structurées sur la base du respect culturel et de la coopération Sud-Sud.
Bénéfices symboliques
- Récit national cohérent, transmis et incarné.
- Passage d’une identité défensive à une identité créative.
- Régénération de la confiance collective : condition indispensable de tout projet national.
Conclusion
Cette stratégie pour la maitrise de notre identité est bien plus qu’un projet culturel. C’est une part de notre stratégie de transformation nationale, qui conjugue emploi, territoire, langue, patrimoine, savoir, diaspora et innovation. Elle répond à trois urgences :
- Recréer du lien et du sens collectif ;
- Redonner du travail et de la dignité dans les régions ;
- Projeter une Tunisie forte, inclusive et souveraine dans le monde.
Et c’est cela, la maîtrise de notre identité : Un ancrage solide dans notre passé pour avancer ensemble vers un futur pertinent et responsable.